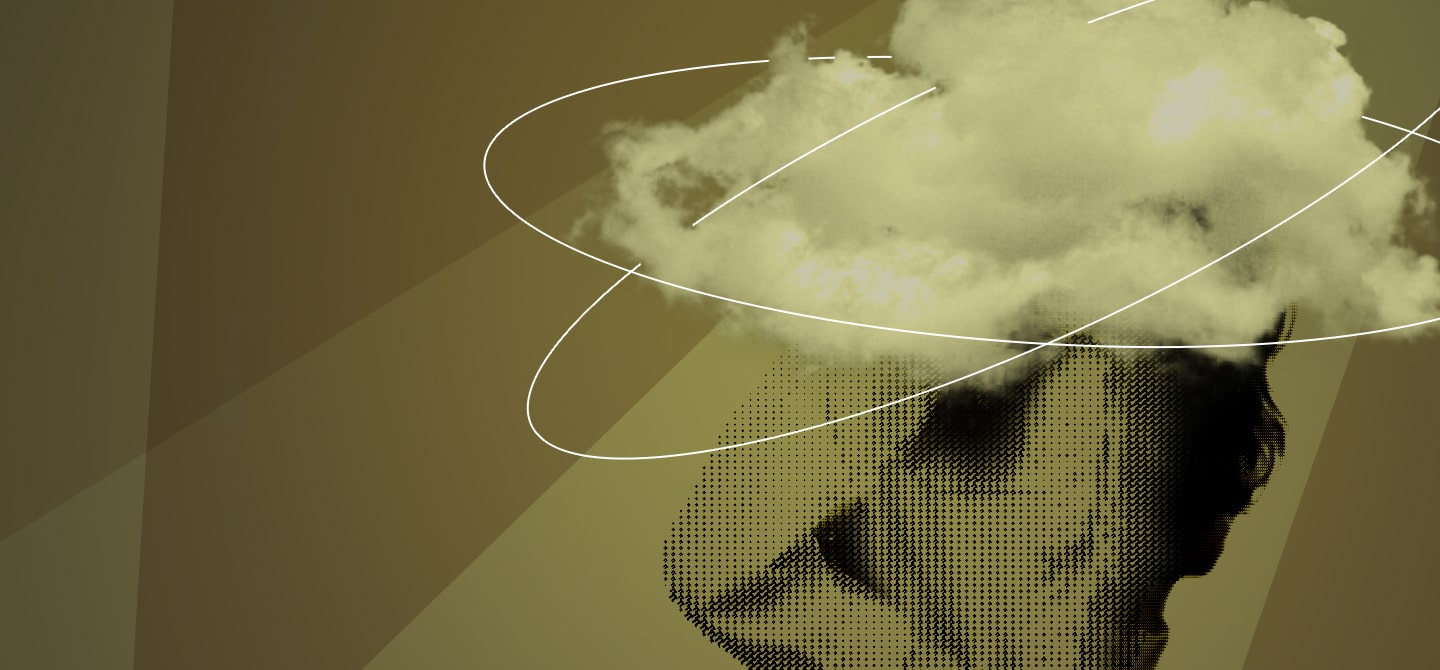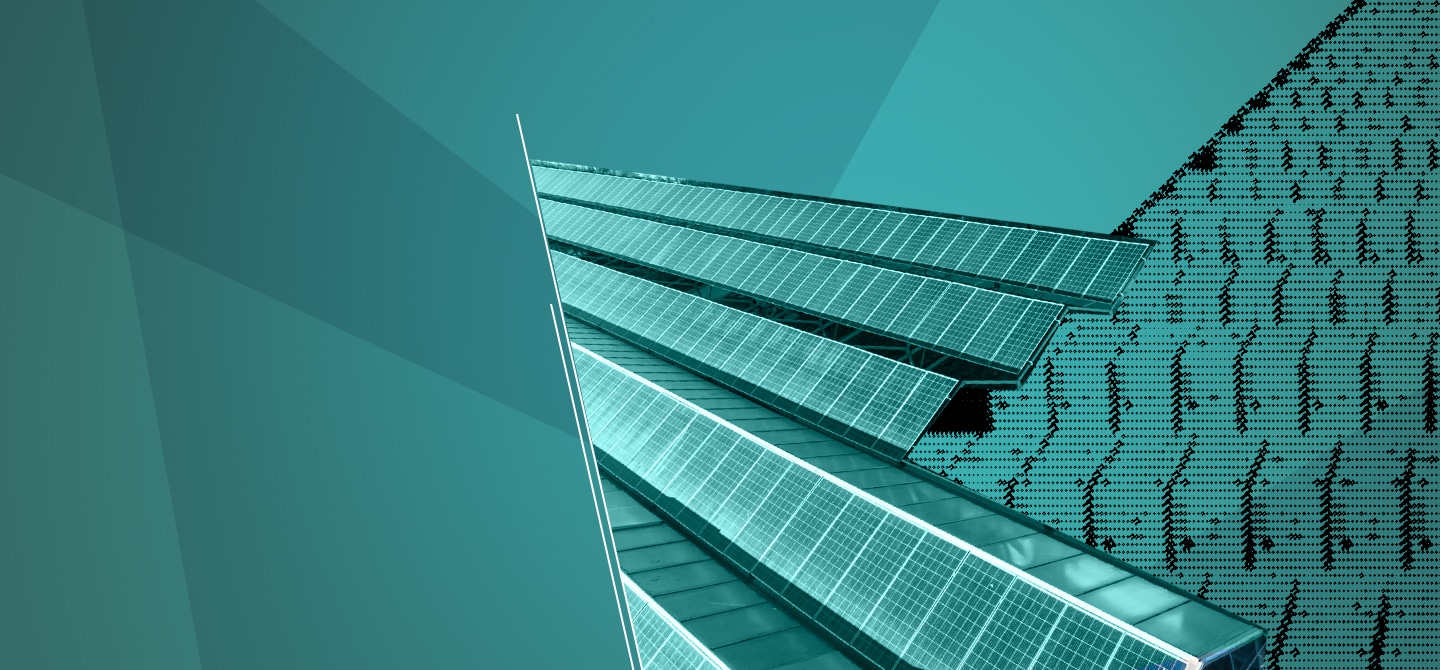Quelle place pour le low-tech dans la société de demain ?
- Le low-tech est une nouvelle conception du progrès et de l’innovation plus durable, robuste et économique en matériaux ou en énergie.
- Il trouve sa source dans le mouvement technocritique des années 70, se développant grâce à différents acteurs qui promeuvent les pratiques et savoir-faire autour des basses technologies.
- La recherche s’intéresse de plus en plus aux approches low-tech : le CNRS a lancé deux appels à projet pour des travaux autour des « sciences frugales ».
- Dans l’idée de la neutralité carbone en 2050, les low-tech devraient permettre de diviser par trois la consommation d’électricité en électronique ou électroménager.
Smartphones, enceintes connectées, tablettes, ordinateurs, montres connectées… Les appareils high-techs se multiplient dans les foyers. L’impact de cette surenchère technologique sur la planète est aujourd’hui bien connu. Seulement 1 % des terres rares utilisées pour fabriquer ces objets, comme l’indium ou le gallium, sont recyclées, à l’échelle mondiale. Sans parler de la pollution que l’utilisation massive de données engendre. Depuis une dizaine d’années, le mouvement low-tech milite pour une nouvelle définition de la modernité et de l’innovation, où l’on remet en question notre consommation et nos usages.
« Utiles, durables accessibles »
Le concept de low-tech a un temps été perçu comme une opposition au progrès, un rejet de la technologie, en faveur de solutions simples bricolées à la main. En réalité, il s’agit d’un mouvement plus large de réflexion sur notre impact environnemental, nos besoins et nos façons d’y répondre, dont les prémices remontent aux années 1970. Il ne s’agit pas de revenir à la bougie, mais pas non plus simplement de promouvoir des technologies industrielles vertes ou des objets écoconçus. Le Low-Tech Lab définit les basses technologies comme « des objets, des systèmes, des techniques, des services, des savoir-faire, des pratiques, des modes de vie et courants de pensée qui intègrent la technologie selon trois grands principes ». Ces technologies doivent être utiles, répondre à des besoins individuels et collectifs. « Il s’agit de se réapproprier collectivement la question des besoins, se demander ensemble ce qui est réellement utile ou pas », détaille Quentin Mateus, ingénieur et directeur des enquêtes du Low-Tech Lab. Elles doivent être accessibles, libres de droit et les plus simples possibles pour être appropriées par le plus grand nombre, fabricables localement, adaptables aux besoins et ressources de chaque contexte, etc. Enfin, les low-tech doivent être durables, optimisées pour avoir le moins d’impact écologique et social, pour être les plus robustes possible, à l’image de L’Increvable, une machine à laver pensée par des designers et ingénieurs pour durer 50 ans, et être facilement réparée et mise à jour par ses propriétaires.
Un travail collectif de réflexion et de formation
Les low-tech impliquent un travail collectif, démocratique et participatif de réflexion, de décision, mais aussi de formation. « Il faut faire monter la personne en compétences, si elle n’a pas les capacités au départ, donc que les plans soient libres, qu’il y ait des cadres d’apprentissage, pour être plus autonome dans la réparation, l’adaptation de l’objet à mon besoin, mon contexte », explique l’ingénieur. Il n’existe pas réellement de définition précise des low-tech, pas de label ou de cahier des charges, mais le concept, qui repose plutôt sur des grands principes, peut être appliqué à de multiples domaines : la mobilité, les usages numériques, l’habitat, l’alimentation, l’éducation, la culture…
La low-tech a également une dimension sociale et politique. En 2019, le think-tank La Fabrique écologique publie une note sur ces technologies sobres et résilientes, signée par de nombreux acteurs du mouvement, comme Philippe Bihouix, Amandine Garnier du Low-Tech Lab, mais aussi Bruno Tassin, directeur de recherche à l’école des ponts ParisTech ou encore Marc Darras, président du Groupement professionnel Centraliens « Ingénieur et Développement Durable ». La note précise que « cette démarche n’est pas seulement technologique, mais aussi systémique. Elle vise à remettre en cause les modèles économiques, organisationnels, sociaux, culturels. » Il s’agit donc également d’imaginer de nouveaux modèles de consommation, de production, de gouvernance. « C’est se tromper de vouloir seulement remplacer les high-tech par des low-tech par souci environnemental. Il s’agit de remettre en question la high-tech et son monde », indique Quentin Mateus.
Quelle place pour la recherche scientifique ?
Pour participer à cette remise en question, la science et les chercheurs ont toute leur place, selon Martina Knoop, physicienne et directrice de la Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires (MITI) du CNRS, qui a déjà mis en place deux appels à projet de recherche pour mettre en avant les « sciences frugales ». « Les approches low-tech sont des approches frugales. Il s’agit de faire aussi bien avec moins d’investissement en matériaux, en énergie, en temps de recherche, etc », précise-t-elle. Pour y arriver, les chercheurs et chercheuses réfléchissent à des procédés, des instrumentations ou des capteurs plus simples et moins gourmands en ressources naturelles. Cette réflexion concerne toutes les disciplines.
A titre d’exemple, un projet retenu par le CNRS s’intéresse à la surveillance de la pollution de l’air. Mélina Macouin, chercheuse au laboratoire des géosciences et de l’environnement à Toulouse, utilise les écorces de platanes comme biocapteurs pour analyser la présence de nanoparticules. L’étude mêle low-tech et science participative, puisque les Toulousains sont invités à installer des guirlandes d’écorces de platane chez eux. Cette approche de la science citoyenne, souvent low-tech, prend de plus en plus d’ampleur, selon la directrice de la MITI. « Faire mieux avec moins, c’est une réflexion inhérente à la recherche, dans tous nos procédés. Il est parfois plus difficile et complexe d’inventer un procédé plus simple, moins gourmand et tout aussi performant. Les contraintes peuvent être sources d’inventivité et la base des innovations futures », affirme la physicienne.
Quelle place auront les scientifiques dans une société basse technologie ? « Pour pouvoir mettre en place les conditions nécessaires au développement d’une économie low-tech dans toutes ses dimensions, ces nouvelles formes de recherche, elles aussi plus distribuées et plus ancrées dans chaque contexte, ont tout leur rôle à jouer, et au passage un sens à retrouver. Il y a besoin de jus de cerveau, d’intelligence collective, de haut niveau d’ingénierie sociale, économique, technique pour démanteler ce qui n’est plus viable, réallouer, recomposer des filières et une dentelle d’organisations sociotechniques appropriées. Il faudra du temps et de l’intelligence humaine, mais pas forcément un haut débit de données. », défend Quentin Mateus.
Repenser notre industrie
Une société low-tech nécessite donc de repenser la façon dont nous pratiquons les sciences et les techniques, mais aussi la place de l’industrie. Pour le représentant du Low-Tech Lab, il ne s’agit pas de se débarrasser du secteur et de notre tissu industriel. Il faut encore une fois réfléchir en termes de besoins.
En 2021, l’ADEME, l’Agence de la transition écologique, a imaginé le scénario d’une « génération frugale » pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Ce dernier comprendrait le « respect de la nature » et la mise en place d’un appareil productif fondé sur les low-tech, « plus robustes et réparables par les citoyens ». Il s’agirait ainsi de diviser par trois la consommation d’électricité pour les usages spécifiques comme l’électronique ou l’électroménager, de passer à une agriculture plus extensive, de baisser de façon importante la mobilité, en favorisant le vélo donc, de relocaliser certaines productions et de diminuer la demande de produits et services, en redonnant une place importante à « l’économie de la fonctionnalité et de la réparation ». La demande énergétique globale, l’électricité, la chaleur, le gaz ou encore l’essence, baisserait ainsi de moitié par rapport à celle de 2015. L’émission de gaz à effet de serre diminuerait quant à elle de 42 millions de tonnes en équivalent CO2.