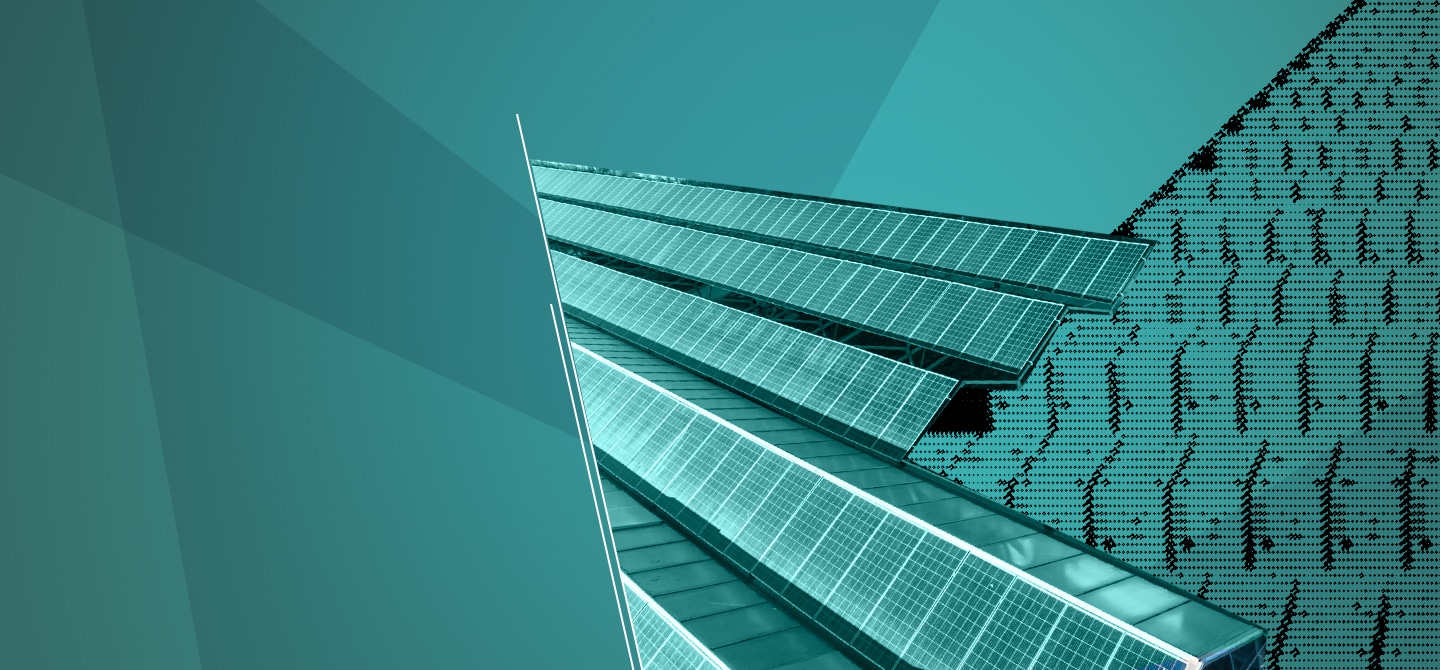L’IA peut-elle remplacer l’expérimentation animale ?
- Au vu de l’efficacité de l’IA dans de multiples domaines, l’hypothèse émerge de l’utiliser pour simuler le vivant et se passer de l’expérimentation animale.
- En recherche, les animaux sont utilisés pour étudier et comprendre les phénomènes biologiques et pour vérifier l’innocuité et l’efficacité d’un produit.
- La directive européenne de 2010 encadre l’expérimentation animale à travers la règle des trois R : Remplacement, Réduction et Raffinement.
- Plusieurs utilisations de l’IA émergent : les systèmes de « jumeaux numériques », les organoïdes ou la biostatistique pour « optimiser » l’utilisation d’animaux.
- Le débat est encore animé, notamment sur l’utilisation d’espèces de substitution, non-couvertes par la loi de protection des animaux dans la recherche scientifique.
Les algorithmes d’intelligence artificielle (IA) simulent très efficacement les voix humaines ou la production d’images. Sont-ils aussi capables de simuler suffisamment bien le vivant pour permettre de se passer de l’expérimentation animale ? La question émerge face à la préoccupation croissante du bien-être animal. « On ne pense plus l’animal comme une machine et notre société estime que l’humain lui doit une protection. À cela s’ajoutent les progrès en éthologie, en psychologie animale et l’émergence de concepts comme la culture animale. Toutes ces données remettent en question l’expérimentation animale », explique le philosophe des sciences Jean-Michel Besnier, professeur émérite de philosophie à Sorbonne Université. Cette préoccupation sociétale se confronte à une autre prise de conscience. « Il n’est pas si facile de tirer des conclusions sur l’humain à partir de la souris… À quoi bon faire souffrir des animaux pour des résultats qui sont sujets à caution ? », interroge le philosophe.
Les animaux sont utilisés dans la recherche à plusieurs fins : pour étudier et comprendre les phénomènes biologiques dans le cadre de la recherche fondamentale et pour vérifier l’innocuité et l’efficacité d’un produit ou d’un médicament dans le cadre de la recherche règlementaire et toxicologique. Ce problème n’est pas négligé par le monde scientifique. La directive européenne de 2010 (2010/63/UE) encadre ainsi l’expérimentation animale à travers la règle des trois R : Remplacement, Réduction et Raffinement, qui revient à réduire la souffrance infligée.
Remplacer
Des systèmes d’intelligence artificielle peuvent-ils remplacer l’expérimentation animale ? C’est l’objectif des systèmes dits de « jumeaux numériques ». Ce sont des programmes de simulation, qui imitent par exemple des propriétés biochimiques ou biophysiques de tissus humains. « C’est une ressource de plus en plus utilisée dans le domaine médical, en particulier en chirurgie pour offrir au praticien l’opportunité de s’entraîner en amont de la procédure, sur une simulation d’un organe ressemblant à son patient. Cet avatar permet de réduire l’aléa chirurgical », continue Jean-Michel Besnier.
La toxicologie investit une autre piste alternative, celle des organoïdes. Ce sont des cultures en trois dimensions qui cherchent à représenter un organe. « Il s’agit d’objets biologiques ressemblant à un organe et produits en laboratoire à partir de cellules souches. Toutefois, ce n’est pas un vrai organe et c’est la limite. On n’est pas assuré que la réponse d’un organoïde soit identique à celle d’un vrai organe » nuance Nicolas David, biologiste du développement au sein du Laboratoire d’optique et biosciences de l’Institut polytechnique qui développe cette approche1. Des systèmes similaires sont aussi envisagés pour la médecine personnalisée, afin de tester la réponse des cellules d’un patient avant une prescription anticancer par exemple.
Réduire
La recherche fondamentale est certainement le volet le plus difficile à remplacer. Récemment, une équipe de la Washington University School of Medicine à St Louis2 a présenté un algorithme de machine learning capable de prédire comment un réseau de gènes et de régulations de leur expression interagit pour construire l’identité d’une cellule au cours du développement. Le système prédit ce qui pousse une cellule à devenir une cellule musculaire, de la peau ou nerveuse en fonction des leviers génétiques activés. Baptisé CellOracle, il compile des dizaines d’années de recherches mondiales en s’appuyant sur les bases de données publiques qui ressassent les interactions génétiques connues. On peut ainsi lui demander quel effet aura la disparition d’un gène dans un des organismes modèles que le logiciel intègre. Cela épargne aux chercheurs la conception d’animaux porteurs de cette anomalie génétique. « C’est une simulation in silico de Knock out », les animaux à qui on a introduit une mutation dans le génome qui empêche l’expression d’un gène, résume Nicolas David.

Certaines techniques de biologie moléculaire ont été reproduites tant de fois qu’elles peuvent ainsi être traitées par un algorithme de machine learning. « Mais si on est capable de simuler un système, c’est qu’on l’a compris. », commente Nicolas David. Ainsi, de tels systèmes épargnent un travail exploratoire ou signalent une piste de recherche inexploitée, mais leurs résultats ne sont pas infaillibles. Avant de s’engager sur une piste et d’entrer dans une phase de recherche appliquée, il faudra les vérifier.
Raffiner
Il faut également vérifier les systèmes avec d’autres approches mathématiques. « Il existe désormais des systèmes de biostatistiques pour anticiper le nombre minimum d’animaux qu’il faut utiliser dans une recherche pour répondre à une question donnée. Cette approche est déployée au sein de l’Institut Pasteur et nous aide à réduire, par optimisation, le volume de l’expérimentation animale », précise Jean-Baptiste Masson, physicien statisticien au sein de l’Institut Pasteur à Paris.
Ces dernières années, de nouvelles approches de remplacement émergent. Nicolas David explique ainsi « Tous les animaux ne sont pas reconnus comme sensibles. On peut essayer d’aller vers des espèces de substitution. » Il peut s’agir d’étudier les étapes les plus précoces du développement, avant que l’organisme ne soit couvert par la loi de protection des animaux dans la recherche scientifique3. « Chez le mammifère, cela dépend de la durée totale de gestation. Ils ne sont protégés qu’après deux tiers du développement normal. Pour les non-mammifères, c’est plus compliqué. La loi parle de forme larvaire autonome. Chez le poisson, l’autonomie est interprétée comme la capacité à se nourrir par lui-même, et donc au moment où la bouche s’ouvre. », précise le biologiste Nicolas David.
Enfin, des équipes se tournent vers les modèles d’animaux invertébrés, avec une contrainte évidente : plus on s’éloigne de l’espèce humaine dans l’arbre évolutif, plus le risque que les conclusions ne puissent pas s’appliquer à la recherche clinique croit. Cette tendance est aussi contestée par la communauté scientifique elle-même. En avril dernier, 287 philosophes, éthiciens, éthologistes et neurobiologistes spécialistes de la conscience animale ont signé la Déclaration de New York sur la conscience animale4. Ce texte déclare « irresponsable » d’ignorer la possibilité que tous les vertébrés et que plusieurs espèces invertébrées (comme les céphalopodes, les insectes et des crustacés de la famille des crabes et des crevettes) aient une « expérience consciente » au vu d’un nombre croissant de travaux scientifiques. Les auteurs font référence à des travaux très avant-gardistes chez les abeilles5, chez le poulpe6 ou encore chez deux espèces de serpents7. Le texte constitue ainsi un principe de précaution face à la possibilité de conscience d’espèces utilisées à des fins d’expérimentations scientifiques. De quoi relancer la recherche d’alternatives.