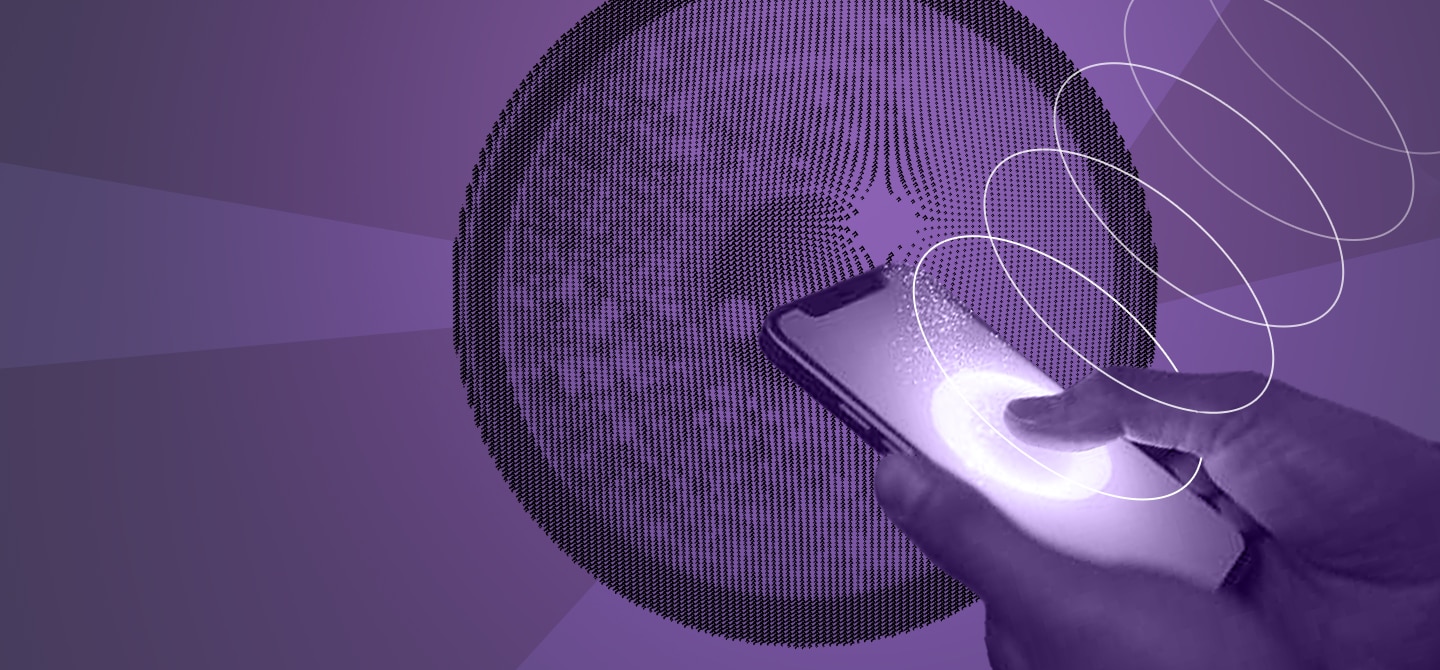Partout dans le monde, plus on est pauvre, moins on est en bonne santé, et la France ne fait pas exception. Les cancers, première cause de mortalité du pays, participent largement aux inégalités sociales de santé nationales : ils y contribueraient à hauteur de 40 % chez les hommes et de 30 % chez les femmes1. Comment le statut social pèse-t-il sur les cancers ? Différentes études montrent qu’il augmente le risque de développer ces pathologies, rend plus difficile le parcours de soin et contribue à une dégradation de la qualité de vie après le traitement.
L’avant-maladie : des facteurs de risque socialement marqués
Certes, les cancers du sein ont tendance à toucher légèrement plus souvent des personnes favorisées. Mais pour la majorité des autres localisations, les incidences sont nettement plus élevées au sein des classes sociales modestes. Les familles de cancers les plus meurtrières (poumon et voies aérodigestives supérieures ou VADS), notamment, apparaissent particulièrement liées à la détresse sociale.
Comment l’expliquer ? La réponse réside essentiellement dans le déterminisme social des principaux facteurs de risque. Ainsi, alors que la consommation de tabac est unanimement reconnue comme le facteur de risque majeur en matière de cancer du poumon et l’un des deux principaux, aux côtés de l’alcool, pour les cancers VADS, les personnes les moins qualifiées sont 2,3 fois plus nombreuses que les personnes les plus qualifiées à fumer quotidiennement (la tendance est toutefois inversée pour l’alcool : sa consommation est 1,3 fois plus importante au sein des classes les plus favorisées2).
Mais contrairement à certaines idées reçues, cette consommation à risque n’est pas toujours le résultat d’un choix individuel totalement libre. Dans son ouvrage La cigarette du pauvre, Patrick Peretti-Watel met ainsi en évidence une fonction socialisatrice précoce de la cigarette dans les milieux défavorisés et explique que « la précarité induit un stress qui incite à fumer (…). La précarité raccourcissant aussi l’horizon temporel, cela contribue à relativiser les effets délétères du tabagisme sur le long terme ». L’arrêt du tabac, acte majeur de prévention, est ainsi nettement plus difficile pour les personnes en situation de précarité.

Par ailleurs, si l’intoxication tabagique est à juste titre pointée du doigt pour expliquer les inégalités, d’autres facteurs de risque très socialement marqués, comme l’exposition professionnelle à des produits cancérogènes, ne doivent pas être oubliés. « La littérature scientifique montre qu’on a beaucoup moins étudié l’impact de ces facteurs, alors que leur poids semble important. Les soignants eux-mêmes y sont moins bien sensibilisés » explique Aurore Loretti.
Malgré des progrès réalisés au cours des dernières décennies, ces expositions demeurent en effet fréquentes en France. La dernière enquête Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels de 2017 indiquait en effet que 11 % des salariés avaient été exposés à au moins un produit cancérogène au cours de la dernière semaine travaillée3. La moitié de ces personnes était des ouvriers.
Pendant la maladie : une sédimentation des inégalités
Les inégalités se renforcent ensuite tout au long du parcours de soin. « Quelle que soit la localisation cancéreuse, les taux de survie sont d’autant moins bons que l’on est situé plus bas dans la hiérarchie sociale » confirme Gwenn Menvielle.
La France dispose pourtant d’atouts. Son système de santé s’avère plus efficace que la moyenne de ses voisins européens : alors que les incidences de cancer de la population générale y sont plus nombreuses (associées à une plus grande consommation moyenne de tabac et d’alcool, et à une vaccination plus faible contre le papillomavirus), les taux de survie y sont meilleurs. Les dépenses par habitant en soins oncologiques figurent parmi les plus élevées d’Europe et la part de reste à charge des patients pour la santé est la plus faible de tous les pays de l’Union européenne4.
On pourrait imaginer que la barrière financière au moins partiellement levée, l’influence de la situation matérielle des patients y soit moins marquée que chez ses voisins. Ce n’est pas le cas. Car un autre obstacle s’élève sur la route des personnes les plus défavorisées : le recours à la consultation en cas de symptômes ou au dépistage. De nets retards au diagnostic sont ainsi observés dans les milieux les moins favorisés, et les taux de participation aux campagnes nationales de dépistage (cancer du sein, du col de l’utérus et du colon) sont bien moins élevés au sein des populations les plus modestes.
« Vivre dans des conditions précaires peut conduire à placer la prévention au second plan, à minimiser ses symptômes et à repousser la consultation en ayant recours à l’auto-médicamentation. Mais la politique de prévention joue aussi un rôle important. Si le cancer du sein est très médiatisé, on entend par exemple beaucoup moins parler du cancer du côlon, pour lequel il existe pourtant un dépistage national, ou des cancers VADS. Pour ces derniers, des campagnes pourraient pourtant être menées, en expliquant par exemple qu’il faut consulter un médecin lorsqu’on a une lésion en bouche qui n’a pas cicatrisé au bout de trois semaines » explique Aurore Loretti. Et de fait, selon les chiffres OCDE 2023, le budget dépensé par la France pour la prévention est bien inférieur à la moyenne européenne5.
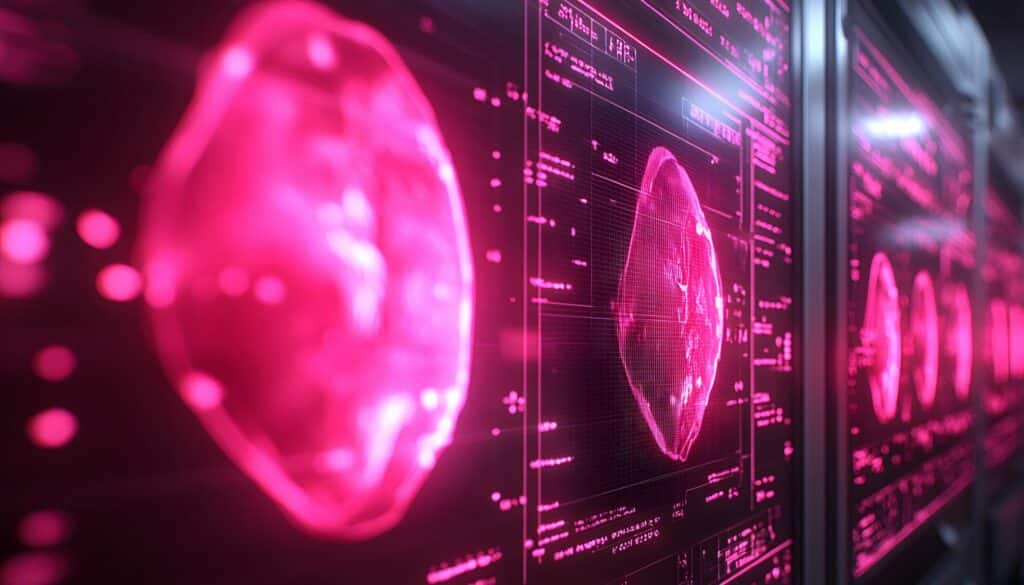
Post-diagnostic, d’autres difficultés viennent compliquer la poursuite des soins. En 2020, la France affichait un taux de médecins par habitant nettement inférieur à la moyenne de l’UE (3,2 pour 1 000 habitants contre 4 en Europe). Si cette pénurie affecte l’ensemble de la population, elle semble avoir des effets plus néfastes sur les personnes défavorisées, avec notamment des délais d’accès aux soins plus longs, comme le suggère l’enquête VICAN2 de 2014. On peut toutefois noter qu’entre 2017 et 2022, le nombre d’oncologues a augmenté de 30 % et le nombre de radiothérapeutes de 8 %6.
Les conditions matérielles d’existence pèsent également sur les décisions des malades comme sur les propositions de soin qui leur sont faites. « Certains patients repoussent des traitements car ils ne peuvent pas se permettre d’arrêter leur travail, d’autres reportent des soins le temps d’organiser la garde des personnes à charge, rendue plus difficile par la précarité des ressources financières. D’un autre côté, les médecins renoncent parfois à proposer des chirurgies lourdes à certains patients isolés ou très précaires, car ils redoutent un retour à la maison trop difficile » ajoute Aurore Loretti.
Les études montrent par ailleurs que tout au long du parcours de soin, les inégalités sont plus marquées chez les hommes que chez les femmes, surtout lorsqu’ils sont isolés. « Le fait d’être une femme, ou d’avoir des femmes dans son entourage immédiat, compense en partie le statut social. Les femmes sont plus familières avec l’idée de soin parce qu’elles sont souvent en charge de la santé de la famille, et ont bénéficié d’un suivi régulier en cas de grossesse » commente Aurore Loretti. Des données récentes7 montrent toutefois que si les (importantes) inégalités de mortalité constatées chez les hommes tendent à se réduire, elles augmentent au contraire chez les femmes. « Ici encore, la cause première est la consommation de tabac, qui a connu une nette augmentation chez les femmes, en particulier issues des milieux défavorisés, depuis les années 1970 » ajoute Gwenn Menvielle.
Après la maladie, un impact sur la qualité de vie
Peu d’études portent sur l’après-traitement, mais celles qui le font montrent que les inégalités sociales continuent à jouer un rôle important une fois le traitement achevé. Le cancer du poumon, socialement marqué, entraîne par exemple de plus grandes discriminations sociales et un retour au travail plus incertain8. Dans une étude récente9, Gwenn Menvielle et ses collègues se sont de leur côté intéressés à l’après-cancer du sein. L’équipe a suivi pendant 2 ans près de 6 000 patientes et évalué leur qualité de vie à partir d’un score tenant compte de plusieurs critères (fatigue, état général et état psychique, santé sexuelle, effets secondaires).
Au diagnostic, les différences de qualité de vie entre les deux extrêmes socio-économiques, évaluées à 6,7 étaient déjà significatives. Elles ont nettement augmenté pendant la maladie (score de 11), et se maintiennent à un niveau plus élevé qu’au diagnostic une fois les soins achevés (score de 10). Pour Gwenn Menvielle, « les raisons de ces différences ne sont pas à chercher du côté du traitement, similaire pour toutes les femmes. Elles viennent probablement des éléments de soutien autour de la prise en charge médicale : l’environnement familial susceptible d’apporter une aide au quotidien, et la capacité matérielle et financière à suivre des soins prolongeant le curatif pur, comme les séances de psychothérapie ou de kinésithérapie par exemple ». La chercheuse travaille ainsi aujourd’hui à analyser plus finement l’impact de ces facteurs.