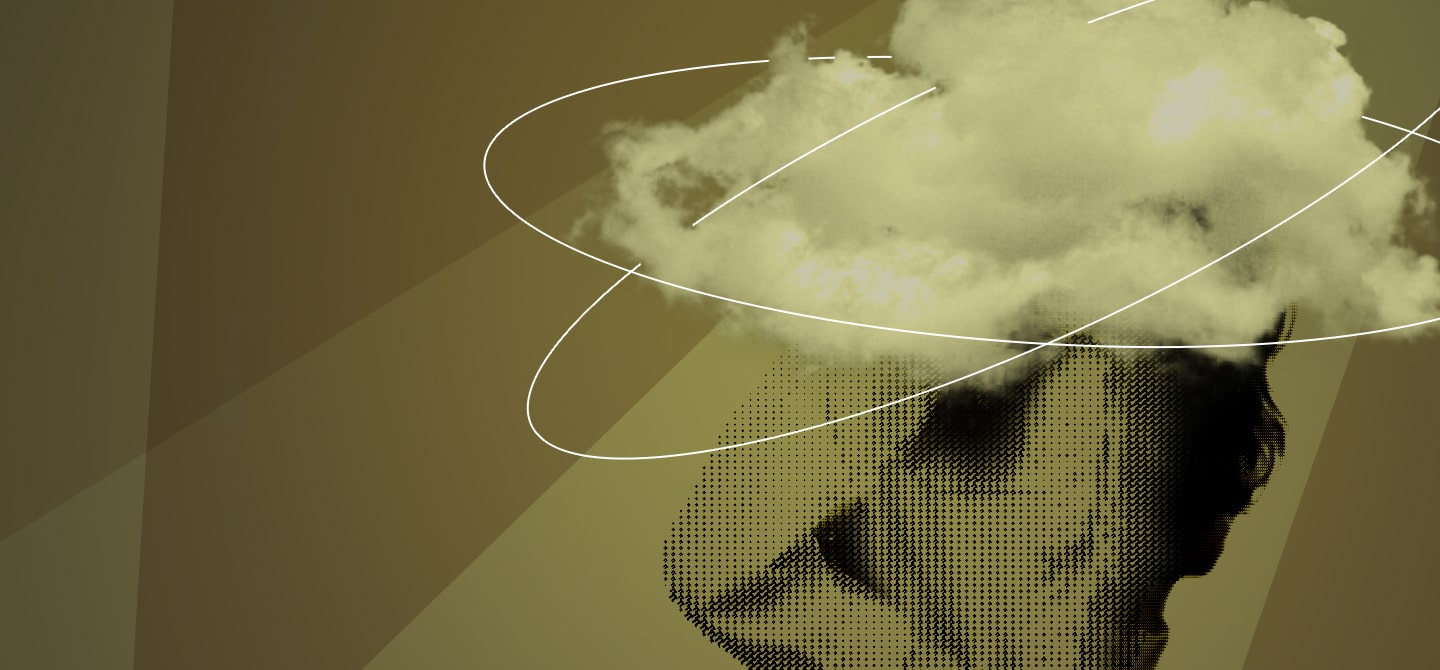Comment le LSD et la MDMA soignent-ils les troubles psychiatriques ?
- Depuis plusieurs années, les milieux médicaux et scientifiques s’intéressent à l’utilisation de substances psychédéliques pour traiter certains troubles mentaux.
- Le LSD et la psilocybine sont utilisés pour traiter des patients souffrant de dépression et/ou de troubles anxieux, avec ou sans problème d’addiction.
- Pendant leur voyage psychédélique, les patients voient généralement des souvenirs traumatiques remonter, mais dans un nouveau contexte.
- Les effets peuvent être spectaculaires, avec des symptômes qui se résorbent parfois après une ou deux séances.
- Le monde psychiatrique n’avait pas connu d’innovations telles depuis l’avènement des antidépresseurs dans les années 1960.
Le LSD, la psilocybine — principale substance psychoactive présente dans les champignons hallucinogènes — ou encore la MDMA deviendront-ils bientôt des traitements contre la dépression, l’addiction, ou les troubles obsessionnels compulsifs ? Les psychédéliques sont une famille de substances qui provoquent un état de conscience et de perception altérées. Ces substances psychoactives agissent sur les récepteurs de la sérotonine, surnommée « hormone du bonheur ». Longtemps diabolisées, car considérées comme dangereuses, ces drogues faisaient pourtant l’objet de plusieurs recherches à la fin des années 1940. Mais leur association avec les mouvements contestataires des années 1960 et 1970 a poussé les gouvernements à les interdire.
Depuis plusieurs années, la recherche scientifique s’intéresse de plus près aux effets du LSD ou de la psilocybine sur les maladies mentales, l’addiction ou encore pour l’accompagnement de patients en fin de vie. Les recherches et études se multiplient. Des psychiatres ont notamment analysé 25 travaux sur leur efficacité psychiatrique, sur les symptômes anxio-dépressifs, sur les troubles addictologiques et sur les troubles obsessionnels compulsifs (TOC). Leur conclusion est claire : « Les psychédéliques constituent des thérapeutiques prometteuses, d’efficacité rapide et durable, dont l’utilisation semble bien tolérée. » La Suisse, pays où le LSD a été synthétisé dans les années 1930, est pionnière dans cette démarche. Depuis trois ans, le professeur Daniele Zullino mène une thérapie par psychédéliques (LSD et psilocybine) à destination de patients souffrant de symptômes anxieux, addictifs et/ou dépressifs, au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève.
Quel rapport la communauté scientifique suisse a‑t-elle avec les traitements par substances hallucinogènes ?
Depuis une vingtaine d’années, nous assistons à une « renaissance psychédélique » en Suisse. La recherche n’a jamais vraiment arrêté, malgré la prohibition instaurée par le président Nixon en 1971. Il y a toujours eu des expériences, notamment à Zurich ou à Bâle, sur différentes substances. Et c’est au début des années 2000 que deux psychiatres, Peter Gasser et Peter Oehen, ont eu l’autorisation d’en faire des traitements, notamment destinés aux personnes en fin de vie. Puis, en 2014, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a décidé d’autoriser des traitements exceptionnels pour les médecins qui en faisaient la demande. La recherche est donc assez développée, avec une trentaine de médecins impliqués au cours des dernières années.
Quels patients prenez-vous en charge dans cette psychothérapie assistée par des psychédéliques ?
Nous traitons des patients suisses, qui ont derrière eux des années voire des décennies de dépression ou de troubles anxieux, grâce à de multiples effets thérapeutiques, qu’ils soient pharmacologiques ou psychothérapeutiques. Ces patients doivent être déjà suivis par des thérapeutes, mais faisant face à des blocages dans le traitement habituel : cette thérapie doit être un dernier recours, jamais une première intention. Plus de la moitié vient également avec un problème d’addiction. Il s’agit donc de patients pour lesquels on espère qu’un moment de pensée digressive, avec de nouvelles associations et le développement de certains schémas cognitifs, puisse relancer le processus psychothérapeutique. Ce n’est donc pas une pharmacothérapie dans le sens classique du terme, mais plutôt un traitement hors protocole d’étude : c’est un usage compassionnel.
Comment le traitement se déroule-t-il ?
Avant la première séance d’administration du LSD ou de la psilocybine, nous menons plusieurs entretiens d’évaluation permettant de faire toute l’investigation psychiatrique, l’historique du patient. Des séances de préparation ont ensuite lieu pour tout lui expliquer, lui faire visiter les locaux, et lui présenter le personnel. Nous évaluons aussi les motivations, les objectifs du traitement et les effets attendus. Le jour venu, le patient se présente à 8 h 30 et passe des tests psychométriques — une vérification de ses signes vitaux. Trente minutes après la prise de la substance, il va se coucher dans une pièce avec un masque sur les yeux et de la musique dans les oreilles. Commence alors le voyage psychédélique, pendant environ huit heures pour la psilocybine et douze heures pour le LSD. Le choix entre les deux substances est en grande partie laissé au patient, en fonction de la durée de l’effet et du prix (130 CHF la dose standard de 10 microgrammes de LSD et 440 CHF les 25 mg de psilocybine). Les effets recherchés sont superposables.
C’est une vraie innovation en psychiatrie, comme il n’y en avait plus eu depuis la découverte des antidépresseurs.
Le lendemain, la personne revient pour ce qu’on appelle la séance d’intégration, où l’on passe en revue tout ce qui s’est passé. Le patient note tout son vécu le plus précisément possible. Nous discutons de la manière dont ces expériences pourront être intégrées dans la vie quotidienne, dans la démarche psychothérapeutique. L’entretien est enregistré, pour que le patient puisse le réécouter seul et avec son thérapeute. Quatre semaines plus tard, un entretien d’amplification a lieu pour de nouveau faire le point et décider d’une potentielle nouvelle séance. Le traitement se fait en une à trois séances d’administration — sachant que certains patients répondent déjà très bien après une ou deux séances. Chaque séance doit cependant être espacée idéalement de deux à trois mois.
Pourquoi traiter ces patients avec du LSD et de la psilocybine ? Quelle est l’histoire de ces substances ?
Nous avons des données scientifiques qui soutiennent notre démarche pour la dépression résistante, pour les troubles anxieux en lien avec des maladies sévères, pour le traitement de l’alcool et du tabac, pour les TOC. Par ailleurs, il n’y a jamais eu d’effet secondaire sévère avec le LSD et la psilocybine. Et il n’y a aucune dépendance au LSD et à la psilocybine : c’était une invention de l’administration de Richard Nixon, président américain dans les années 1970. Car pour placer ces substances sur la liste des stupéfiants, il fallait qu’elles soient addictives et sans aucun intérêt thérapeutique. C’était à l’époque une décision politique pour combattre les groupes contestataires liés à la guerre du Vietnam, au mouvement des droits civiques mené par les Afro-Américains. Sinon, d’autres substances sont intéressantes, comme le DMT, la substance active dans l’ayahuasca, mais nous n’avons pas l’autorisation de les utiliser pour l’instant.
Qu’expérimentent généralement les patients lors de ces séances ?
Une des expériences classiques que vivent les patients, c’est l’apparition de certains souvenirs importants, qui ont été vécus de manière traumatisante, mais qui sont replacés dans un nouveau contexte, ce qui amène des signaux d’apprentissage. Ensuite, pour traiter les TOC, phobies ou claustrophobies, nous pratiquons aussi de l’exposition : le patient est emmené dans un ascenseur, et la réaction de panique ne se produit pas, car l’attention se porte sur autre chose. Cette situation, vue comme lourdement anxiogène pendant des années, est vécue d’une tout autre manière, et un processus bénéfique s’engage alors.
Les expériences où l’on observe les effets les plus spectaculaires sont les « challenging experiences », soit des expériences difficiles, des souvenirs ou des émotions qui ressurgissent de manière particulièrement douloureuse, avec une certaine anxiété à y faire face. Ces patients décrivent d’énormes changements dans les jours qui suivent.
Quels sont les effets que vous avez pu observer chez vos patients ?
Nous n’avons pas encore analysé toutes les données, mais l’impact est très positif. Après deux séances, la moitié des patients sont en rémission de leurs troubles, que ce soit l’addiction ou la dépression. Certaines personnes avec des décennies de traitement arrêtent les antidépresseurs, des patients souffrant de TOC voient leurs symptômes disparaître directement après une séance, d’autres traités pour la dépression reviennent un mois plus tard et ont totalement arrêté de boire et de fumer sans en avoir pris la décision. Bien sûr, dans certains cas, il n’y a pas énormément de changements. Mais nous sommes parfois surpris de l’effet spectaculaire, et c’est très motivant.
Où en est-on, selon vous, de l’utilisation de substances psychédéliques pour traiter les problèmes de santé mentale ?
La recherche se développe : l’Angleterre est assez active, des études sont effectuées en Allemagne et de la recherche pré-clinique en France, notamment à Amiens, a débuté. Il y a un véritable engouement. Pendant les congrès, les sujets autour des psychédéliques font salle pleine. C’est quelque chose de nouveau, car ce sont des traitements qu’on appelle disruptifs — qui ne sont pas continus —, quelque chose qu’on n’avait pas jusqu’à maintenant. C’est une vraie innovation en psychiatrie, comme il n’y en avait plus eu depuis le début des années 1960 avec la découverte des antidépresseurs. Tout le monde s’attend à une grande révolution.
Comment voyez-vous le futur de ce type de thérapie ?
Nous aurons probablement une accélération du développement de ces traitements avec les premières autorisations de la psilocybine aux États-Unis qui devraient arriver d’ici un ou deux ans. Il y a un énorme engouement de la part des start-ups : cela aura un effet boule de neige. Dans dix ans, ce sera un traitement bien implanté, qui ne va certainement pas faire disparaître la dépression ou les addictions, mais qui va prendre une certaine place dans l’arsenal thérapeutique. Le grand enjeu, c’est de l’intégrer dans les modèles psychothérapeutiques actuels. Mais on est au tout début de la démarche, parce qu’on ne peut pas repartir de ce qui a été acquis dans les années 1960 : la méthodologie scientifique n’était pas la même. Il s’agit donc de voir comment on combine les techniques psychothérapeutiques avec l’effet de ces substances pour en tirer le maximum de bénéfices.