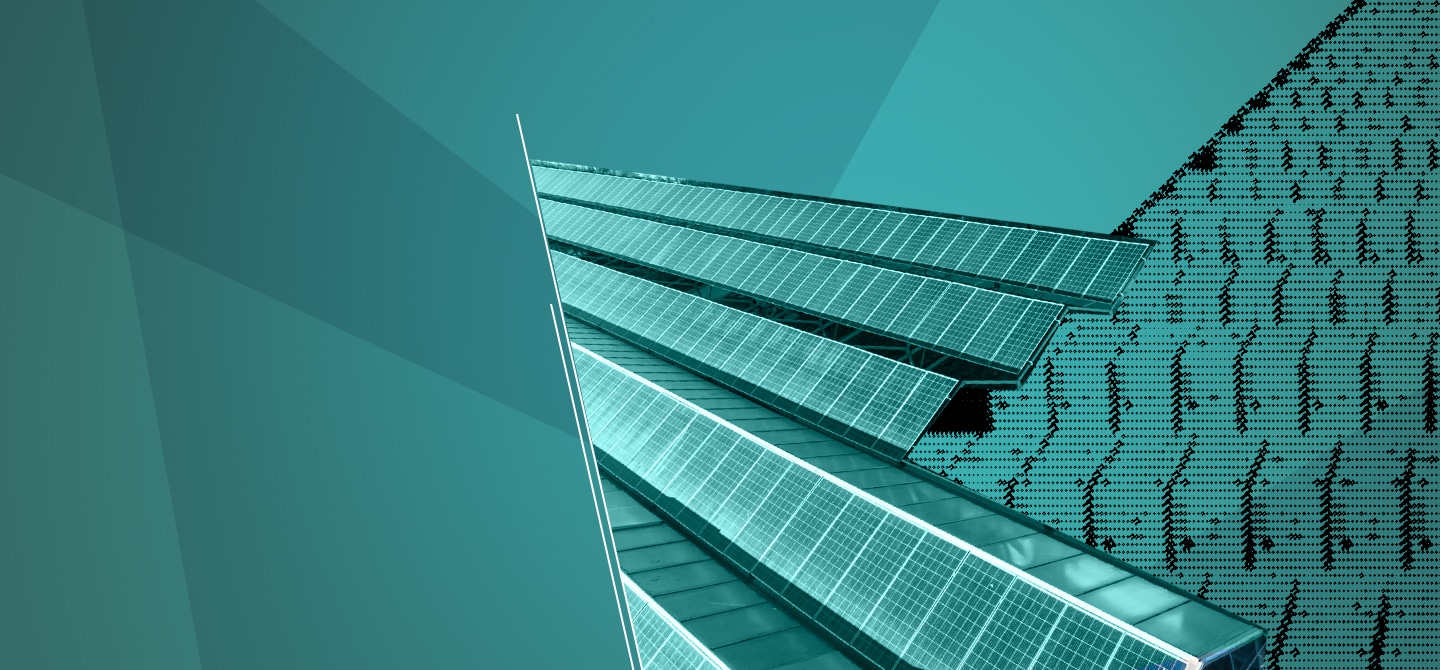À quoi ressemblera donc l’avenir de l’humanité ? Survivrons-nous aux prochains siècles en ayant des descendants semblables à ce que nous sommes aujourd’hui ? Ou bien des améliorations biologiques et technologiques nous permettront de porter des membres mécaniques plus forts et plus maniables, tout en améliorant notre génétique pour augmenter autant nos performances cognitives que nos vies, qui seront plus longues et plus saines ?
Les avancées scientifiques, de l’informatique à la biotechnologie, font que ce futur et les défis éthiques qu’il engendre méritent d’être pris en considération. Mais elles signifient aussi que ceux qui sont prêts à aller plus loin (et parfois à prendre des risques importants) peuvent essayer d’augmenter leur propre corps depuis chez eux. Examinons quelques-unes des prédictions, promesses, périls et caractéristiques du biohacking, et voyons ce qu’il en advient.
Développer de meilleurs bébés
Avec une quantité presque inépuisable de titres suggérant que les scientifiques ont trouvé le « gène de » ceci ou de cela, allant de maladies complexes à des traits de caractère, il est difficile de se défaire de ce sentiment que notre destin est écrit dans notre ADN. Alors, pourrions-nous réécrire cet ADN et améliorer tous les aspects de notre vie, de la santé à l’intelligence ?
Cette idée a pris racine au début du 20e siècle, lorsque les techniques de sélection similaires à celles qui nous ont permis d’optimiser les animaux d’élevage et les cultures ont été, étonnamment, largement acceptées pour être utilisées sur les êtres humains. Les politiques eugéniques ont été promues par des hommes politiques, de Winston Churchill à William Beveridge, et étudiées par des géants de la statistique et de la génétique comme Francis Galton et même Francis Crick, l’un des découvreurs de la structure de l’ADN. Bien que les crimes horribles des nazis aient entaché la réputation de ce domaine, l’eugénisme s’est adapté et a survécu, en minimisant les liens manifestes avec la race et le contrôle coercitif des naissances, et en mettant l’accent sur la liberté individuelle et l’importance de l’État-providence pour maximiser le potentiel humain par d’autres moyens que l’hérédité pure.
Alors même que le déclin politique de l’eugénisme se poursuivait, la science moderne nous a montré que l’ensemble de l’édifice reposait sur des fondations fragiles : la plupart des traits et des maladies pour lesquels nous pourrions vouloir opérer une sélection sont incroyablement complexes d’un point de vue génétique. Malheureusement, pour ces gros titres promettant un « gène pour » quelque chose, la plupart des traits d’intérêt sont hautement « polygéniques », avec des centaines ou des milliers de gènes agissant en lien les uns avec les autres ainsi qu’avec l’environnement pour créer une prédisposition — ce qui n’est même pas une certitude ! — pour qu’une caractéristique donnée se manifeste.
Il s’agit non seulement d’un dilemme impossible pour les parents, mais il illustre l’autre problème du dépistage génétique en tant que politique sociale.
Même la couleur des yeux, dont on nous apprend à l’école qu’elle est héritée de manière très simple, est prédite de manière non déterministe par environ 16 gènes ; la taille est expliquée par environ 10 000 variantes génétiques réparties sur environ 30 % de notre ADN, auxquelles s’ajoutent le régime alimentaire et d’autres facteurs dans la jeunesse. L’intelligence est à la fois plus difficile à quantifier et, même si nous prenons le QI comme une approximation fiable, elle est encore moins bien comprise d’un point de vue génétique. Il se peut que nous ne soyons même pas capables de sélectionner avec certitude la couleur des yeux, alors pour l’intelligence, n’en parlons pas.
Cela n’a pas empêché des entreprises de proposer des services qui pourraient permettre aux parents de choisir un futur enfant sur la base de prédictions génétiques des capacités cérébrales. Le dépistage de problèmes génétiques graves chez les bébés en développement est déjà courant, mais des entreprises proposant des tests génétiques plus complets ont déjà fait leur apparition. Connus sous le nom de « diagnostics génétiques préimplantatoires » (DPI), les couples qui ont recours à la FIV peuvent prélever un échantillon de quelques cellules seulement sur un ensemble d’embryons se développant dans une éprouvette. Ce qui permet de tester leur ADN pour détecter le risques de maladies telles que le cancer et le diabète — ainsi que l’intelligence.
La société américaine Genomic Prediction propose un certain nombre de services sous sa marque LifeView, dont une version de luxe appelée PGT‑P : T pour « testing » et P pour « polygenic ». Les scores de risque polygénique sont calculés à l’aide d’une technique statistique qui recherche des associations entre des changements à des centaines d’endroits de notre ADN et les risques de pathologies spécifiques. Bien qu’il s’agisse d’une science fascinante au niveau de la population pour comprendre comment les maladies se développent, elle présente plusieurs lacunes pour prédire la santé future des enfants à naître. La principale est que ces associations sont purement statistiques — souvent, les gènes utilisés pour prédire le risque ne sont pas liés de manière causale à la maladie en question : par exemple, si vous avez un risque plus faible de cancer, il se peut que vous sélectionniez involontairement un embryon présentant un risque plus élevé d’une autre maladie pas mesurée par le test.
L’autre problème est que les futurs parents seront presque toujours obligés de faire un compromis : même si l’on prend les résultats au pied de la lettre, l’embryon le plus intelligent aura peut-être aussi le risque le plus élevé de développer un cancer. Il s’agit non seulement d’un dilemme impossible pour les parents, mais il illustre l’autre problème du dépistage génétique en tant que politique sociale. Même si les tests offraient une certitude (ce qui n’est pas le cas), nous serions contraints de décider si une maladie ou un trait de caractère vaut plus qu’un autre pour les générations futures qui pourraient ne pas partager notre point de vue — que se passerait-il si nous choisissons de réduire le risque d’une maladie qui sera guérie à l’avenir au détriment d’une autre qui ne le sera pas ?
Biohacking
Si nous ne sommes pas à l’aise pour choisir l’ADN avec lequel nous commençons notre vie, peut-être serions-nous plus disposés à modifier notre patrimoine génétique en tant qu’adultes consentants ? CRISPR et d’autres technologies de modification génétique facilitent considérablement ce processus, tant pour les scientifiques et les médecins, qui utilisent des thérapies de première génération pour guérir des maladies génétiques mortelles, que pour les « biohackers de garage » qui cherchent à modifier leur propre biologie à la maison.
Le biohacker Josiah Zayner, qui dirige une entreprise fournissant des kits de modification de l’ADN, s’est, par exemple, injecté devant la caméra un produit destiné à modifier sa génétique, censé renforcer les muscles, grâce à la technologie CRISPR. Le fait qu’il s’agisse même d’une préoccupation plausible montre à quel point la technologie a progressé, mais la modification de l’ADN par soi-même comporte de sérieux risques. Tout d’abord, il se peut qu’elle n’ait tout simplement rien fait : l’introduction d’une machine d’édition de l’ADN dans un nombre suffisant de cellules pour impacter significativement la biologie d’un être humain adulte est un travail en cours. De plus, la plupart des modifications génétiques se font actuellement en dehors du corps humain, en extrayant certaines cellules et en les modifiant en laboratoire dans des conditions contrôlées. Le plus grand risque, si cela fonctionne, pourrait être le cancer dû à des modifications génétiques « non ciblées ». Ce type de biohacking extrême est donc très risqué, et les avantages éventuels sont très difficiles à quantifier — d’ailleurs, Zayner dit regretter d’avoir donné un exemple aussi audacieux.

Le deuxième type de biohacking consiste à fusionner la biologie humaine avec des implants technologiques. Elon Musk a co-fondé Neuralink, une entreprise qui fabrique des interfaces cerveau-ordinateur, avec l’objectif à long terme de permettre une « fusion de l’intelligence biologique et de l’intelligence de la machine ». Il espère que ce sera la solution pour aligner l’intelligence artificielle sur les intérêts humains, en donnant aux humains une interface directe pour s’assurer que les progrès de l’IA augmentent nos désirs plutôt qu’ils ne s’y opposent.
Cependant, malgré de grandes déclarations et même l’approbation d’un essai clinique par la FDA, Neuralink reste du vaporware. Musk a promis de « s’attaquer aux lésions cérébrales ou aux lésions de la colonne vertébrale et de compenser toute capacité perdue par une personne grâce à une puce », mais jusqu’à présent, la démonstration la plus médiatisée de l’entreprise en 2021 a été celle d’un singe jouant au jeu « Pong » avec son esprit.
D’autres implants bioniques semblent avoir fait parler d’eux non pas parce qu’ils représentent des avancées techniques considérables, mais plutôt parce qu’ils paraissent bizarres et peu convaincants. Une société, Biohax International, a implanté des « biopuces » d’identification chez quelques milliers de clients. Les cas d’utilisation vont du fait de ne plus avoir à se soucier de perdre ses clés à la possibilité de payer ses courses d’un simple geste du bras. Il semble que la plupart d’entre nous préfèrent laisser un double des clés à un voisin ou utiliser leur téléphone pour payer plutôt que de subir une intervention chirurgicale, même mineure.
D’autres biohackers essaient d’utiliser des interventions médicales plus conventionnelles pour optimiser leur corps. Ces interventions vont de l’utilisation de suppléments à celle de médicaments approuvés sans étiquette, comme la rapamycine, pour optimiser sa santé ou ses capacités cognitives. Il existe des dizaines d’entreprises qui proposent toutes sortes de produits : allant des suppléments aux preuves douteuses aux pharmacies en ligne qui vous envoient des médicaments sans ordonnance — sans aucun moyen de vérifier qu’ils sont bien ce qu’ils prétendent être, ni même qu’ils sont correctement dosés, et ainsi de suite.
Qu’il s’agisse d’infections dues à un implant qui a mal tourné ou de problèmes liés aux effets secondaires d’un médicament ou d’un complément alimentaire, la médecine autodidacte s’accompagne d’une mise en garde en matière de santé.
Une échelle variable
La plupart des idées d’amélioration humaine se situent sur une échelle variable (ou peut-être sur une pente glissante, selon votre point de vue) : à mesure que ces technologies approchent de la faisabilité et de l’adoption à grande échelle, pourraient-elles simplement cesser d’être considérées comme du « biohacking » et devenir de la médecine normale ou de la technologie de tous les jours ?
Lorsque l’on considère que l’implantation d’une puce d’identification dans la main est une pratique dangereuse et excentrique, il est facile d’oublier que les interfaces homme-technologie sont déjà utilisées au quotidien. Les stimulateurs cardiaques modernes dotés d’une puce qui maintiennent le rythme cardiaque, ou les implants cochléaires qui relient un microphone externe au cerveau et donnent à certaines personnes sourdes la capacité d’entendre, par exemple. De même, les moniteurs de glucose implantables sont de plus en plus disponibles pour les diabétiques, car ils constituent une alternative plus confortable et plus pratique aux tests par piqûre au doigt ou aux dispositifs « MGC » externes.
Il est facile d’imaginer que les limites deviennent plus floues au fur et à mesure que la technologie progresse.
Il est facile d’imaginer que les limites deviennent plus floues au fur et à mesure que la technologie progresse. Beaucoup d’entre nous portent déjà des montres intelligentes qui surveillent notre rythme cardiaque et qui comptent nos pas. Des versions implantables sensibles à la chimie du sang pourraient-elles diagnostiquer des maladies ou donner des conseils en matière de régime alimentaire et d’exercice physique dans les dix ou vingt prochaines années ? S’agit-il de biohacking ou d’une continuation de l’innovation médicale et technologique de ces dernières années ?
De même, la frontière entre les traitements génétiques et les améliorations n’est pas absolue. La plupart des gens conviendraient qu’il est acceptable d’utiliser la thérapie génique pour corriger un gène à l’origine d’une maladie génétique potentiellement mortelle, même si elle ne l’est pas dans tous les cas. Est-il acceptable de réduire de 50 % le risque de décès par maladie cardiaque chez une personne présentant un risque génétique élevé ? Qu’en est-il d’une réduction de 10 % chez une personne ne présentant aucun facteur de risque génétique manifeste ? Et si l’on améliore en même temps les capacités athlétiques de ces personnes ? Où tracer la ligne entre le traitement et l’amélioration, et dans quelle mesure sommes-nous à l’aise avec cette dernière ? Ce sont des questions importantes, et la délimitation deviendra de plus en plus compliquée au fur et à mesure que la technologie d’édition des gènes deviendra plus sûre et plus puissante — peut-être même suffisamment sûre pour qu’un jour nous puissions tous modifier notre ADN depuis chez nous.