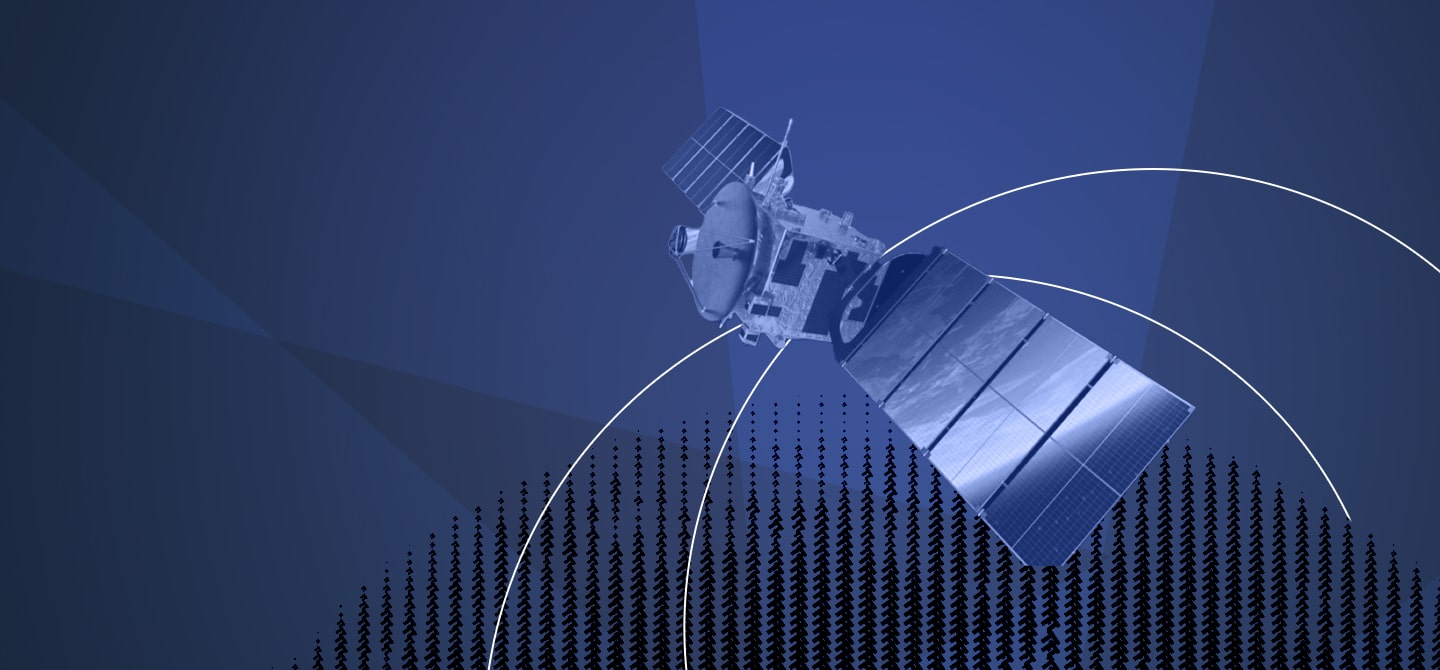Plastique et recyclage : une relation toxique ?
- Le recyclage du plastique est un enjeu identifié comme majeur par le gouvernement français, afin d’améliorer les connaissances et techniques en vue de sa réutilisation.
- Selon un rapport, jusqu’à 16 000 différents produits chimiques peuvent être utilisés dans le plastique, dont un certain nombre sont potentiellement nocifs.
- En France, moins d’un tiers des déchets plastiques post-consommation est collecté, et seulement 14 % d’entre eux sont effectivement recyclés.
- La réutilisation du plastique heurte à des limitations techniques : impossibilité de trier certains matériaux, problèmes environnementaux, manque de connaissances...
- Pour un recyclage plus efficace, il s’agit de réduire les types de plastique utilisés à ceux qu’on sait recycler, limiter le nombre de produits chimiques utilisés, etc.
Le recyclage des matériaux que nous produisons et consommons est un enjeu identifié comme majeur par le gouvernement français. Il fait l’objet d’un Programme et Équipement Prioritaire de Recherche (PEPR) financé par France 20301. Les plastiques, en particulier, bénéficient d’un axe de recherche dédié. L’objectif affiché étant d’améliorer les connaissances et les techniques permettant leur réutilisation, afin de préserver les ressources. En effet, les plastiques se retrouvent partout : emballages, textiles, cosmétiques… Versatiles à souhait, il se sont « incorporés dans nos pratiques de production et de consommation en se présentant comme substitut aux matériaux naturels », observe Baptiste Monsaingeon, sociologue et maître de conférence à l’université Reims Champagne-Ardenne. Avec les limites que l’on connaît aujourd’hui.
Un concentré de substances problématiques
Pour commencer, les briques qui les constituent sont principalement obtenues à partir de combustibles fossiles (le pétrole et le gaz), et assemblées en une longue chaîne : le polymère. De nombreuses substances sont utilisées pour le synthétiser. Certaines permettent d’optimiser la réaction chimique, elles ne sont donc pas destinées à se retrouver dans le produit fini, pourtant une partie est absorbée par le plastique. D’autres sont utilisées pour conférer des propriétés spécifiques au matériau : souplesse, couleur, résistance aux UV ou au feu…
Selon le rapport de PlastChem2, jusqu’à 16 000 différents produits chimiques peuvent être utilisés dans le plastique. Un certain nombre d’entre eux étant potentiellement nocifs. « Il y en a 10 000 environ pour lesquels nous manquons de données. Et plus de 4 000 dont nous savons qu’ils présentent des dangers », alerte Bethanie Carney Almroth, professeure d’écotoxicologie à l’Université de Gothenburg en Suède. « Ils peuvent être cancérigènes, perturber le système endocrinien, ou être toxiques pour certains organes spécifiques comme les reins ou la peau. »
La gestion des déchets plastiques est d’autant plus un enjeu que ceux-ci ont imprégné notre environnement. C’est ce que constate Florian Pohl, chercheur en géosciences à l’Université de Bayreuth en Allemagne, lorsqu’il étudie les plastiques dans les systèmes fluviaux et marins. « À 4 000 mètres de profondeur, si je prélève des sédiments du plancher océanique, je peux détecter des microplastiques. C’est effrayant car ça montre qu’ils sont littéralement partout », s’inquiète-t-il.
Recycler pour mieux consommer
« Depuis 30 ans, énormément d’énergie et de moyens économiques ont été consacrés au développement des filières de recyclage, dans l’idée de concilier soutenabilité et croissance économique », résume Baptiste Monsaingeon. En France, les collectivités territoriales sont responsables de la gestion de nos déchets. Dans la majorité des cas, celle-ci est déléguée à des opérateurs privés qui s’occupent de collecter le contenu de nos poubelles et des déchetteries pour les envoyer en centres de tri. C’est là-bas que les éléments sont séparés en fonction de leur possible utilisation : production d’énergie par incinération (« valorisation énergétique ») ou recyclage (« valorisation matière »). À défaut, ils seront destinés à l’enfouissement.
Il existe une vingtaine de filières de gestion des déchets en France. Elles sont organisées sur le principe de la « responsabilité élargie des producteurs3» (REP) : les professionnels qui mettent sur le marché des produits (emballages, textiles, équipements…) ont la charge de financer ou de gérer leur retraitement après consommation par les usagers. « Pour les papiers, cartons et métaux, cela fonctionne plutôt bien, estime Baptiste Monsaingeon, concernant les plastiques, c’est essentiellement le PET de nos bouteilles d’eau qui est recyclé. »

En France, selon les chiffres de l’ADEME4, moins d’un tiers des déchets plastiques post-consommation est collecté, et seulement 14 % d’entre eux sont effectivement recyclés. Baptiste Monsaingeon rappelle qu’en 2018 « le gouvernement s’était fixé pour objectif “100 % de recyclage des emballages plastiques en 2025”. On est loin du compte ».
Des cycles semés d’embûches
La réutilisation se heurte en effet à plusieurs limitations techniques. Les produits finis sont des assemblages complexes de différentes matières qu’il n’est pas toujours possible de trier. Le recyclage « mécanique » nécessite de séparer les plastiques en polymères de même type. Il faut ensuite les laver et les broyer sous forme de paillettes qui seront fondues en granulés pour faire de nouveau du plastique. Avec à la longue une dégradation des polymères. « Cette longue chaîne de molécules peut se rompre et commencer à se raccourcir à mesure qu’elle est chauffée et fondue. La qualité du matériau se détériore, il faut ainsi ajouter du plastique neuf pour la maintenir, explique Bethanie Carney Almroth. Finalement, il peut y avoir une augmentation des quantités de substances toxiques dans les plastiques à mesure qu’ils sont recyclés56», ajoute-elle.
Le recyclage « chimique », quant à lui, propose des méthodes pour séparer chimiquement les polymères ou les décomposer en molécules de base, qui pourront servir à recréer du plastique. « Certaines d’entre elles ont montré une efficacité, mais à petite échelle seulement, sur des déchets préindustriels qui sont beaucoup plus purs que ceux issus de la consommation », tempère-t-elle. Elles ne sont donc pas viables d’un point de vue économique et environnemental pour des plastiques mélangés.
Enfin, il reste des plastiques que l’on ne sait pas bien recycler. « Les filières ne couvrent pas l’intégralité du gisement de déchets en France, précise Baptiste Monsaingeon. Certains acteurs cherchent donc à exporter, avant tout vers l’Europe. » Ceci peut être une première étape dans le transit des flux de matières plastiques : « La Turquie est par exemple un lieu où sont exportés des déchets plastiques, de façon plus ou moins légale », confie-t-il.
Un cercle pas si vertueux
Or, s’il se veut vertueux, le retraitement des plastiques reste une source de pollution. « Nous savons que les usines de recyclage libèrent des microplastiques et des produits chimiques lors de la fragmentation ou du broyage de ces déchets7 », souligne Bethanie Carney Almroth. Sans compter que de nombreux plastiques sont mis en décharges. « Cela peut évidemment entraîner une contamination de l’environnement, mais aussi de l’homme », conclut-elle avant d’ajouter que « 80 % du recyclage mondial passe par les mains des ramasseurs de déchets, la grande majorité travaillant sans protections contre cette exposition8 ».
La mauvaise gestion des déchets contribue également à la diffusion de plastique dans l’environnement. À cause du stockage à l’air libre, à la merci du vent, ou encore pendant le transport, comme le décrit Florian Pohl : « Certains granulés de plastique servant de matière première peuvent se déverser dans les eaux des rivières[pi_note]Karlsson, T. M., Arneborg, L., Broström, G., Almroth, B. C., Gipperth, L., & Hassellöv, M. (2018). The unaccountability case of plastic pellet pollution. Marine Pollution Bulletin, 129(1), 52‑60. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.01.041[/pi_note]. » Entraînés par les courants, ils sont abrasés par les sédiments et décomposés en fragments toujours plus petits. Ceci augmente la surface de diffusion : les additifs s’en échappent de plus en plus rapidement. « Toujours plus de plastique se retrouve dans l’environnement, et nous n’en connaissons pas vraiment les conséquences : à quelle vitesse les substances qu’ils contiennent se libèrent et avec quels effets ? » Une question au centre de ses recherches.
Repenser la production du plastique
Pour Baptiste Monsaingeon : « Croire au recyclage c’est un peu croire à une promesse : celle de continuer à consommer en bonne conscience. » Pour autant, « il est possible de lui redonner sa place sans l’ériger en solution magique », nuance-t-il. À commencer par réduire les types de plastique utilisés à ceux que l’on sait recycler, et à limiter le nombre produits chimiques utilisés. « Les additifs apportent des fonctionnalités, mais on peut les ramener à un nombre beaucoup plus restreint, éviter les substances dangereuses, et renforcer la législation », suggère Bethanie Carney Almroth.
C’est un champ qui appelle l’innovation, afin de développer des matériaux plus durables et sûrs. Toutefois, il ne s’agit pas de simplement remplacer un matériau par un autre, mais de réduire la production de plastique vierge. « Cela fait consensus pour la communauté scientifique internationale, quelle que soit la discipline », insiste Baptiste Monsaingeon.
Cela passe notamment par la mise en place de nouvelles infrastructures permettant de rendre plus accessible le réemploi avec des contenants réutilisables et rechargeables. « En France, un certain nombre d’entreprises travaillent dans ce domaine910, commente Bethanie Carney Almroth. Cela montre qu’il y a matière à la mise en place de nouveaux modèles économiques », au-delà du recyclage et de la production effrénée de plastique.