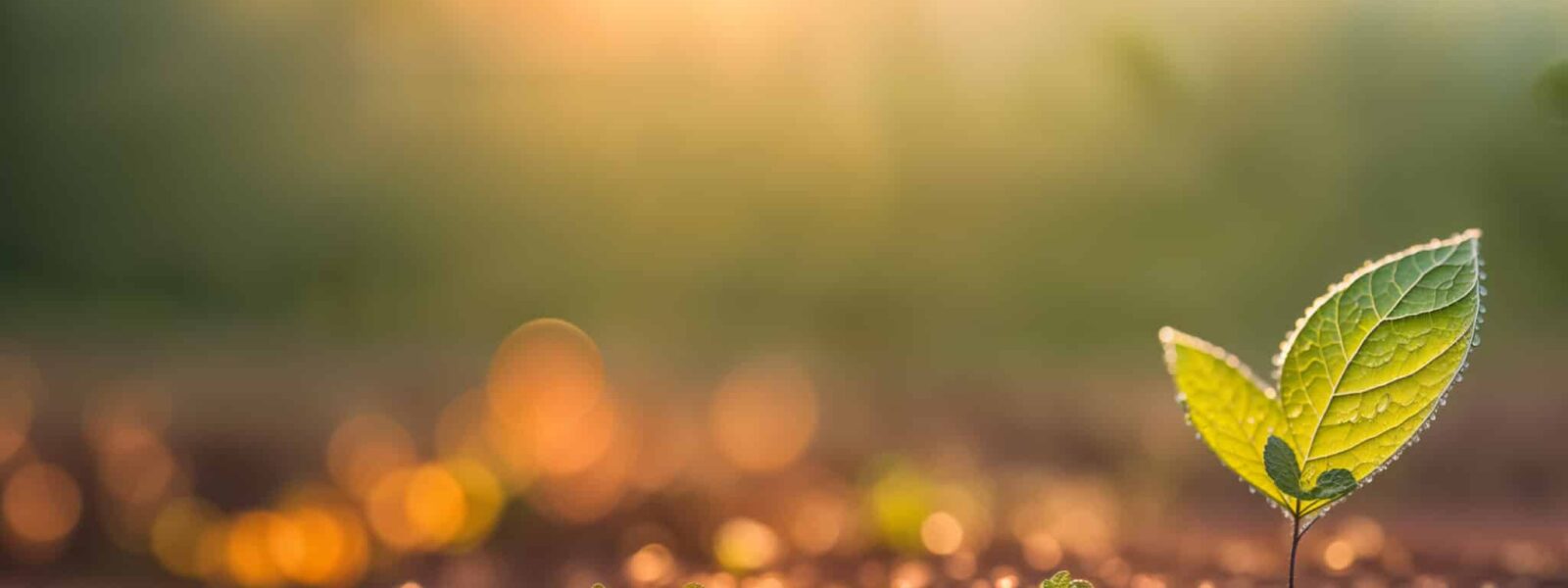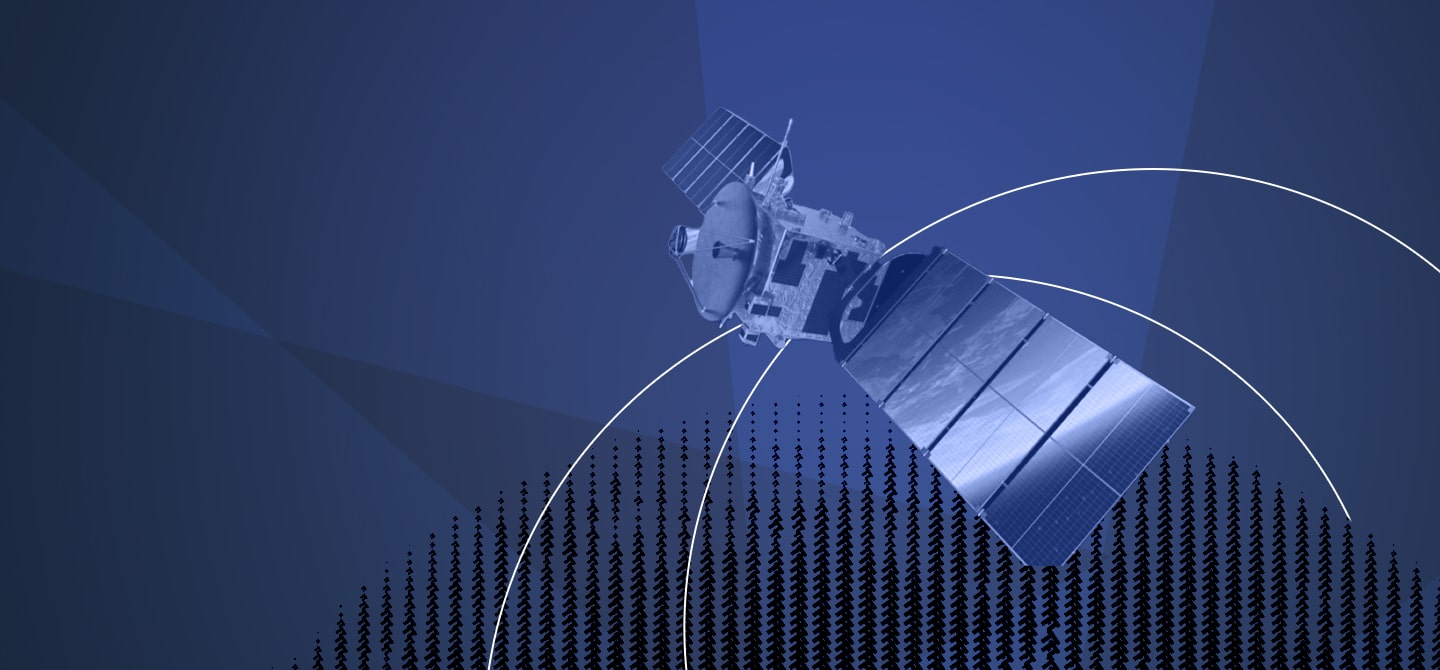Phytoextraction : ces plantes qui nettoient les sols pollués
- Les activités minières et métallurgiques dégradent et érodent fortement les sols, ce qui empêche les végétations de s’y développer.
- Il est possible de restaurer les écosystèmes en utilisant la phytoextraction : certaines plantes extraient les éléments métalliques du sol et les stockent dans leurs feuilles.
- Cette technique est peu coûteuse, crée une économie circulaire et permet de réhabiliter les sols dans une démarche de restauration écologique.
- Mais la phytoextraction possède certaines limites, comme la durée totale du procédé ou les capacités naturelles des plantes.
- Le même procédé est développé pour la dépollution de l’eau, à l’aide de plantes aquatiques : c’est la rhizofiltration.
Vous travaillez sur la dépollution, pouvez-vous nous en dire plus sur les procédés que vous développez ?
Nous restaurons des écosystèmes terrestres et aquatiques en utilisant des plantes accumulatrices d’éléments métalliques. Les activités minières et métallurgiques dégradent fortement les sols, aucune végétation ne peut s’y développer. Ces sols nus sont fortement érodés : les poussières chargées en éléments métalliques s’envolent ou sont emportées par lessivage dans les cours d’eau, polluant l’environnement proche. La restauration ne se limite pas à la dépollution : la réintroduction durable de plantes adaptées est une priorité pour limiter la dispersion des polluants.
De quelles plantes parlez-vous ?
Nous avons étudié de nombreuses plantes terrestres tolérantes et hyperaccumulatrices d’éléments métalliques : le tabouret des bois (Noccaea caerulescens), un écotype de la vulnéraire (Anthyllis vulneraria) ou encore des arbres tels que Geissois pruinosa et Grevillea meisneri en Nouvelle-Calédonie. Chacune réalise un processus naturel de phytoextraction : elles extraient les éléments métalliques du sol par leurs racines et les transportent dans la sève jusqu’à les stocker dans leurs feuilles en très grande concentration. Dans le Gard, la vulnéraire stocke plus de 17 000 ppm de zinc. Nous estimons que si la couverture végétale atteint 70 %, 27 kg de zinc par hectare peuvent être potentiellement extraits du sol à chaque récolte1. En Nouvelle-Calédonie, les récoltes d’un seul arbre de Grevillea meisneri comptent 2,5 kg de biomasse contenant plus de 10 000 ppm de manganèse2.
Quel est l’intérêt écologique pour ces plantes à stocker de grandes quantités de métaux ?
Plusieurs théories sont explorées. Pour Noccaea caerulescens, c’est qu’elle ne résiste pas bien à la compétition et se fait très vite envahir par les plantes environnantes. Dans ces environnements pollués, elle est la seule à survivre. Par ailleurs, elle se défend classiquement des herbivores en libérant des composés toxiques, les glucosinolates. Quand elle est riche en zinc, la plante diminue corrélativement la production de glucosinolates : c’est une façon indirecte de se protéger des herbivores3.

Pourquoi est-il nécessaire de développer de nouvelles solutions de réhabilitation ?
Les solutions disponibles ne sont pas satisfaisantes. L’une d’entre elles consiste à confiner la pollution en recouvrant le sol par des matériaux. Or la pollution continue à se propager dans les nappes phréatiques au gré des infiltrations d’eau. La deuxième solution est très coûteuse : elle consiste à excaver les terres contaminées pour les traiter chimiquement dans des usines appropriées. Cela génère un nouveau déchet : le décontaminant associé aux métaux…
En quoi les procédés utilisant les plantes sont-ils plus satisfaisants ?
La phytoextraction est efficace, peu coûteuse et permet de réhabiliter les sols dans une démarche de restauration écologique : il s’agit d’une vision long terme. Et surtout, elle crée une économie circulaire ne générant aucun déchet. Pour reprendre l’exemple de la Nouvelle-Calédonie, les litières des arbres hyperaccumulateurs de manganèse ou de nickel sont récoltées et transformées en matière minérale grâce à des procédés sobres et directs. Les métaux sont utilisés en tant que catalyseurs, appelés écocatalyseurs. Ils remplacent ceux classiquement utilisés pour la synthèse de médicaments par exemple, dont un grand nombre est mis en défaut par la réglementation européenne de la chimie (REACH)4. La valorisation écoresponsable de ces plantes est au cœur de nos développements : seule cette retombée économique soutient les efforts de restauration dans la durée.
La dépollution par phytoextraction ne présente-t-elle pas certaines limites ?
Si l’objectif est de dépolluer le sol, cela peut être long : dans le Gard, l’Ademe estime que la dépollution totale des anciens bassins de décantation prendrait 50 ans. De plus, ces techniques ne sont pas généralisables : chaque plante est choisie en lien avec son habitat naturel. Il est inconcevable d’installer une plante hyperaccumulatrice de Nouvelle-Calédonie en métropole. En Oregon, l’implantation d’une espèce d’origine européenne a conduit à une situation catastrophique, elle est devenue envahissante. Enfin, les possibilités sont limitées par les capacités naturelles des plantes. Il existe de nombreuses espèces capables d’accumuler le nickel, le zinc ou le manganèse. En revanche les capacités sont limitées – voire impossibles – pour d’autres éléments comme l’arsenic, le cobalt ou le cuivre.
Ces limites nous ont poussés à développer un autre procédé de dépollution concernant l’eau. C’est une ressource très importante à préserver, mais pourtant polluée par de nombreuses activités humaines.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce nouveau procédé ?
Il repose sur la rhizofiltration et la biosorption. Nous utilisons des plantes aquatiques capables de séquestrer des métaux dans leurs racines. Elles sont très performantes : elles disposent d’antennes moléculaires qui captent les éléments nutritifs dilués dans l’eau… et aussi les polluants métalliques.
L’utilisation de plantes mortes est une avancée majeure dans le traitement de l’eau : elles conservent leur capacité de dépollution, mais cela rend le procédé industrialisable. Les racines sont broyées et transformées en poudre végétale, puis placées dans une colonne dans laquelle l’eau circule. Les métaux sont ainsi séquestrés par la poudre. Nous avons démontré la bonne performance de ces filtres végétaux pour traiter des effluents miniers en France pollués au zinc, au fer et à l’arsenic. Le procédé est également adapté à l’industrie chimique pour capter les effluents en sortie de réacteurs. Au laboratoire, nous expérimentons le traitement de polluants organiques redoutables comme la chlordécone, et nos résultats sont très concluants5.
L’économie circulaire a‑t-elle aussi une place importante pour la dépollution de l’eau ?
Bien sûr ! Les filtres végétaux chargés en éléments métalliques sont là encore transformés en écocatalyseurs. L’atout majeur ? Les plantes aquatiques captent certaines terres rares ou éléments d’intérêt comme le palladium. Cette ressource est stratégique : le plus gros producteur actuel est la Russie et de nombreuses industries l’utilisent massivement (électronique, automobile, pharmaceutique). Son recyclage est devenu une priorité, et les filtres végétaux le permettent6. Avec BioInspir, nous commercialisons des molécules d’intérêt – fragrances et solvants – 100 % biosourcées, fabriquées à l’aide de ces écocatalyseurs sans intrants chimiques. Elles sont utilisées en cosmétique, parfumerie et chimie fine. L’écocatalyse est l’opportunité de revisiter la chimie en limitant au maximum son empreinte environnementale7.
Nous avons même poussé le cercle vertueux encore plus loin… Les plantes exotiques envahissantes sont l’une des principales menaces pour la biodiversité dans le monde. Or nombre d’entre elles sont utilisées dans nos procédés : renouée asiatique, jussie d’eau, laitue d’eau, etc. Nous les récoltons massivement dans les zones humides d’Occitanie pour les intégrer à nos filtres végétaux. Cela renforce le soutien aux efforts de gestion et de non-prolifération d’espèces végétales devenues dangereuses.