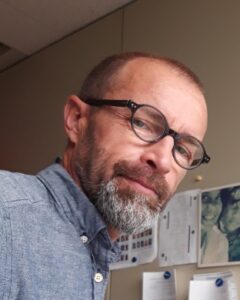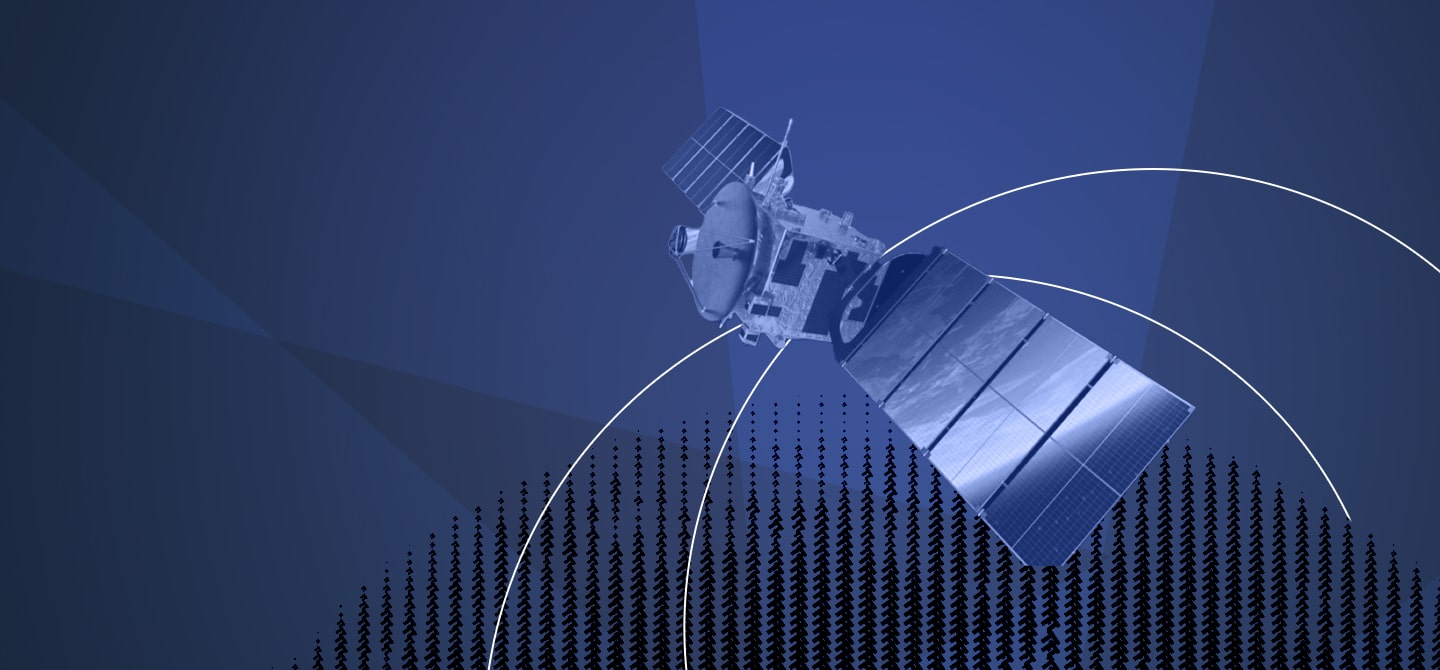En janvier 2025, de violents incendies touchent la région de Los Angeles. Les premières analyses1 montrent que l’aridité et la chaleur des mois précédents figurent parmi les facteurs expliquant l’intensité de ces feux2 : elles ont contribué à assécher la végétation, – particulièrement dense en raison des pluies de l’année précédente – et à augmenter la quantité de combustibles disponibles. « Ces dernières années, l’assèchement de l’environnement a globalement augmenté la durée de la saison des feux à travers une grande partie du monde, contribuant à des feux de forêt d’une sévérité sans précédent », pointe le GIEC dans son 6ème rapport d’évaluation3. La sécheresse est un risque naturel majeur. Entre 1970 et 2019, seules 7 % des catastrophes naturelles ont été liées à la sécheresse. Pourtant, elles ont contribué de manière disproportionnée à 34 % des décès liés aux catastrophes, principalement en Afrique, comme le synthétise le GIEC4. Aux États-Unis, les sécheresses ont coûté 250 milliards de dollars et tué près de 3 000 personnes entre 1980 et 20205.
Le changement climatique augmente la sévérité des sécheresses
Les études d’attribution – qui établissent l’impact du changement climatique sur les évènements extrêmes – ont déjà montré à de nombreuses reprises la contribution du changement climatique à la fréquence ou la sévérité des sécheresses. Bien sûr, toutes les sécheresses ne sont pas expliquées par le changement climatique, et des sécheresses avaient déjà lieu avant la modification du climat par les activités humaines. Mais parmi les 103 sécheresses étudiées jusqu’à présent (synthétisées par Carbon Brief6), 71 ont été rendues plus sévères ou probables par le changement climatique. Le collectif à l’origine de ces études d’attribution – le World Weather Attribution – synthétise7 : « Nous pouvons attribuer au réchauffement climatique une augmentation de la gravité et de la probabilité des sécheresses en Méditerranée, Afrique du Sud, Asie centrale et orientale, sud de l’Australie et ouest de l’Amérique du Nord avec une confiance élevée. »
Pour mieux comprendre comment le changement climatique influence les sécheresses, revenons un peu en arrière. De quoi parle-t-on exactement ? « Il n’existe pas de critère universel sur ce qui constitue une sécheresse », note le chercheur Toby R. Ault dans un article8. Au sens large, les sécheresses sont définies par un manque d’eau, ou des conditions plus sèches que la normale dans un lieu donné, dont la durée peut être variée. « Les sécheresses météorologiques sont marquées par un déficit de précipitations (plus ou moins prolongé) ; elles peuvent aussi être hydrologiques par des niveaux réduits des rivières ou des nappes phréatiques (parfois pendant plusieurs années), et agricoles par une sécheresse des sols avec de potentiels impacts sur les cultures et la végétation naturelle », nous informe Hervé Douville. La plupart des sécheresses débutent par un manque de précipitations (une sécheresse météorologique), et peuvent se transformer en sécheresses agricoles et hydrologiques9. La végétation et les activités humaines – comme l’irrigation et l’artificialisation des sols – peuvent augmenter ou diminuer la sévérité de la sécheresse et ses retombées socio-économiques.

Les activités humaines impactent également indirectement les sécheresses. En cause : le changement climatique. Ce dernier intensifie le cycle de l’eau, comme nous l’avons déjà expliqué dans de précédents articles. Comme l’atmosphère est plus chaude, sa teneur maximale en eau augmente en moyenne de 7 % pour chaque degré de réchauffement.
Les implications du réchauffement sur les sécheresses
Cela a plusieurs implications pour les sécheresses. En premier lieu, les précipitations sont modifiées : leur saisonnalité et intensité changent. « En Europe par exemple, le changement climatique provoque une diminution du nombre de jours de pluie et une augmentation des pluies extrêmes », indique Hervé Douville. Ces pluies moins fréquentes mais plus intenses provoquent plus de ruissellements superficiels et sont généralement moins efficaces pour recharger les nappes phréatiques. La hausse des températures globales diminue également les stocks de neige dans certaines régions, affectant le débit des rivières alimentées par la fonte des neiges au printemps. Enfin, dans le 6ème rapport de synthèse, le GIEC précise que les régions subtropicales vont également subir une baisse significative des précipitations annuelles – cela concerne la Méditerranée, l’Afrique du Sud, le sud-ouest de l’Australie et de l’Amérique du Sud, l’Amérique Centrale, l’Afrique de l’Ouest et le bassin de l’Amazonie.
« Au-delà des précipitations, le changement climatique augmente aussi l’évapotranspiration en surface, ce qui contribue fortement aux sécheresses agricoles », pointe Hervé Douville. Sur les continents, l’évapotranspiration désigne le flux d’eau qui s’évapore des sols et de la surface des rivières ou des lacs, mais aussi le transfert de l’eau des sols vers l’atmosphère via la transpiration des plantes. Or le réchauffement des températures de surface est plus important au-dessus des continents que des océans. Résultat, plus d’énergie est disponible pour que l’eau s’évapore et la sévérité des sécheresses est augmentée. Cet effet est en partie contrebalancé par les effets du CO2 sur les plantes – qui peut augmenter leur efficacité à utiliser l’eau des sols. Mais cette contrepartie ne suffit pas : l’évapotranspiration a augmenté depuis les années 1980.
Des effets contrastés selon les régions
Ces phénomènes liés au réchauffement climatique produisent des effets contrastés selon les régions. Si les sécheresses météorologiques sont assez peu affectées jusqu’à présent par le changement climatique, on observe une augmentation des sécheresses agricoles partout dans le monde – seul le nord de l’Australie est épargné10. Cela souligne le rôle majeur de l’augmentation de l’évapotranspiration sur la sécheresse, dont le GIEC rappelle qu’elle est très probablement due aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Un lien clair a même été établi entre le réchauffement lié aux activités humaines et une augmentation de la fréquence et de la sévérité des sécheresses au cours des dernières décennies en Méditerranée, dans l’ouest de l’Amérique du Nord et au sud-ouest de l’Australie.

À l’avenir, ces effets vont s’amplifier à mesure que les températures globales moyennes continueront d’augmenter. Selon les scénarios d’émissions de gaz à effet de serre, la durée des sécheresses pourrait s’étendre de 0,5–1 mois à 2 mois de plus qu’aujourd’hui en Amérique centrale, Méditerranée, bassin amazonien, sud-ouest de l’Amérique du Sud, ouest de l’Afrique du Nord, sud de l’Afrique et sud-ouest de l’Australie. « Toutes ces régions vont devenir plus sèches en raison de la baisse des précipitations et de la hausse de l’évapotranspiration […] même pour les scénarios de faibles émissions de gaz à effet de serre », synthétise le GIEC. Sans diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre, environ un tiers des terres devraient souffrir d’une sécheresse au mieux modérée d’ici 2100. Seules quelques régions et saisons devraient voir leur risque de sécheresse diminuer : les zones de haute latitude en Amérique du Nord et Asie, et la saison des moussons en Asie du Sud.
Les conséquences socio-économiques sont majeures. Dans une étude parue en 202111, une équipe estime que, en l’absence d’action en faveur du climat, les dommages liés aux sécheresses pourraient passer de 9 à 65 milliards de dollars chaque année en Union européenne et Royaume-Uni. « L’impact des inondations et des sécheresses devrait augmenter dans tous les secteurs économiques, de l’agriculture à la production d’énergie, ce qui aura des conséquences négatives sur la production mondiale de biens et de services, la production industrielle, l’emploi, le commerce et la consommation des ménages », synthétise le GIEC. Diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et mettre en place des actions d’adaptation permet de limiter fortement ces retombées sur les populations.