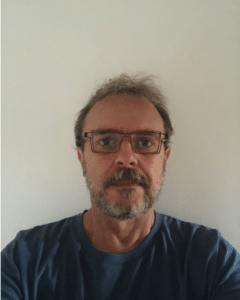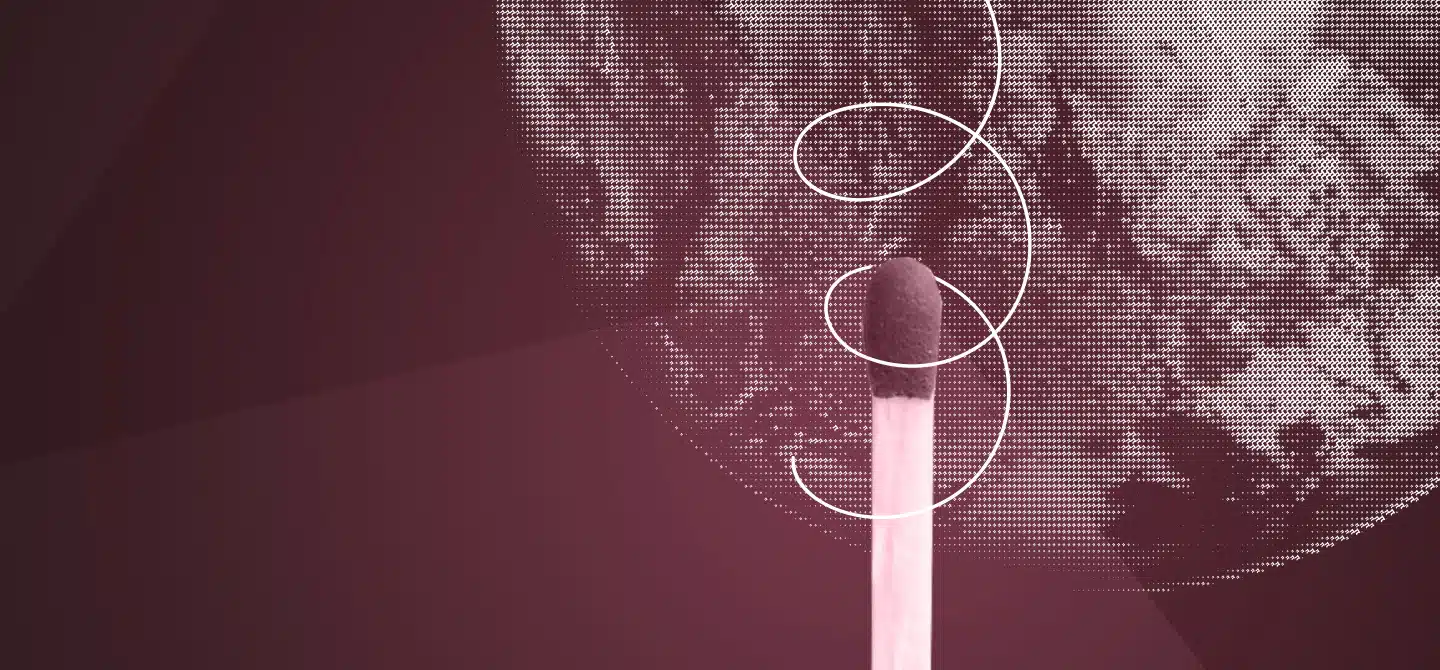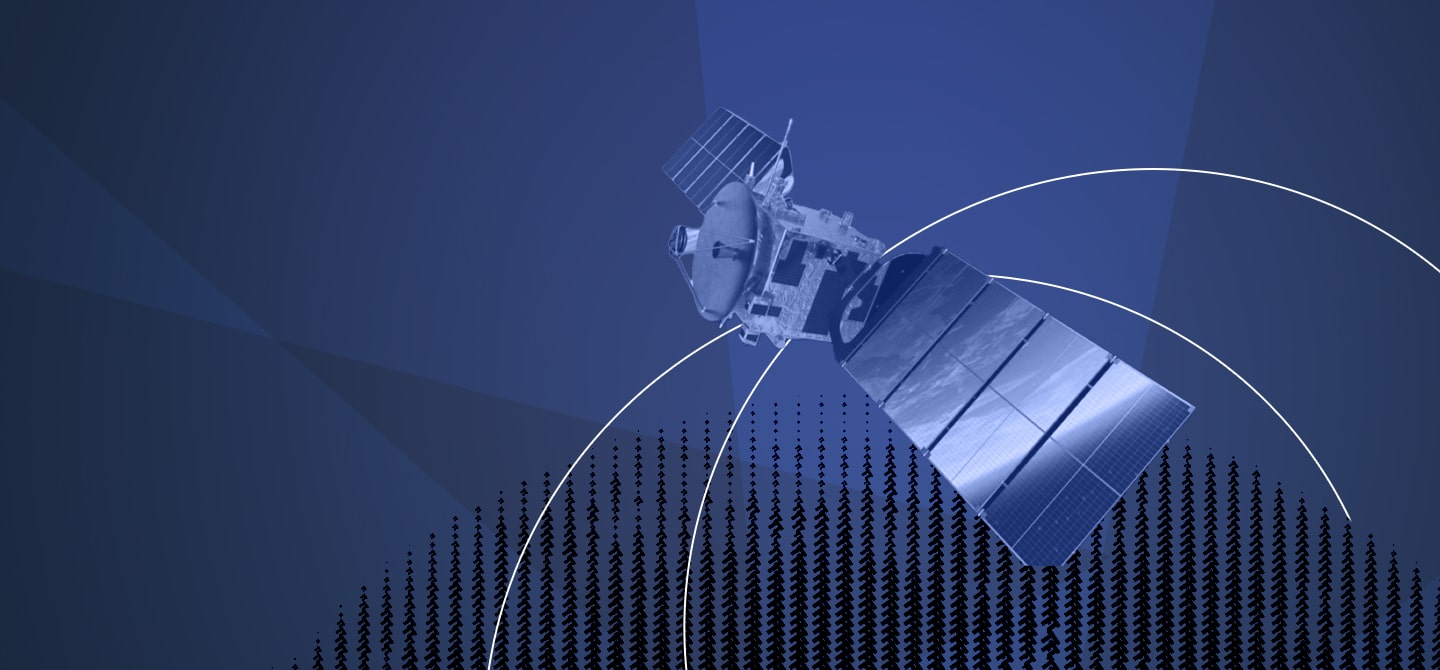Plus de 3 milliards de personnes vivent dans des contextes de grande vulnérabilité au changement climatique1. Les retombées sont, sans aucun doute, catastrophiques pour les systèmes naturels et humains en place aujourd’hui. Mais ce constat global masque une certaine variabilité. En particulier, quelques communautés locales pourront tirer leur épingle du jeu… au détriment d’un nombre bien plus élevé de citoyens affectés de façon néfaste par le changement climatique.
Quels effets sur la sécurité alimentaire ?
Intéressons-nous d’abord aux effets du changement climatique sur les cultures : le dernier rapport du GIEC consacre un chapitre au sujet2. À l’échelle globale, les rendements ont été multipliés par 2,5 à 3 depuis les années 60 grâce aux techniques agricoles (variétés, irrigation, fertilisation etc.). Sur la même période, le réchauffement climatique a réduit les rendements globaux du maïs (-5,9 %), du blé (-4,9 %) et du riz (-4,2 %)3, et ralenti la croissance de la productivité agricole de 21 %4. D’ici la fin du siècle, les baisses de rendement vont se poursuivre.
Mais ces moyennes cachent des disparités régionales. Si les effets attendus sont « plus négatifs que positifs » d’après le GIEC, certaines régions bénéficient du changement climatique : grossièrement, celles où les températures moyennes annuelles sont aujourd’hui inférieures à 10° C (l’Arctique et l’Asie centrale par exemple).
« Les effets du changement climatique sur les cultures sont nombreux, il est difficile de généraliser. », assène Edward Gerardeaux. En premier lieu, la hausse globale de la concentration atmosphérique en CO2 stimule la photosynthèse et augmente donc la biomasse. « Cet effet bien connu bénéficie plus à certaines cultures qui utilisent un mécanisme particulier de photosynthèse : blé, riz, pommes de terre, etc. » ajoute Edward Gerardeaux. Autre effet positif : la hausse des températures. « Dans certaines régions tempérées, elle réduit le stress thermique et étend les aires cultivables, par exemple vers les pôles ou en altitude. », poursuit Edward Gerardeaux. Au centre de Madagascar, dans les Hauts-Plateaux (la région la plus peuplée), la culture du riz est facilitée par le changement climatique. Les rendements estimés dépassent +10 % (+576 kg/ha) pour les scénarios pessimistes d’émissions de GES5. « Le même effet est attendu pour les pays d’altitude comme le Rwanda ou certaines zones du Kenya. », complète Edward Gerardeaux. Au cours des dernières décennies, des retombées positives du changement climatique ont été observées sur la productivité de maïs et riz en Asie centrale, maïs et soja en Amérique du Nord, ou encore blé en Afrique du Nord, Europe du Nord et Asie du Sud-Est, et riz en Australie.
Depuis les années 60, le réchauffement a ralenti la croissance de la productivité agricole de 21 %.
À l’inverse, la hausse des températures affecte la productivité de nombreuses plantes dans les régions où la température est plus élevée. Elle accélère leur croissance et diminue leur durée de vie. Edward Gerardeaux ajoute : « Au-delà d’un certain seuil, les tissus sont dégradés et les organes fructifères sont stériles : cela concerne particulièrement les plantes à la floraison groupée comme le maïs et le riz. » À cela s’ajoutent les variations de pluviométrie : déficit de pluie, augmentation des évènements extrêmes… La sécheresse a déjà provoqué des pertes dans 75 % des zones cultivées6, et les effets combinés de la chaleur et la sécheresse ont réduit les rendements mondiaux de maïs (-11,6 %), soja (-12,4 %) et blé (-9,2 %)7. Ces effets contrebalancent les impacts positifs dans de nombreuses régions du monde. Par exemple, les rendements de millet ont baissé de 10–20 %, et ceux de sorgho de 5–15 % en Afrique de l’Ouest.
Quelle conclusion en tirer pour la sécurité alimentaire mondiale ? L’insécurité alimentaire va augmenter, particulièrement en Afrique subsaharienne, Asie du Sud et centrale et Amérique centrale (de +8 à +80 millions de personnes touchées). « Les retombées positives sur l’agriculture ne sont pas en mesure de compenser ce risque, conclut Edward Gerardeaux. Certaines communautés locales verront leur situation s’améliorer, mais cela ne bénéficiera pas à une région très étendue, d’autant plus que les échanges commerciaux sont plus compliqués dans ces zones. »
L’exemple du paludisme
Prenons maintenant l’exemple du paludisme, une maladie vectorielle causée par des parasites du genre Plasmodium. La prévalence de la maladie dépend de facteurs socio-économiques (système de santé, comportements humains, etc.) et climatiques. Le vecteur – le moustique Anopheles – a besoin d’une pluviométrie adéquate pour créer des sites de ponte. Le parasite Plasmodium nécessite, lui, une température adaptée (environ 20° C) pour se multiplier dans le moustique8. Enfin, des températures trop élevées ou variables modifient la transmission.
Résultat ? La capacité vectorielle – l’aptitude des moustiques à transmettre le parasite – a augmenté ces dernières années, et la hausse des températures moyennes rend de plus vastes zones géographiques propices à la transmission9. Mais en Afrique de l’Ouest, la saison de transmission du paludisme va diminuer en raison de la baisse des précipitations : le risque de maladie y est donc amoindri grâce au changement climatique10. À l’inverse, la capacité vectorielle de l’insecte va augmenter en Afrique subsaharienne, Asie et Amérique du Sud.
Focus sur l’Arctique
« On parle d’une possible ruée vers le froid, la ‘cold rush’ ! », décrit Emmanuelle Quillérou. Aux pôles, les retombées physiques du changement climatique sont plus larges et importantes11. Les modèles climatiques montrent qu’un réchauffement moyen global de 4° C se traduit par une hausse des températures terrestres de 8° C en Arctique, et il est probable que l’océan devienne exempt de glace en été avant 2050. Résultat : de nouvelles routes maritimes et ressources naturelles deviennent accessibles.
D’ici 2050, les routes maritimes du Nord pourraient être 56 % plus accessibles qu’aujourd’hui.
Entre 2013 et 2019, le trafic maritime a augmenté de 25 % et la distance parcourue de 75 %. D’ici 2050, les routes maritimes du Nord (route maritime Nord, les passages du Nord-Ouest et la route maritime transpolaire) pourraient être 56 % plus accessibles qu’aujourd’hui. Il existe une nette corrélation entre la diminution de l’étendue des glaces de mer (-13 % par décennie jusqu’à présent12) et la hausse du trafic maritime. Les facteurs économiques y jouent aussi un rôle majeur. « Cela s’explique principalement par l’augmentation du trafic intérieur en Russie, commente Emmanuelle Quillérou. Mais la Chine et quelques armateurs comme Maersk se positionnent en ‘pionniers’ pour leur utilisation de ces routes pour les échanges commerciaux internationaux en testant des traversées. » Les armateurs espèrent ainsi éviter les routes classiquement empruntées comme le canal de Suez… et réduire la distance de 40 % entre l’Asie et l’Europe. « Les coûts ne sont cependant pas diminués de 40 %, tempère Emmanuelle Quillérou. La consommation de carburant est plus importante qu’en eaux chaudes, il est parfois nécessaire de recourir à un brise-glace, la navigation est plus lente, les infrastructures très limitées et des droits de passage peuvent être exigés par certains États riverains comme la Russie. » Sans prendre en compte les évolutions autres que le changement climatique, les réductions de coût par rapport aux autres routes maritimes sont estimées à 5–16 % aujourd’hui, 29 % en 2030 et 37 % en 205013.
Autre opportunité : l’exploitation des ressources naturelles. De nombreuses ressources fossiles sont exploitées dans la région (pétrole, gaz, minerais comme les diamants, les terres rares, le zinc etc.), et la Russie a déjà étendu l’exploitation des ressources naturelles – pétrole et gaz – dans les péninsules de Yamal et Gydan. La fonte des glaces augmente la durée d’exploitation et l’accessibilité à ces ressources. 90 milliards de barils de pétrole, 1669 milliards de pieds cubes de gaz naturel et 44 milliards de barils de GNL [Gaz Naturel Liquéfié, ndlr] pourraient être disponibles à l’avenir. « L’exploitation des ressources naturelles y est plus compliquée qu’ailleurs en raison des conditions climatiques extrêmes. La fonte du permafrost déstabilise les sols et impose la construction d’infrastructures encore plus coûteuses, prévient Emmanuelle Quillérou. La Lloyd’s, une des plus grandes compagnies d’assurance et référente dans le domaine, refuse depuis 2012 d’assurer certaines activités d’exploitation en Arctique, les risques financiers associés étant jugés trop importants. Cela a envoyé un signal très fort. Shell a persisté en Arctique plus longtemps que Total et BP mais a fini par arrêter les opérations initiées dans les années 2000, la mauvaise gestion d’une marée noire les ayant très rapidement freinés. » Malgré les opportunités, les coûts accrus pour l’exploitation commerciale des ressources et routes maritimes freinent fortement la ruée jusqu’à présent.
La ruée vers le froid présente des risques importants pour l’atténuation du changement climatique. « Une augmentation forte et brutale du niveau d’activité économique en Arctique pourrait non seulement générer des pollutions fortes de l’environnement naturel mais aussi rompre le fragile équilibre social et diplomatique dans la région, conclut Emmanuelle Quillérou. Les garde-fous en place sont encore trop restreints pour limiter les impacts sur l’environnement naturel polaire et donc sur le changement climatique au niveau mondial. » Alors que la région est déjà fortement exposée au risque climatique, la réduction des risques – y compris des nouveaux comme la hausse des émissions polluantes ou les retombées culturelles et sur les écosystèmes marins – grâce à des stratégies d’endiguement est essentielle face à la « cold rush ».