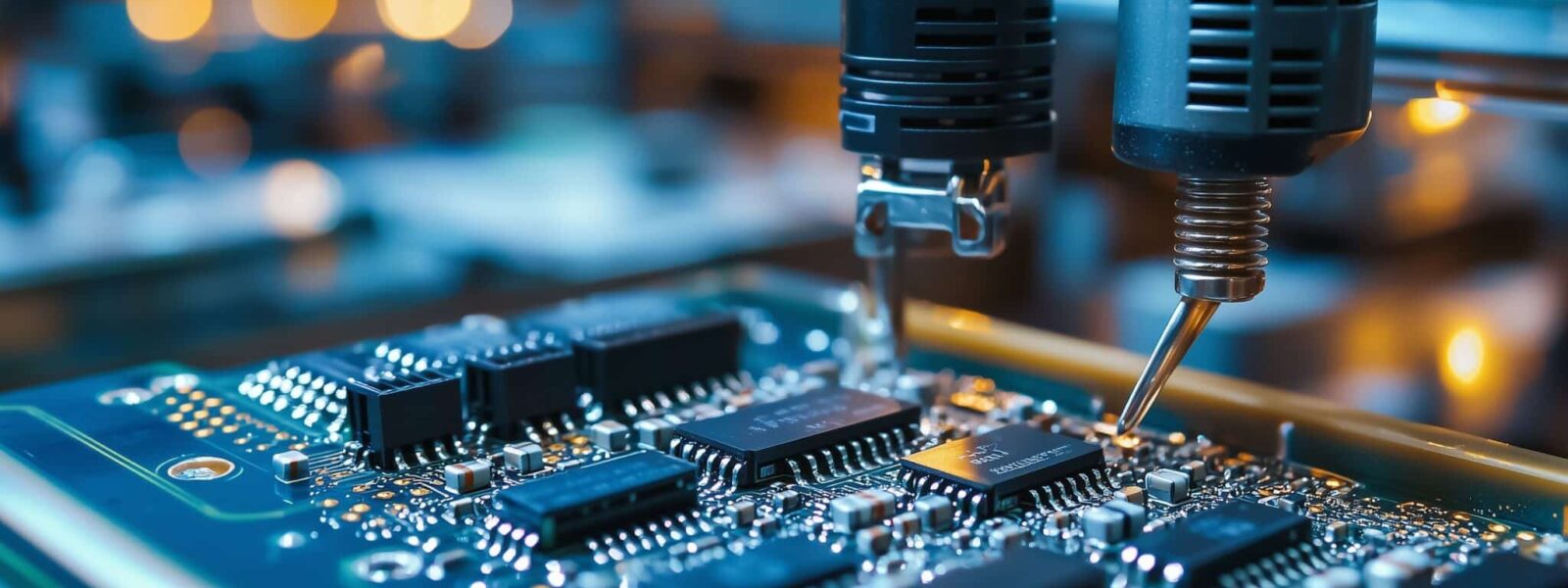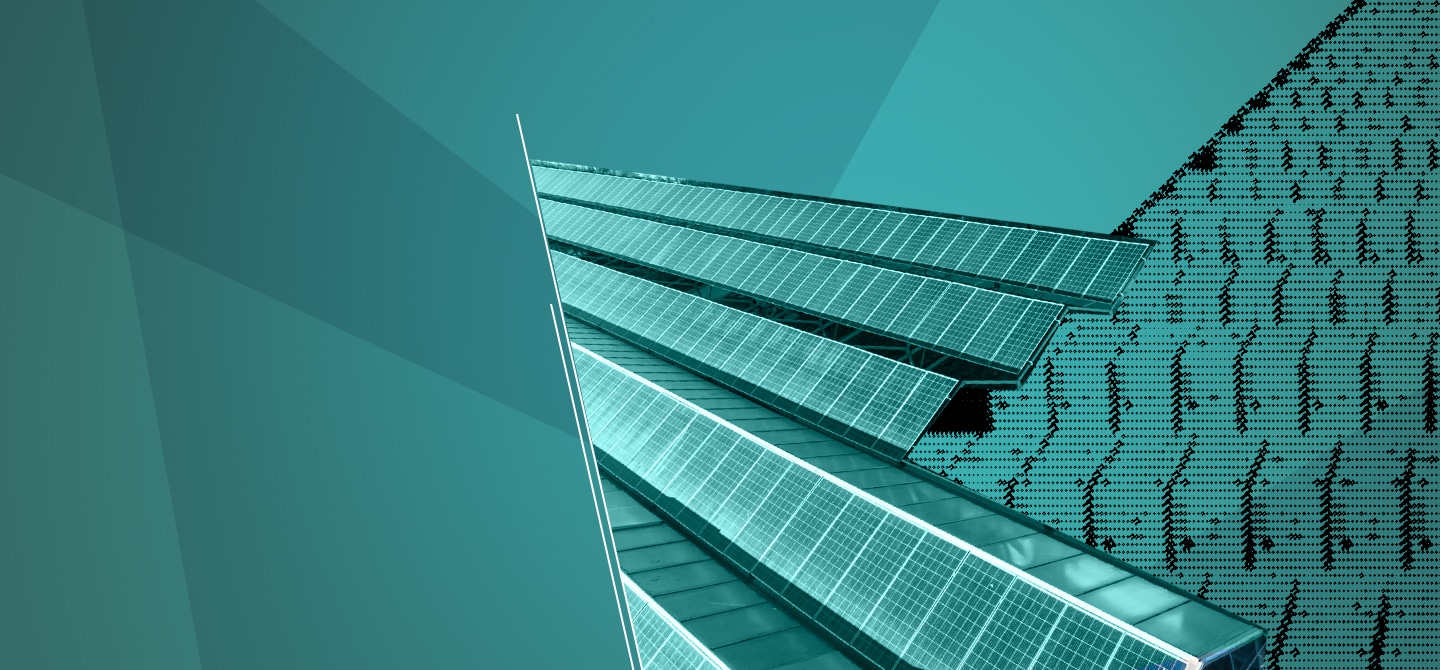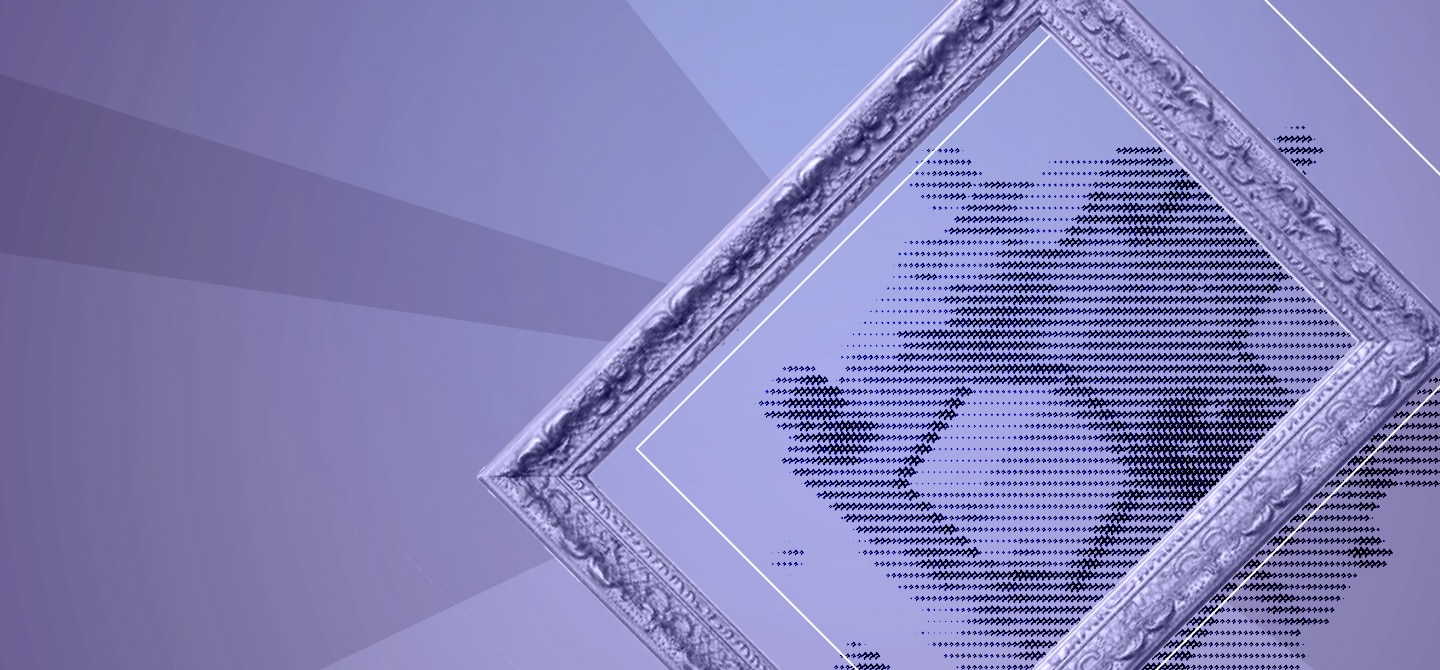Semi-conducteurs : l’Europe peut-elle regagner du terrain ?
- Contre sa dépendance à l’Asie et aux États-Unis sur le marché des semi-conducteurs électroniques, l’Europe a lancé le Chips Act.
- L’Europe représente un peu moins de 10 % de la production mondiale de semi-conducteurs, grâce à des industriels comme le français STMicroelectronics.
- Pour maintenir sa position, l’Europe doit investir dans ses points forts : l’innovation technologique, la production, les enjeux environnementaux...
- L’Europe peut valoriser ses atouts dans l'edge AI, l’intelligence artificielle gérée sur des périphériques tels que les smartphones, objets connectés, etc.
- Le projet FAMES, porté par la Commission européenne et la France, représente aujourd’hui un investissement de 830 millions d’euros dans le secteur.
625 milliards de dollars : c’est le poids du marché mondial des composants électroniques en 2024. À l’occasion de la pandémie de Covid 21 et de la pénurie de puces qui en avait résulté, l’Europe redécouvrait sa dépendance vis-à-vis de l’Asie et des États-Unis. Pour tenter de limiter cette dépendance, l’Union européenne annonçait en février 2022 le lancement du CHIPS and Science Act, qui visait à stimuler la production européenne. Quelque 3 ans plus tard, comment se porte le secteur en Europe ? Nous faisons le point avec Sébastien Dauvé, directeur du CEA-Leti, qui vient de lancer à Grenoble la ligne-pilote FAMES, financée par l’Union européenne et la France.
Comment se porte le marché de la microélectronique aujourd’hui ?
Sébastien Dauvé. En recul en 2023, le marché est en croissance depuis 2024, mais cette croissance cache une évolution à deux vitesses. Le secteur des semi-conducteurs matures, comme les microcontrôleurs, qui ont fait défaut à l’industrie et au secteur automobile en 2022–2023, s’avère aujourd’hui saturé. En parallèle, nous connaissons une explosion du marché des composants à nœuds très avancés (moins de 5 nm), stimulée par une très forte demande de puces destinées aux data centers et aux applications d’intelligence artificielle : processeurs graphiques (GPU) et mémoire à large bande passante (HBM). Les investissements dans ces domaines défient l’entendement : le taïwanais TSMC a, par exemple, annoncé investir 100 milliards de dollars aux États-Unis pour les quatre ans à venir.
À l’occasion de la pénurie, nous avions redécouvert que le marché des composants électroniques était à la fois très mondialisé et très polarisé, les principaux acteurs se situant en Asie et aux États-Unis. Cette structuration a‑t-elle évolué ?
Les investissements à consentir pour déployer de nouveaux moyens industriels sont tels qu’on ne peut imaginer une évolution majeure à court terme. Il reste donc aujourd’hui encore marqué par une très forte interdépendance au niveau mondial : un composant peut ainsi être conçu sur un continent et produit sur un deuxième, alors que les matières premières sont fournies par un troisième. Les États-Unis, par exemple, excellent dans la conception des circuits intégrés. Le Japon a pris la tête sur la production de wafers (les galettes de semi-conducteurs sur lesquelles sont imprimés les composants électroniques) et les gaz de process, la Chine est incontournable pour l’approvisionnement en terres rares. Taïwan et la Corée du Sud, par le biais des fonderies TSMC et Samsung, dominent la production des puces – TSMC est même le seul à maîtriser les nœuds les plus avancés (2 nm), très innovants et aujourd’hui très demandés.
Dans ce paysage, quelle est la place de l’Europe ?
L’Europe représente un peu moins de 10 % de la production globale de semi-conducteurs, grâce à des industriels comme le français STMicroelectronics, qui se classe autour du 10ème rang mondial. Si elle ne dispose pas de capacité de production des nœuds avancés, elle est plutôt bien positionnée sur la conception et la production des composants dits « More than Moore », constitués de capteurs, d’imageurs, de composants de puissance et télécom, ou encore de microcontrôleurs. Cette classe trouve des applications dans divers secteurs d’activité, comme l’automobile, l’industrie, la défense ou la santé. Le continent dispose aussi de quasi-monopoles dans des domaines spécifiques : le néerlandais ASML est ainsi par exemple le seul acteur à maîtriser la fabrication des équipements de lithographie avancée EUV, essentiels aux fonderies.

L’Europe bénéficie enfin d’une recherche active et d’importantes capacités d’innovation, notamment au travers de ses RTO (Research and Technology Organisations, parmi lesquelles le CEA-Leti, l’Imec belge, le Fraunhofer allemand, le VTT finlandais, etc.), un modèle unique d’organisation, capable de mener une innovation de la recherche la plus en amont jusqu’à la pré-industrialisation.
Le Chips Act ambitionnait de doubler la part de la contribution européenne à la production mondiale d’ici à 2030, en la faisant passer à 20 %. Dans le contexte actuel, cela vous semble-t-il réaliste ?
Nous savions que cet objectif était très ambitieux… Je dirais qu’à court et moyen terme il s’agit plutôt de maintenir notre place sur le marché actuel et de conserver notre souveraineté sur les développements les plus stratégiques lorsque nous en avons les moyens : notamment ceux qui touchent la défense, la cybersécurité mais aussi le calcul quantique, sur lequel l’Europe avance bien.
La stratégie européenne visait également à accueillir des usines Intel, en Allemagne et en Pologne, mais le géant américain a suspendu le projet en septembre dernier, tout en poursuivant son expansion industrielle aux États-Unis…
C’est en effet une mauvaise nouvelle pour l’Europe, car nous aurions intérêt à avoir plus d’acteurs installés. En microélectronique, la notion d’écosystème est très importante. Nous avons la chance à Grenoble d’avoir un écosystème qui atteint la taille critique, réunissant toute la chaîne de valeur, de la start-up au grand groupe, et c’est précieux.
Comment maintenir notre place dans un contexte international de plus en plus agressif économiquement et tendant au protectionnisme national ?
Nous devons continuer d’investir sur nos points forts, de l’innovation technologique à la production, mais aussi renforcer les liens entre le semi-conducteur et les domaines applicatifs souverains pour l’Europe (industrie, automobile, santé…) qui ont désormais pris pleine conscience de l’importance des composants.
L’Europe est également en avance sur la prise en considération des enjeux environnementaux et énergétiques : ces deux contraintes constituent des opportunités d’innovation importantes. Le CEA porte par exemple le projet européen GENESIS, réunissant 50 partenaires, qui vise à accélérer l’éco-innovation sur les procédés de fabrication des semi-conducteurs. Nous avons aussi l’ambition de réduire d’un facteur 1000 la consommation des composants d’ici 2032.
Mais surtout, il ne faut pas oublier que le marché de la microélectronique est par nature cyclique : ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera pas forcément demain.
Quelles évolutions prévoyez-vous ?
Une tendance forte émerge sur laquelle l’Europe pourrait faire valoir ses atouts : l’edge AI, l’intelligence artificielle gérée non pas dans des centres de données, mais sur des périphériques, smartphones, objets connectés, boîtiers industriels… Ces applications embarquées requièrent des électroniques à la fois très peu gourmandes en énergie et capables de réaliser la phase d’inférence, voire la phase d’apprentissage, en local. Or, traditionnellement, les unités dédiées au calcul et celles dédiées à la mémoire sont séparées sur les puces : 80 et 90 % de l’énergie est consommée dans la transmission des données entre les deux. L’edge AI nécessitera donc des innovations en matière d’architecture électronique, sur lesquelles l’Europe a une place à prendre. Elle sera de plus très liée aux capteurs, qui sont une force de l’Europe.
Le CEA-Leti a été sélectionné pour porter l’une des trois lignes pilotes prévues par le Chips Act, FAMES, située à Grenoble. De quels moyens est-elle dotée ?
FAMES nous permet de construire 2 000 m² de salles blanches supplémentaires et d’acquérir une centaine de nouveaux équipements de type industriel, représentant un investissement de 830 millions d’euros, porté à la fois par la Commission européenne et l’État français. Elle est entrée en service opérationnel en ce début d’année. Nous avons parfaitement tenu le calendrier prévu, qui était très serré. C’est important à souligner : lorsqu’on connaît l’Asie, on sait que l’exécution opérationnelle y est redoutable. Preuve est faite que nous sommes capables de faire aussi bien.
Quels sont les objectifs de FAMES ?
Sa première vocation consistera à préparer les technologies FD-SOI pour des nœuds de 10, voire 7 nm. Cette technologie est aujourd’hui produite par GlobalFoundries et STMicroelectronics, respectivement en 22 et 18 nm. Le marché visé reste modeste à l’échelle mondiale, mais c’est une solution particulièrement intéressante pour les applications embarquées qui recherchent la frugalité. Mais FAMES doit aussi nous permettre de préparer « le coup d’après » pour les industriels européens, en accélérant le développement d’autres technologies jugées clés pour les 5–10 ans à venir : les mémoires embarquées non volatiles, qui joueront un rôle essentiel pour les usages d’IA nomades évoquées plus haut, les composants radiofréquences, qui soutiendront le passage aux applications 6G, ou encore sur l’intégration hétérogène 3D, qui exploitera l’empilement pour intégrer de nouvelles fonctionnalités sur une seule et même puce. Il faut ajouter que nous participerons aux autres lignes pilotes prévues par le Chips Act.
Ces lignes pilote visent à préparer à court, moyen et long terme l’avenir industriel de l’Europe dans le champ des semi-conducteurs. On parle parfois de difficultés à collaborer au niveau européen : c’est loin d’être le cas dans le domaine de la microélectronique. Nous travaillons en étroite collaboration, tirant le meilleur parti de nos complémentarités, afin de répondre efficacement à l’urgence stratégique à laquelle nous faisons face.