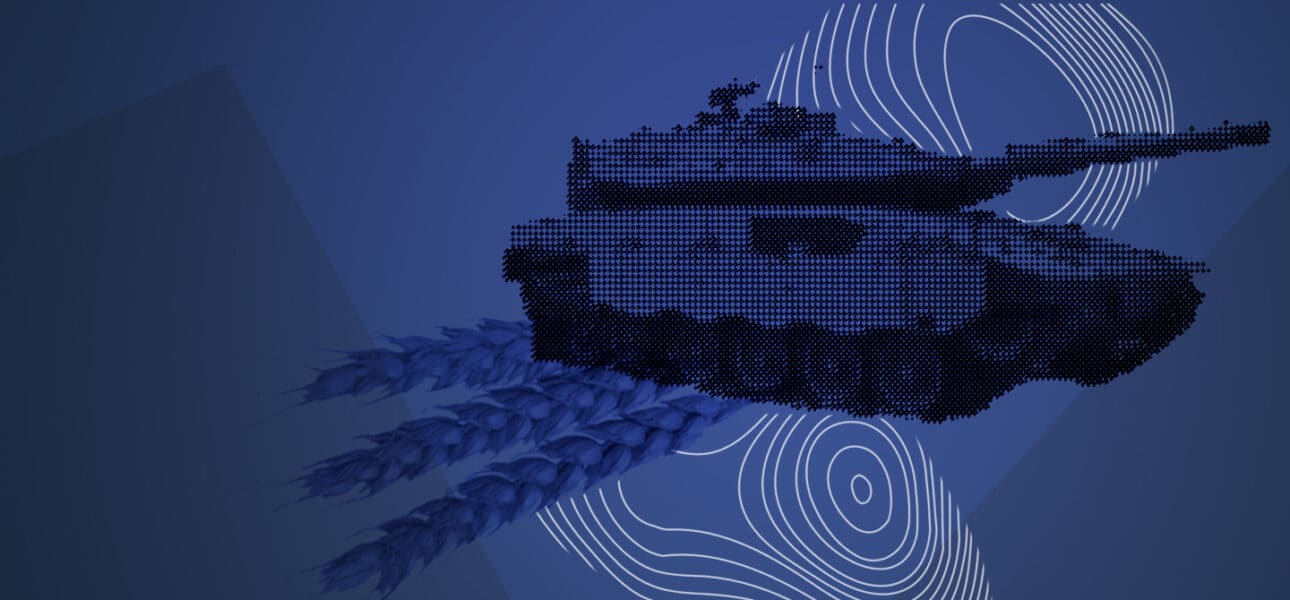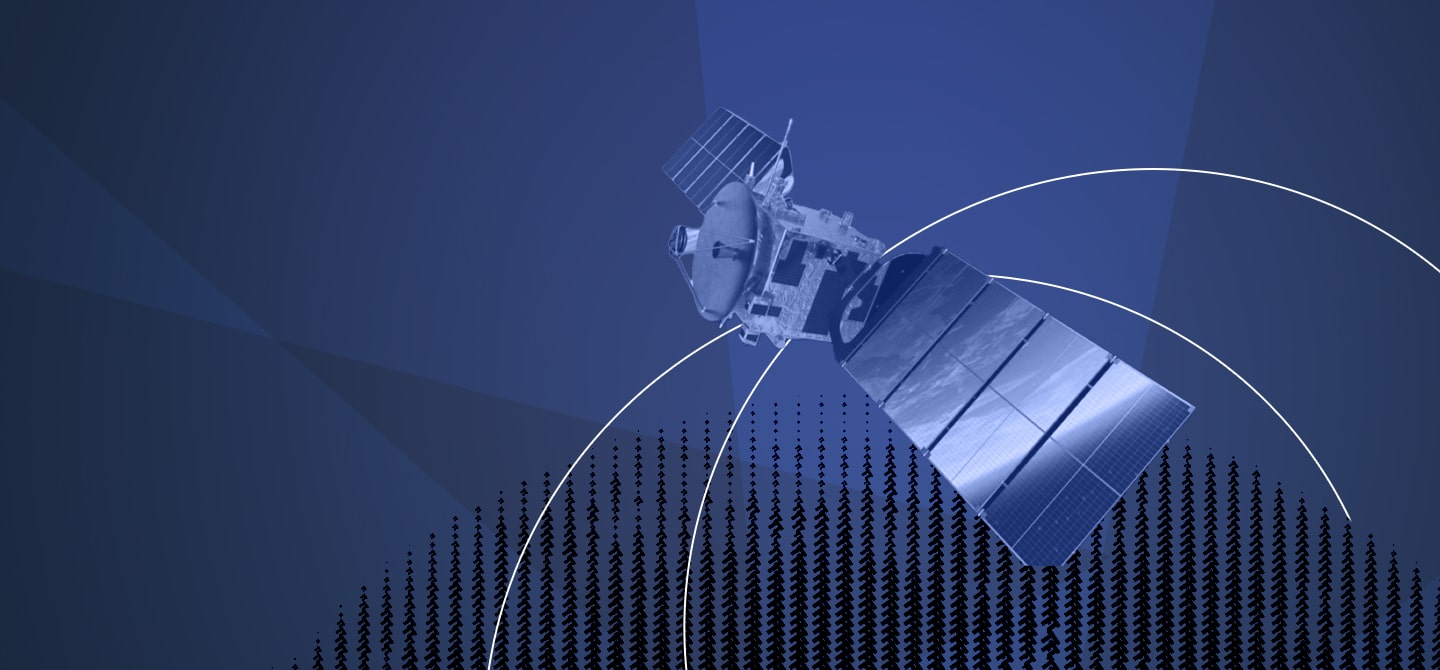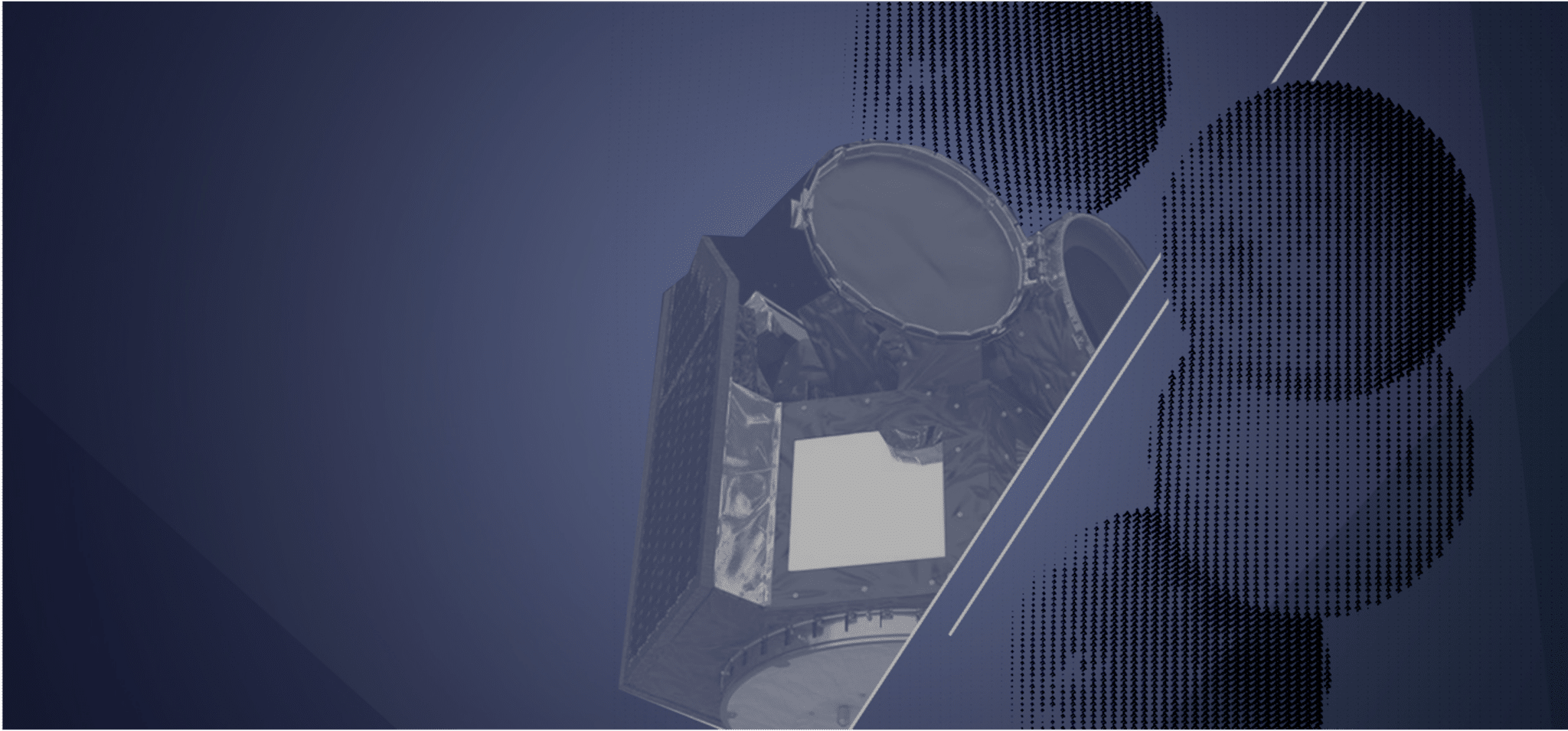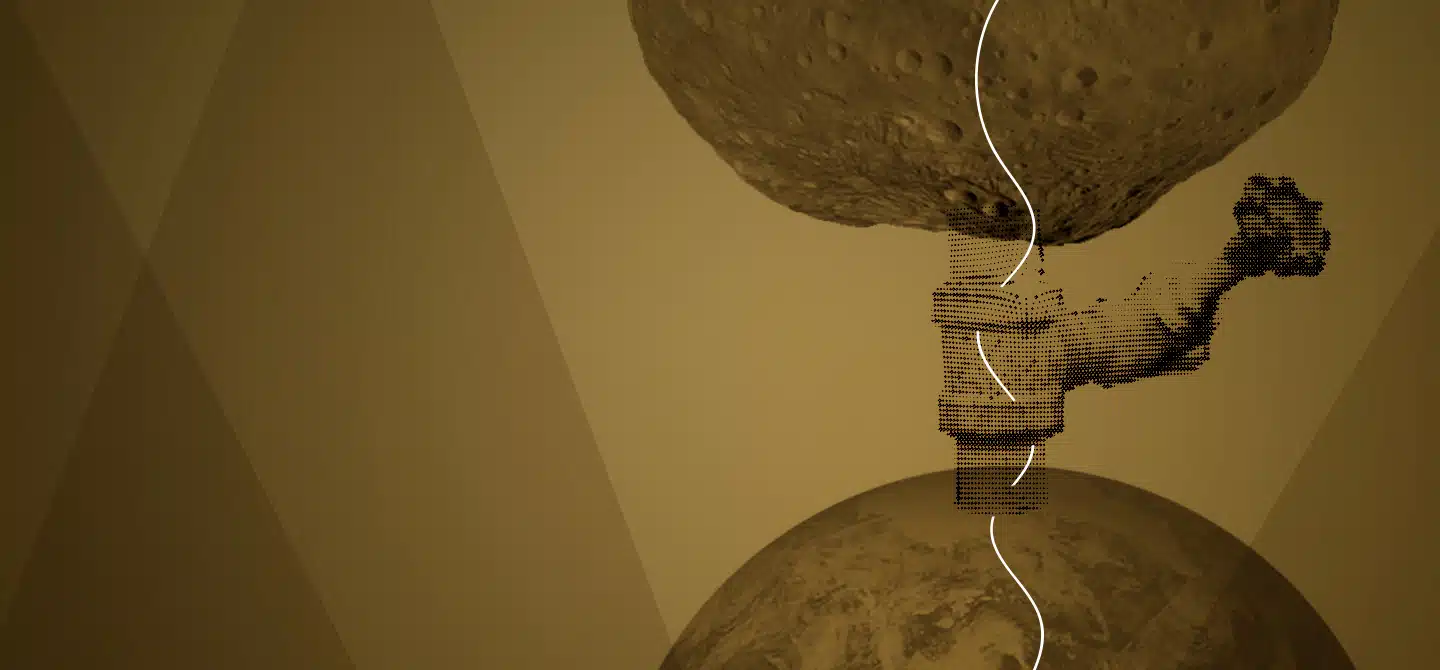Fin 2024, vous avez publié une étude évaluant les retombées de la guerre en Ukraine sur les cultures de blé1. Pouvez-vous nous en détailler les résultats ?
Ahmad Al Bitar. Nous avons calculé les rendements des cultures de blé grâce aux données satellites dans deux régions : Poltava, une zone éloignée du front ; et Kherson, envahie par l’armée russe. En 2022 (l’année de l’invasion de l’Ukraine par la Russie), les rendements du blé ont chuté de 20 % dans la région de Kherson par rapport aux années précédentes : la quantité de biomasse (la quantité de matière organique) sèche est passée de 9,7 tonnes par hectare (t/ha) en 2020 et 2021 à 7,8 t/ha. Dans la région de Poltava, les rendements demeurent en revanche stables : cela démontre les impacts négatifs dans les zones envahies par l’armée russe. Cela affecte la sécurité alimentaire de nombreux pays, puisque l’Ukraine était le 5ème exportateur mondial de blé en 2021.
Pourquoi l’invasion russe a‑t-elle impacté les rendements agricoles ?
On distingue deux effets. Tout d’abord, l’accès aux parcelles est limité en raison de la présence des troupes russes. Cela entrave les pratiques agricoles – le travail du sol, la fertilisation, l’irrigation, etc. L’autre impact concerne les ressources humaines et matérielles. Les agriculteurs peuvent être victimes de la guerre, ou recrutés sur le front. Et les ressources matérielles comme les fertilisants ou les moyens de transport du blé sont affectés par la guerre.
Notre travail ne permet pas de démêler les différentes causes, d’autres études associées à des données de validation seront nécessaires. Ici nous démontrons qu’il est possible de quantifier l’impact de la guerre à l’intérieur des parcelles agricoles, à une résolution de 10 mètres et cela sur de larges étendues. Ce travail est effectué à partir d’observations satellites et de modélisations, et donc sans se rendre sur le terrain : c’est inédit.
Quel est l’intérêt d’évaluer l’impact de la guerre à l’intérieur des parcelles ?
Les pratiques agricoles homogénéisent les cultures pour optimiser les rendements. Ici, nous observons à l’inverse une hétérogénéité de la biomasse à l’intérieur des parcelles. Cela ressemble à des parcelles laissées à l’état naturel. Nous supposons que le manque de pratiques agricoles explique cette baisse de rendement dans la région de Kherson.
Quel type de données satellites vous ont permis d’obtenir ces résultats ?
Nous avons principalement utilisé les données issues de Sentinel‑2, des satellites lancés dans le cadre du programme européen d’observation et de surveillance de la Terre, Copernicus. Ces satellites embarquent des instruments optiques, qui fournissent des images de la Terre à haute résolution dans le spectre visible (l’équivalent de photographies) et proche-infrarouge. L’ensemble de la planète est survolé tous les cinq jours.

L’une des caractéristiques cruciales du programme Copernicus est l’engagement sur la continuité des observations à long terme. L’autre point crucial est la gratuité des données pour les scientifiques et les applications privées. Cela permet de capitaliser sur les connaissances acquises afin de transposer ces nouvelles méthodologies dans d’autres régions du monde.
En quoi ces données satellite sont-elles importantes ?
Il est bien sûr très compliqué de réaliser des études de terrain dans des zones de guerre. De précédentes études ont identifié des perturbations significatives de la chaîne de distribution du blé, mais il est difficile d’en connaître l’origine car de multiples facteurs peuvent intervenir – destruction des infrastructures de transport, hausse des prix des fertilisants, déplacement des populations, etc. Notre étude permet d’évaluer l’impact direct de l’invasion russe sur la croissance des cultures.
De façon générale, les satellites sont des outils privilégiés dans les conditions de catastrophes. Il existe une Charte internationale « Espace et catastrophes majeures » qui coordonne la réponse spatiale lors de catastrophes. Les agences spatiales, gouvernements et entreprises privées peuvent ainsi mobiliser leurs satellites pour se concentrer sur les zones concernées et fournir des données aux secours et décideurs.
Comment arrive-t-on à calculer les rendements des parcelles à partir d’images satellite ?
Deux étapes préliminaires sont nécessaires. La première consiste à corriger les images satellites des effets de l’atmosphère et des nuages grâce à l’outil MAJA du CNES. La deuxième étape vise à identifier les parcelles de blé. Elle est réalisée par l’entreprise Kermap en utilisant l’intelligence artificielle.
La chaîne de traitement AgriCarbon-EO est ensuite appliquée. Elle intègre les données de télédétection et la modélisation agronomique afin de fournir des cartes de la production de blé avec une résolution de 10 mètres. AgriCarbon-EO est le fruit d’une dizaine d’années de recherche et de développement au sein du CESBIO. Tous les outils ont fait l’objet de validations dans des contextes européens variés avant d’être transposés à l’Ukraine.
La chute de rendement observée dans la région de Kherson ne pourrait-elle pas s’expliquer par d’autres facteurs, comme le climat par exemple ?
Veronika Antonenko. Dès le début de l’étude, nous avons identifié l’importance de vérifier l’impact de la météo. En comparant la météo des années 2020, 2021 et 2022 à la climatologie des quarante dernières années, nous avons constaté que les conditions étaient dans la norme dans nos deux zones d’études. Cela nous a permis d’exclure la météo comme un facteur explicatif de cette chute de rendement.