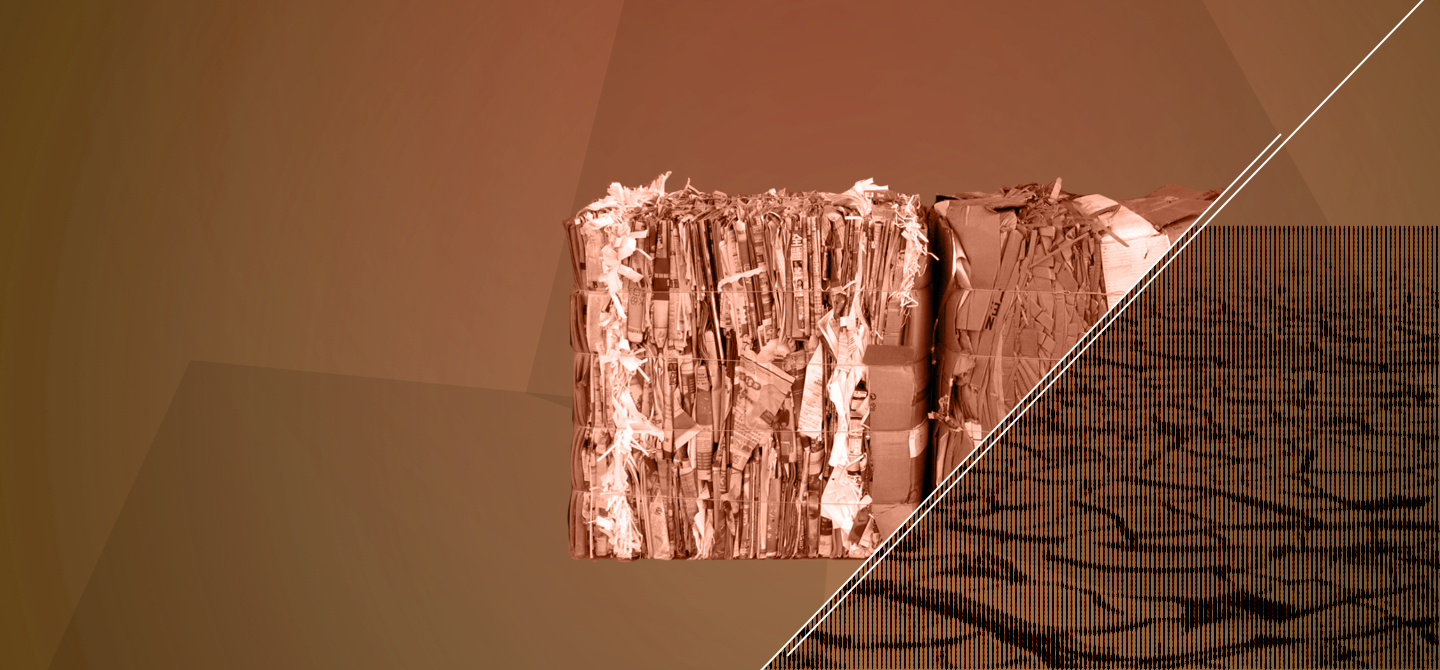Industrie spatiale : Quelle place pour l’Europe face à la domination américaine ?
- L’industrie spatiale européenne est aujourd’hui bien développée, tant dans le domaine des lanceurs et des satellites que dans celui des applications spatiales.
- Face aux acteurs majeurs du secteur (États-Unis) l’Europe souffre de la fragmentation de son industrie et doit défendre son autonomie stratégique et renforcer ses capacités.
- L’Europe souffre également d’un manque de financements privés dans le domaine spatial.
- Environ 40 % du chiffre d'affaires de l’industrie spatiale européenne provient du secteur commercial, un pourcentage bien plus élevé qu’aux États-Unis.
- L’Europe dispose d’atouts majeurs pour rester une grande puissance spatiale mondiale : un excellent système de formation, des industriels performants, etc.
Comment se développe l’industrie spatiale européenne et internationale aujourd’hui ?
Jean-Marc Astorg. L’industrie spatiale européenne est aujourd’hui une industrie mature qui s’est considérablement développée depuis les années 1970, tant dans le domaine des lanceurs et des satellites, que dans celui des applications spatiales – par exemple, dans l’utilisation des données d’observation de la Terre. Et ce pour différents secteurs d’activités (maritime, mobilité, sécurité, environnement, assurances et urbanisme, pour ne citer que quelques exemples). L’Europe maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur du spatial, à l’exception des vols habités autonomes. Parmi les exemples bien connus, on peut citer Arianespace pour les lanceurs, Airbus Defence & Space et Thales Alenia Space pour les satellites. Ces entreprises emploient en France environ 30 000 personnes dans l’industrie manufacturière du spatial et 60 000 tous secteurs confondus, générant un chiffre d’affaires d’environ 10 milliards d’euros.
Le secteur spatial est aujourd’hui en profonde et rapide transformation sous l’effet de différents facteurs :
- l’arrivée d’entrepreneurs privés américains qui ont su développer (avec l’aide de la NASA) de nouveaux systèmes spatiaux (lanceurs, constellations) avec des moyens considérables et des méthodes nouvelles. Le secteur mondial spatial en est complètement bouleversé et à mon avis, nous n’en sommes qu’au début ;
- l’innovation technologique (digitalisation, lanceurs réutilisables, constellations, intelligence artificielle) qui démocratise l’utilisation des données spatiales par une réduction drastique des coûts ;
- la montée de la conflictualité dans l’espace, qui est une conséquence de l’utilisation accrue des moyens spatiaux sur les théâtres d’opération ;
- et enfin, la relance de l’exploration spatiale vers la Lune et Mars dans le contexte d’une nouvelle course entre les États-Unis et la Chine, pour s’implanter cette fois durablement sur la Lune.
Dans ce contexte, les États-Unis ont pris une avance considérable sur le reste du monde – à l’exception peut-être de la Chine – sur les lanceurs (Falcon9, Starship, New Glenn), les constellations de connectivité (Starlink) et l’exploration habitée. Mais l’Europe reste au meilleur niveau mondial en observation de la Terre pour répondre à des enjeux économiques et climatiques.
Face à des acteurs complètement verticalisés, l’Europe souffre actuellement d’une trop grande fragmentation de son industrie, toujours segmentée en secteurs industriels distincts pour les lanceurs, les satellites, les applications et les opérateurs de télécommunication. Cette situation exige des mesures radicales :
- La première est de défendre notre autonomie stratégique et la préférence européenne, de maintenir notre propre capacité de lancement de satellites, et de conserver nos propres moyens de communication.
- La seconde est, bien sûr, d’augmenter ces capacités afin de pouvoir concurrencer les entreprises américaines telles que SpaceX.
Les acteurs historiques sont-ils aussi importants qu’avant ?
Nous assistons à l’émergence du « Newspace » en Europe. Les start-ups qui sont financées principalement par des fonds privés et qui utilisent de nouvelles méthodes de développement sont donc plus agiles que les acteurs historiques. Il existe aujourd’hui plusieurs centaines de start-ups établies en Europe, là encore, pour différentes activités : lancement, observation et connectivité. Mais ces start-ups n’ont été créées que depuis quelques années et n’ont pas encore la masse critique nécessaire pour pouvoir résister à la concurrence américaine.

Une consolidation entre acteurs historiques et nouveaux entrants est inévitable, mais elle devra s’accompagner de mesures spécifiques de soutien à la croissance des meilleurs acteurs. L’investissement initial dans les start-ups pose moins de problèmes car des financements sont disponibles, mais lorsqu’il s’agit de lever une centaine de millions d’euros, cela devient compliqué. Il y a un manque important de financements privés en Europe par rapport aux États-Unis. Ce qui est probablement dû à un aspect culturel, dans la mesure où le capital-risque est encore un concept plutôt américain.
Des restructurations auront lieu, avec des regroupements et des fusions, car il existe trop de fragmentations en Europe dans le secteur spatial. Les marchés d’aujourd’hui sont des marchés mondiaux, il faudra donc une consolidation importante au niveau européen pour éviter que certaines entreprises ne disparaissent. Il convient également de mentionner que l’industrie européenne est très sensible aux marchés : environ 40 % du chiffre d’affaires de l’industrie spatiale européenne provient du secteur commercial. Ce chiffre est bien plus élevé qu’aux États-Unis.
Des perspectives d’avenir dans le domaine
Ainsi, les projets d’autonomie stratégique en Europe seront cruciaux, en particulier le développement d’une constellation européenne de connectivité. En ce sens, ces projets devront être maintenus dans tous les secteurs de l’espace.
Résoudre le problème de l’investissement différentiel entre les États-Unis et l’Europe est également crucial ; les États-Unis disposent d’un budget public d’environ 70 milliards de dollars par an (bien que cela puisse changer avec la nouvelle administration Trump) alors qu’en Europe, il n’est que de 12 milliards de dollars par an.
Un service de télécommunication autonome et souverain
Nous pouvons en ce sens mentionner le programme IRIS², constellation européenne, dont le contrat de concession a été signé en décembre dernier entre la Commission européenne et un consortium européen d’opérateurs de télécoms (Eutelsat, SES, Hispasat). Cette nouvelle infrastructure complétera la constellation de navigation Galileo et le programme Copernicus d’observation de la Terre.
Il est aussi possible de mentionner le programme d’exploration américain Artemis, pour un retour durable sur la Lune, lancé par la première administration du président Trump. Il pourrait toutefois être remis en cause par sa nouvelle administration. Si le programme est modifié de manière significative, cela aura inévitablement des conséquences pour l’Europe, qui y participe.
Dans son discours d’investiture en janvier, Trump a déclaré que l’Amérique devait planter son drapeau sur Mars. Les États-Unis veulent donc donner la priorité à Mars et s’y rendre seuls. C’est une approche assez différente du programme Artemis, qui représente une collaboration internationale.
En fait, Starship (de SpaceX) devrait être utilisé pour envoyer des sondes sur Mars au cours de cette décennie, afin d’y mettre en place des expériences. Les vols habités seront plus probables au cours de la prochaine décennie, ce qui signifie que peut-être en 2035, il y aura des Américains sur Mars.
L’Europe suivra-t-elle le mouvement ?
En réalité, il n’y a aucun intérêt économique à se rendre sur la Lune ou sur Mars, même si certains disent qu’il y a des minerais exploitables sur la Lune. À mon avis, la Lune n’est que l’objet d’une course géopolitique entre les États-Unis et la Chine.
Quant à Mars, la planète présente avant tout un intérêt scientifique. Nous devons nous rendre sur Mars, de préférence avec des sondes, pour comprendre pourquoi l’eau a disparu de la planète rouge, pourquoi la Terre et Mars ont connu une croissance assez comparable au début de leur évolution ou encore pourquoi Mars est devenue une planète inhabitable alors que la vie a pu se développer sur Terre. N’y a‑t-il jamais eu de la vie sur Mars ? Ce sont des questions scientifiques, et nous n’avons pas besoin d’envoyer des humains sur la planète pour y répondre. La vision d’Elon Musk est de faire de l’Homme une espèce multiplanétaire, une vision qui n’est cependant pas nécessairement partagée par les États-Unis, et certainement pas par l’Europe.
En résumé, nous avons tous les atouts en Europe pour rester dans le peloton de tête des puissances spatiales mondiales : un excellent système de formation, des industriels performants, une recherche académique au meilleur niveau mondial et des infrastructures spatiales performantes (lanceurs, satellites, moyens sol). Nous devons également défendre les valeurs qui nous sont chères : la protection de la planète, la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la confiance dans la science ou la coopération internationale pour un monde plus sûr. L’Europe s’est aussi construite sur ces valeurs. Et dans le futur, il est important que nous les préservions.