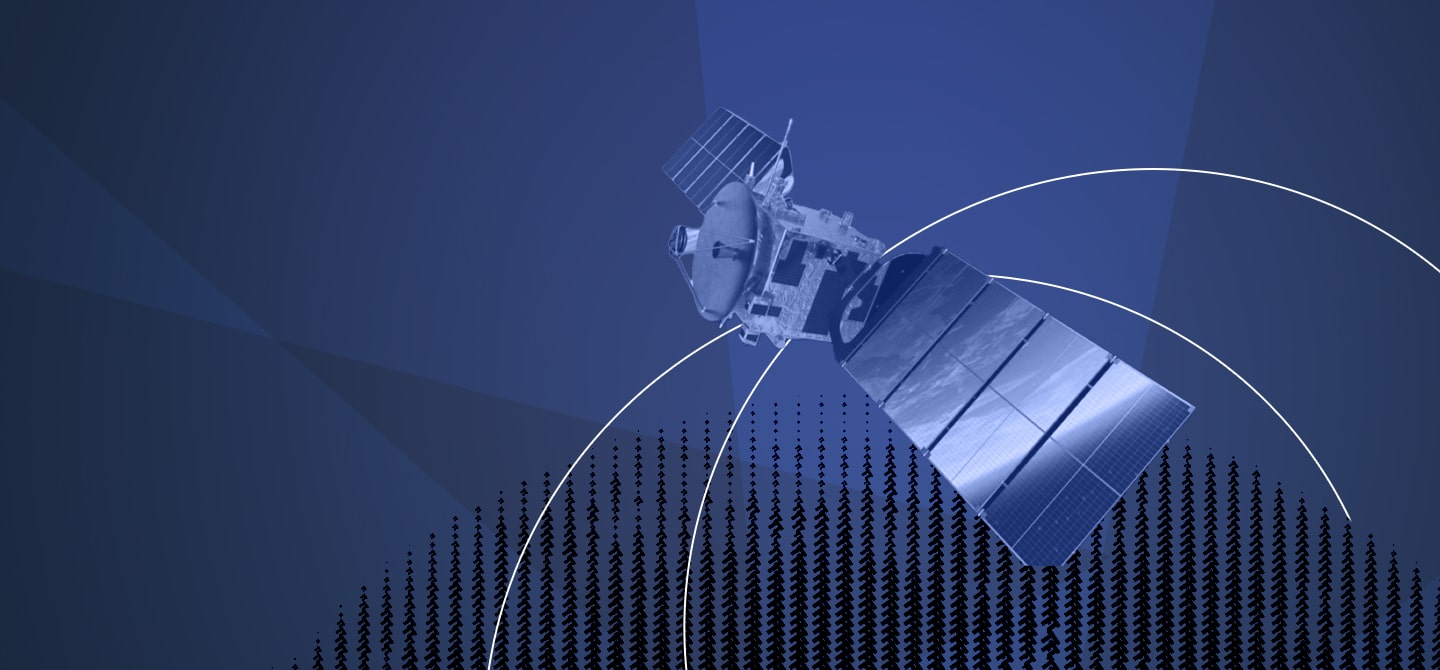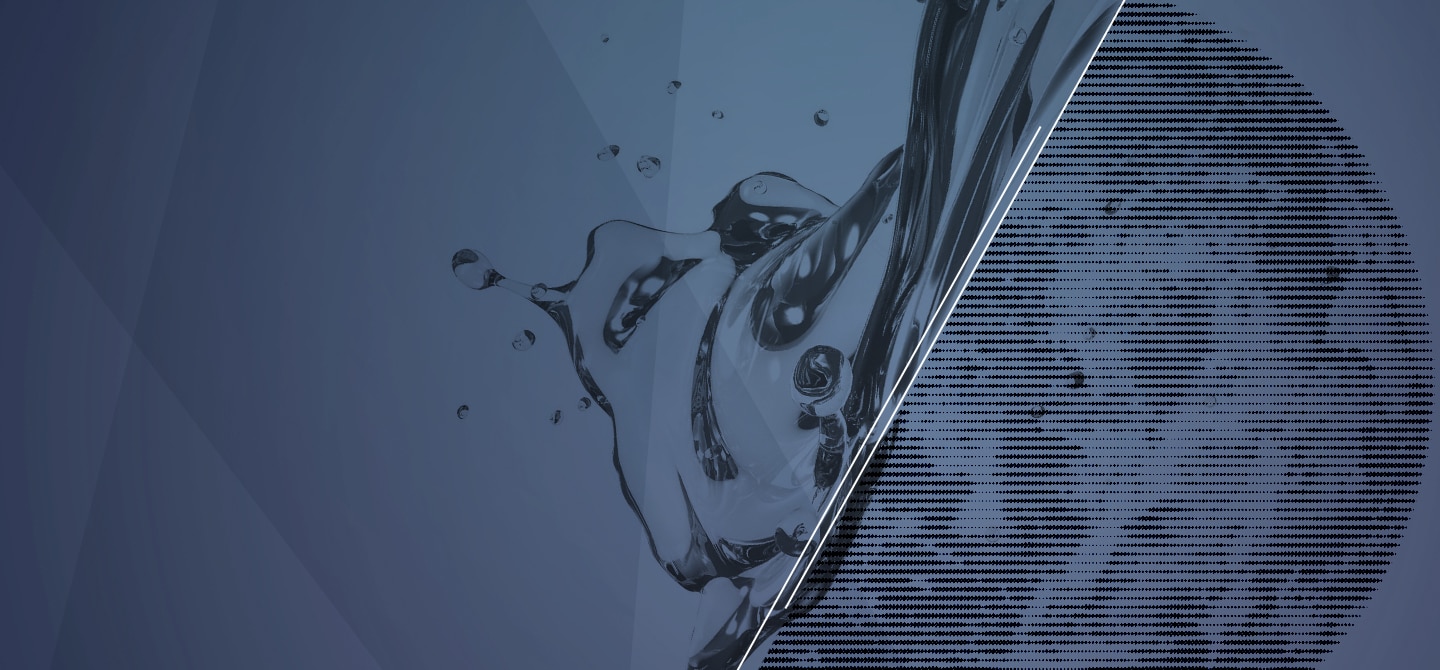Ariane 6 : les enjeux d’un succès stratégique pour l’Europe
- Le lancement réussi d’Ariane 6 en mars 2025 marque le retour de la pleine autonomie d’accès à l’espace pour l’Europe et ses avancées vers une plus grande souveraineté.
- L’Europe, qui a pris du retard par rapport aux États-Unis en matière de lanceurs réutilisables, y travaille notamment à travers les démonstrateurs Callisto et Themis.
- Le Centre spatial guyanais permet aujourd’hui à la France de disposer d’un site stratégique, et des programmes de modernisation devraient aboutir en 2026.
- La logique européenne du développement spatial se distingue de celle des États-Unis par son approche raisonnée et raisonnable, notamment à travers la constellation IRIS².
- La question de l’utilisation du nucléaire dans le domaine spatial en Europe se pose aux décideurs politiques, qui devront trancher au niveau européen.
Les retards accumulés par Ariane 6 et les échecs de lancement du lanceur léger Vega‑C avaient privé l’Europe d’un accès autonome à l’espace, stratégique pour la reconquête de sa souveraineté. Lionel Suchet, président directeur général par intérim du Centre national d’études spatiales (CNES), revient sur le lancement réussi d’Ariane 6 en mars 2025 et dessine les perspectives sur la question des lanceurs en Europe.
Le 6 mars 2025, Ariane 6 réussissait son premier vol commercial, très attendu. Quels étaient les enjeux de ces vols ?
Lionel Suchet. Ce succès s’inscrit dans la lignée du vol inaugural d’Ariane 6, en juillet 2024, qui avait déjà été une réussite quasi totale. La désorbitation du troisième étage, qui n’avait pas pu être effectuée lors de ce premier vol de qualification, a été pleinement réalisée en mars 2025. Il s’agit là d’une particularité d’Ariane 6 par rapport à Ariane 5 : dans une logique de développement durable, le dernier étage est en effet redirigé vers l’atmosphère pour être désintégré.
Les enjeux étaient considérables pour l’Europe. D’abord, parce que ces vols, auxquels nous pouvons ajouter le retour en vol de Vega‑C, marquent le retour de la pleine autonomie d’accès à l’espace pour le continent.
Ensuite, parce que le premier vol commercial d’Ariane 6 a permis le lancement du satellite d’observation militaire CSO‑3 (N.D.L.R. : troisième et dernier satellite du programme MUSIS, qui marque l’achèvement du cycle de renouvellement des capacités spatiales militaires prévu par la loi de programmation militaire 2024–2030), et ce alors que le président de la République discutait avec ses homologues à Bruxelles de la souveraineté européenne.
Enfin, d’un point de vue commercial, parce que les carnets de commande d’Ariane 6 sont pleins, avec des clients aussi bien européens qu’extra-européens, en particulier américains, qui souhaitaient ne pas s’appuyer sur les seuls moyens de SpaceX. Nous avons fait la démonstration qu’Ariane 6 était digne de confiance à un moment crucial de l’histoire de la compétition internationale dans le champ spatial.
L’Europe a pris beaucoup de retard par rapport aux États-Unis sur la question des lanceurs réutilisables. Où en est-elle aujourd’hui ?
C’est en effet une question très importante, pour des raisons évidentes de coût et de développement durable. Nous y travaillons depuis plusieurs années au travers des démonstrateurs Callisto et Themis et aujourd’hui, nous n’avons plus de mur technologique devant nous. Les premiers lancements vont avoir lieu très rapidement : d’abord à faible altitude dès l’année prochaine, puis des vols plus lointains, jusqu’au vol récupérable à l’horizon 2030.

Mais il faut garder en tête qu’il ne s’agit pas seulement de maîtriser la réutilisabilité du lanceur d’un point de vue technologique : cela nécessite aussi une évolution en profondeur de l’outil industriel. Aujourd’hui, celui-ci est dimensionné pour produire une douzaine de lanceurs Ariane 6 par an. Avec l’avènement d’un lanceur réutilisable, le nombre de lanceurs produits chaque année diminuera mécaniquement. On comprend bien alors que c’est tout le modèle économique et industriel ainsi que toute la courbe d’apprentissage qui sont impactés. Les industriels y travaillent, et nous les accompagnons.
L’autonomie d’accès à l’espace passe aussi par une base de lancement souveraine… La France dispose du Centre spatial guyanais (CGS), qui est en cours de modernisation. En quoi consistent les évolutions apportées au site ?
L’Europe, et au sein de l’Europe la France en particulier, ont des outils, des compétences et des sites exceptionnels : le CSG en est un, du fait de son emplacement unique au monde. Sa proximité avec l’Équateur donne l’opportunité, pour les lancements vers l’est, de tirer un profit maximal de l’effet de fronde lié à la rotation de la Terre sur elle-même. Son implantation sur la façade atlantique permet également de ne pas survoler de terres, et donc de potentielles habitations, lorsque nous tirons vers le nord ou l’est. La base est de plus à l’abri des phénomènes météorologiques majeurs comme les cyclones.
Nous disposons donc d’un site très stratégique. Les programmes de modernisation, démarrés il y a 2–3 ans et qui devraient aboutir en 2026, visent à la fois à rendre la base plus sobre énergétiquement, à augmenter les cadences, à pouvoir opérer des lanceurs différents, Ariane 6, Vega‑C bien sûr, mais aussi les démonstrateurs réutilisables et des mini et micro-lanceurs, comme le lanceur léger partiellement réutilisable Maia qui est en cours de développement. L’objectif est de faire du centre un port véritablement multi-lanceurs.
Les États-Unis ont effectué 156 lancements en 2024, dont 132 par le Falcon 9 de SpaceX. L’ensemble de lancement de Kourou est dimensionné pour 12 lancements annuels d’Ariane 6. Cette cadence suffira-t-elle à couvrir les besoins européens ?
En effet, la comparaison peut interpeller… Il faut toutefois prendre en considération plusieurs éléments. Nous pouvons d’abord envisager d’augmenter la cadence, c’est toujours possible. Mais il faut surtout noter que les logiques spatiales européennes et américaines sont tout à fait différentes. Les États-Unis veulent occuper le terrain dans tous les sens du terme : poser le pied sur Mars, implanter des bases lunaires, multiplier les satellites en orbite, fournir des services commerciaux de communication à l’ensemble du globe, etc. Cela conduit notamment aux méga-constellations d’Elon Musk. Rappelons-nous qu’il n’y a pas si longtemps, seulement 2 000 satellites orbitaient autour de la Terre. Aujourd’hui, on en compte 9 000, dont 7 000 satellites de Starlink, qui envisage d’aller jusqu’à 40 000. L’Europe, en parallèle, a une logique tout à fait différente de développement du spatial, qu’elle veut à la fois raisonné et raisonnable. Répondre à nos besoins dans les années qui viennent, c’est donc déployer quelques centaines de satellites tout au plus, en particulier la constellation IRIS², signée par la Commission européenne en fin d’année dernière qui en comptera 300. Les capacités européennes de lancement pourront y suffire.
L’Agence spatiale européenne (ESA) se penche sur l’utilisation du nucléaire, déjà opérationnelle sur les missions américaines, à la fois pour l’alimentation des systèmes spatiaux et pour la propulsion. Quelle est la position du CNES à ce sujet ?
L’utilisation du nucléaire contribuerait à notre souveraineté dans le domaine spatial, car certaines applications ne peuvent se contenter de panneaux solaires : les installations pérennes sur la Lune ou les missions d’exploration du système solaire lointain, par exemple. La France, étant à la fois une grande puissance spatiale et une grande puissance nucléaire, a les capacités technologiques et industrielles de développer aussi bien de petits systèmes type RHU (radioisotope heater unit) et RTG (radioisotope thermoelectric generator) pour produire de la chaleur et de l’électricité, que des micro-centrales pour propulser des vaisseaux lourds ou pour produire de l’énergie sur une éventuelle future base lunaire.
Mais d’autres questions se posent. D’abord, la question de l’acceptation sociétale de tels lancements, liée au territoire de la Guyane, et ensuite une question budgétaire : la qualification de Kourou, mais surtout le développement des systèmes demanderont des investissements financiers importants – plusieurs milliards d’euros pour les micro-centrales. Il faudra donc rechercher autant que faire se peut à mutualiser applications civiles et militaires, mais aussi terrestres et spatiales.
Quelle priorité accorder à ce sujet dans le contexte actuel, qui nécessite des investissements importants sur de nombreux plans ? C’est une question que les décideurs politiques devront trancher au niveau européen.