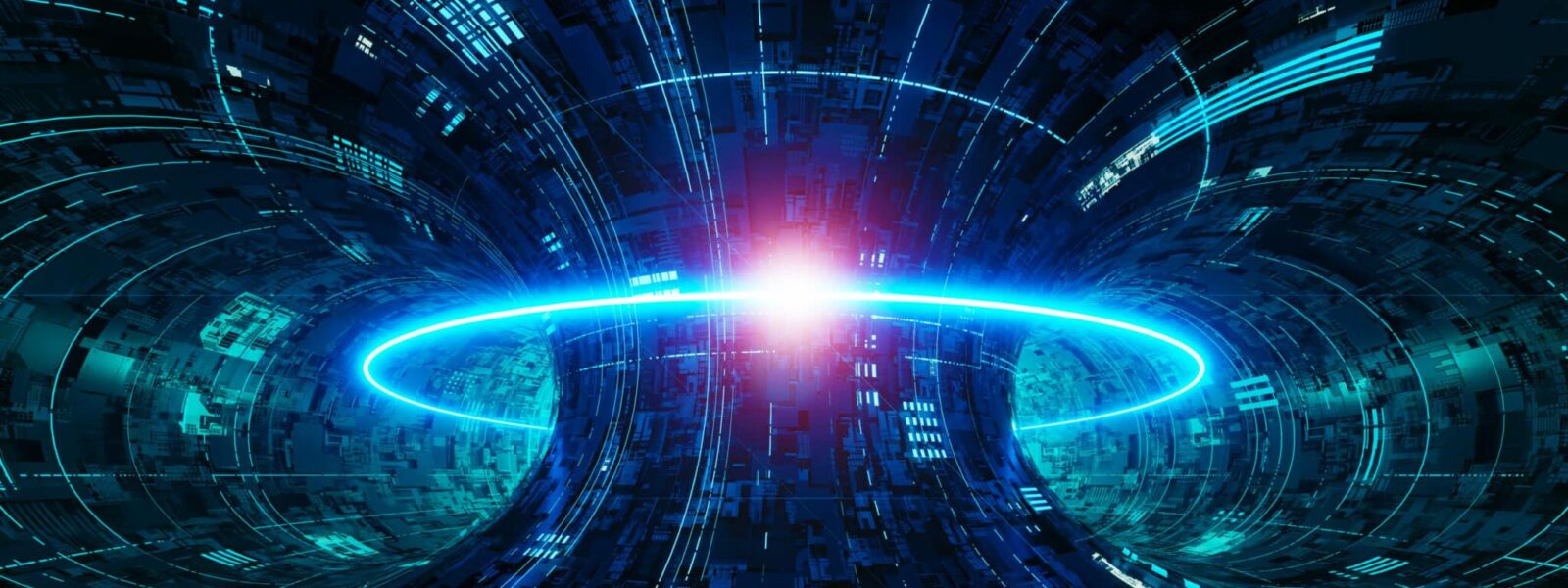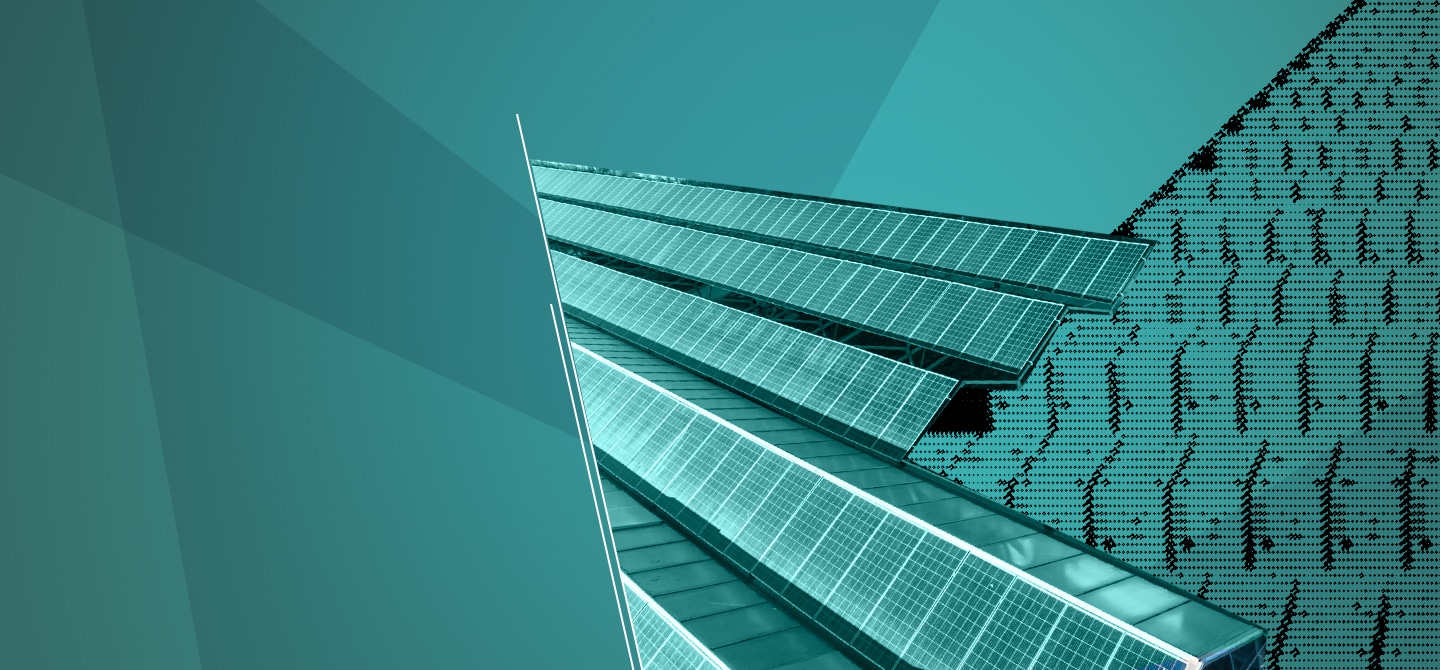L’énergie dans la prospective de très long terme
- Le réchauffement climatique oblige à se projeter dans un monde très différent, où la question de l’énergie est cruciale.
- L’innovation technologique est au centre de nombreux scénarios, non sans raison : des ruptures majeures ont déjà eu lieu depuis dix ans.
- La prospective impose aussi de penser un futur où aucune innovation de rupture n’a changé la donne.
- Les pays riches évoluent rapidement ; les émergents et les pays pauvres pourraient suivre selon une logique de leapfrogging, en adoptant directement des solutions décarbonées.
- Mais la compétition pour les ressources oblige aussi à considérer des scénarios de tensions géopolitiques.
Le think tank Zenon s’essaie à la prospective de très long terme. La question de l’énergie pose-t-elle des problèmes particuliers ?
La prospective essaie de tracer les voies possibles pour le futur. Le prospectiviste ne se contente pas de tirer des lignes à partir de ce qui existe, il intègre à sa réflexion la possibilité de nouveautés plus ou moins radicales. Mais dans le cas de l’énergie, les futurs possibles sont encadrés par un certain nombre de contraintes. La première est l’exigence de décarbonation, qui s’impose comme un cadre général sur cette question.
Si l’on évoque souvent la date de 2050, c’est à la fois parce que c’est une balise importante dans ce cadre, avec l’objectif de neutralité carbone (pour avoir une chance de rester sous 1,5 °C de réchauffement global), et parce que l’horizon de 25 ou 30 ans est assez courant : les prospectivistes ont l’habitude de raisonner à moyen terme. Mais il est possible, sans tomber dans la science-fiction, de reculer cet horizon et de raisonner sur le long terme.
Cela tient au fait que les modèles climatiques dans lesquels s’insère notre question tournent à très long terme, du fait de forts effets d’inertie. La chaleur ou la salinité des océans, les grands courants marins et même certains flux atmosphériques subissent déjà des modifications qui commencent à produire leurs effets, et qui ne sont pas réversibles à court ou moyen terme. De même, on peut réduire significativement les émissions annuelles de CO2, mais réduire le stock de CO2 contenu dans l’atmosphère est une affaire d’une tout autre ampleur ; or ce stock est le principal déterminant de ce qui se jouera dans les prochaines décennies. Enfin, nos équipements forment eux aussi un stock : 14 % des automobiles vendues en 2022 sont électriques, soit 11 millions de véhicules ; mais il y a 1,4 milliard de voitures sur les routes dans le monde.
Le long terme s’impose, donc. Mais le risque n’est-il pas de se dire que d’ici 50 ans, on aura trouvé la solution miracle et qu’il n’y a pas lieu de s’affoler ?
La prospective impose d’explorer des scénarios comportant des ruptures, qu’elles soient technologiques ou autres. Plus nous échouons à baisser nos émissions rapidement (et donc plus la probabilité de tenir les engagements de l’Accord de Paris sur le climat diminue), plus les scénarios vont inclure des technologies encore en stade de développement. La possibilité de gérer un « overshoot » [dépassement, ndlr] de température par exemple, implique d’avoir des scénarios de type net-négatif qui diminuent les stocks de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Mais en ce moment, au contraire, les émissions de méthane explosent ! Ce sont notamment des politiques ambitieuses qui peuvent changer la donne. Même si l’exemple du méthane illustre bien la complexité de ces questions, marquées par des boucles de rétroaction : pendant les confinements, on a émis moins de polluants (CO, NOx), or ces derniers aident la chimie de la décomposition du méthane dans l’atmosphère. Tous les systèmes sont couplés.
Parmi les innovations de rupture qui peuvent survenir, on mentionne souvent la fusion nucléaire, ou encore la géoingénierie (le contrôle du rayonnement solaire pour refroidir la terre – qui pose d’énormes questions). Il y a aussi celles qui se produisent sous nos yeux : comme les batteries, dont le prix a diminué de 90 % en dix ans pendant que la densité énergétique a presque doublé. C’est un game changer sur la mobilité, et il y a quinze ans on ne pouvait pas l’imaginer. Or la possibilité du stockage, peu cher, rend pertinentes d’autres applications.
Mais la prospective impose aussi de penser un futur où aucune innovation de rupture n’a changé la donne. Même si la fusion nucléaire était disponible aujourd’hui, il faudrait trente ans pour la déployer. Il faut donc alors passer par le court terme et prolonger les tendances, pour comprendre comment on peut les infléchir. La prospective raisonne aussi à partir des points d’arrivée, en traçant les scénarios qui permettent d’y parvenir. On fait des hypothèses, et on précise les conditions devant être remplies.
Prenons une hypothèse globale, systémique : la décarbonation. Pour dessiner ses voies possibles, on se demandera d’abord ce qu’on peut électrifier, puis ce qui peut être transféré sur l’hydrogène, puis sur le biogaz ; puis on boucle le raisonnement. L’exploration du comment, des conditions, amène à prendre en compte les spécificités d’un territoire – l’éolien offshore n’est pas possible partout ! Mais ces conditions évoluent, parfois très vite. Sur des questions clés comme la mobilité et la production d’électricité, le mouvement est lancé et on observe aujourd’hui une croissance exponentielle. Grâce à des efforts politiques, des réglementations, des subventions, on n’est plus très loin de la parité en termes de prix (si l’on raisonne en coût total de possession, pour les véhicules ou, pour les énergies renouvelables, en coût actualisé du kWh, une métrique qui prend en compte l’ensemble des coûts et productions d’un équipement sur sa durée de vie). On arrive à un moment où le marché pourra fonctionner sans subventions. Sur d’autres terrains, comme l’hydrogène par exemple, il faut toujours des subventions.
Toutes ces évolutions ont lieu dans les pays riches. Le défi n’est-il pas dans les pays émergents et pauvres ? Et dans ce cas, quels sont les scénarios possibles ?
Si on raisonne en prospective, on voit apparaître deux scénarios très différents. Le premier, optimiste, est le leapfrogging [effet « saute-mouton », ndlr] : ces pays adoptent directement des solutions décarbonées. Ce qui va à l’appui de cette hypothèse, c’est qu’en Afrique, par exemple, les réseaux sont à créer, et la question de l’intermittence est différente quand on part de rien ou presque. Il n’y a pas de dépendance au chemin. Le point faible de cette hypothèse, ce sont les investissements, avec en arrière-plan la question de la stabilité financière. L’Inde, par exemple, est un gros consommateur de charbon, produit localement. Lors de la dernière COP, elle a dit oui pour accélérer sa transition – mais réclame des moyens pour le faire.
On tombe ici sur des questions politiques, avec des choix publics, pour les pays émergents, s’engager ; pour les pays riches, les aider (ou à tout le moins de ne plus faire d’investissements fossiles dans les pays émergents). Problème, tous ces choix interfèrent : le Pakistan, ainsi, est repassé au charbon depuis que l’Europe, pour se passer du gaz russe, s’est tournée vers le GNL. Si on achète plus d’une ressource (dont la production ne peut augmenter instantanément), on coupe l’accès au marché de quelqu’un d’autre. Et inversement si on se détourne d’une ressource, on la rend plus accessible à d’autres acquéreurs. Ce qui nous amène à un deuxième scénario, où le charbon, le gaz et le pétrole que nous ne consommons plus le seront dans les pays émergents et pauvres.
Une partie de l’équation se joue dans l’équilibre encore incertain entre la Chine, fournisseur de la transition (panneaux solaires, nucléaire, batteries, véhicules électriques) et les pays développés qui tentent de récupérer leur souveraineté industrielle. Conséquence : une compétition pour les ressources et les métaux critiques que sont le lithium, le cobalt, les terres rares. Les tensions liées à cette compétition sont-elles prises en compte par les prospectivistes ?
Cette question renvoie à celle des chocs politiques extrêmes. Ils sont peu pris en compte dans les modèles (un des cinq scénarios, dits SSP, du GIEC prend en compte les « rivalités régionales »). On prend davantage en compte les effets des crises climatiques sur la production (agricole notamment), mais peu la possibilité de chocs géopolitiques ou d’écroulements étatiques. Le pari implicite, c’est que les chocs seront résorbés, que le marché trouvera la solution. Du reste, c’est ce qu’il fait dans beaucoup de cas : ainsi la crise du lithium annoncée depuis dix ans n’a pas eu lieu, on a trouvé les solutions et augmenté fortement la production et les réserves. Mais c’est aussi par manque d’imagination, et par qu’ils sont difficiles à modéliser, qu’on mobilise peu ces scénarios extrêmes.
On pourrait procéder comme on le fait en gestion de projet : repérer les risques et faire en sorte qu’ils n’adviennent pas ; faire évoluer les scénarios. Mais nous avons tendance à vouloir suivre un scénario, plutôt que de le faire dialoguer avec un autre pour imaginer d’autres chemins. C’est un des grands malentendus des travaux de prospective : ceux qui les lisent croient qu’il faut choisir un scénario ou un autre. La leçon du passé, c’est que nous bricolons et que nous nous adaptons.