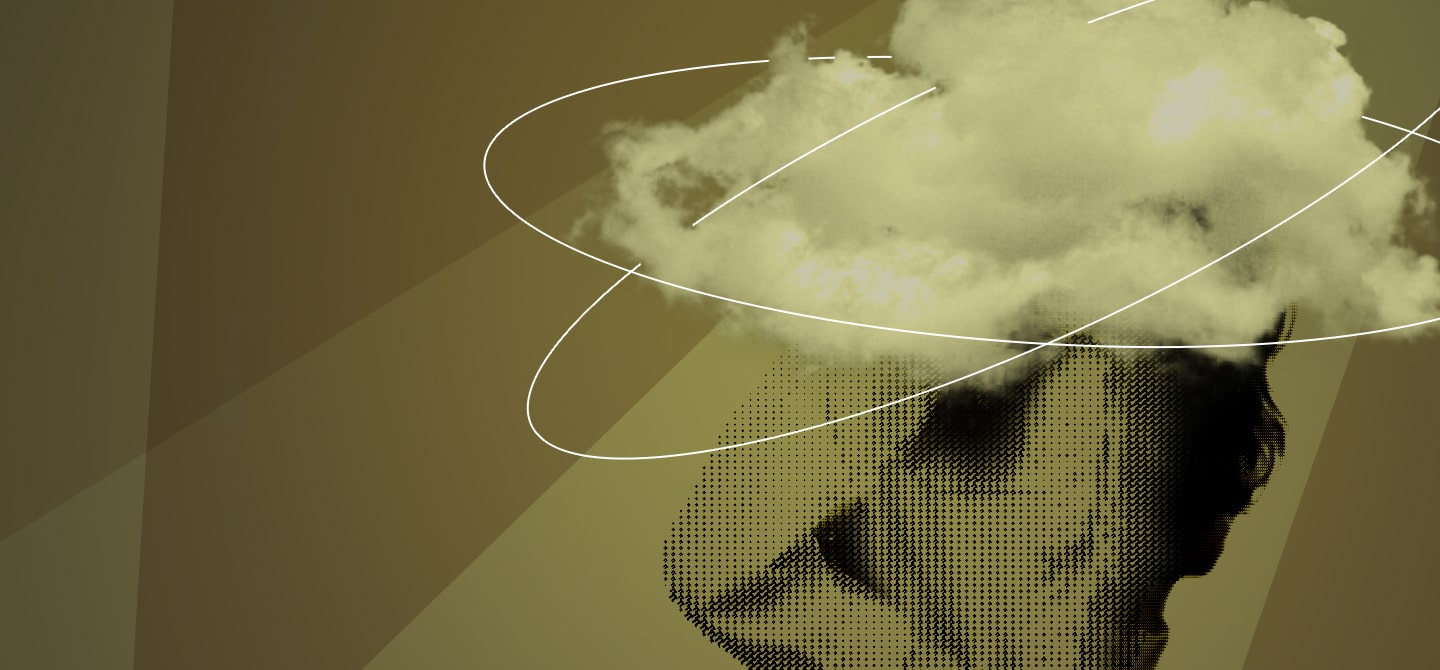Trois croyances qui empêchent les entreprises d’affronter une crise
- En temps de crise, ce qui fait la différence est la capacité à identifier nos modèles mentaux pour les remettre en question.
- L’identité de l’entreprise peut devenir un piège si on s’y enferme : le salut peut se trouver dans une réexploration de cette identité.
- Il faut se méfier du consensus en temps de crise, et ne pas hésiter à le suspendre s’il se forme trop vite.
- Le vrai leadership consiste à cultiver le modèle qui a fait ses preuves par le passé sans pour autant le laisser se pétrifier.
- Les modèles mentaux sont utiles jusqu’au moment où nous les oublions : un peu de méthode permet de ne pas s’y laisser piéger.
Comment décider dans un monde incertain ? On ne peut élaborer une stratégie qu’à partir d’hypothèses. Sur la durée, celles-ci se figent et deviennent des modèles mentaux. Tout le problème est que nous vivons dans un temps de moins en moins linéaire. La multiplication des surprises amène l’obsolescence accélérée de certaines de nos croyances. Ce qui fait la différence, alors, est la capacité à identifier nos modèles pour les remettre en question. C’est difficile, souvent coûteux. Mais la survie d’une entreprise peut en dépendre.
Voici trois points où peuvent s’enkyster des modèles mentaux. Et trois façons de ne pas se laisser piéger.
#1 L’identité
La cultiver sans s’y cramponner
La vogue de la raison d’être a remis l’identité au centre du jeu. « Qui sommes-nous ? » prendrait presque le pas sur « que faisons-nous ? » Mais les deux questions se rejoignent sur une intuition très forte : les entreprise sont des sociétés humaines et chacune a sa propre identité. S’appuyer sur cette identité permet de mobiliser les troupes, de dégager une stratégie, de rappeler les fondamentaux. Peu importe alors qu’on mette l’accent sur les valeurs, ou sur le cœur de métier.
Le problème, c’est que l’identité est aussi un piège. Plus précisément : elle devient un piège si on l’enferme dans l’évidence et les formules toutes faites. Face à une crise existentielle, s’accrocher à cette identité routinière peut être fatal. À l’inverse, le salut de l’entreprise peut se trouver dans une réexploration de cette identité. Deux exemples l’illustrent parfaitement, le premier souvent cité, le second moins connu.
L’identité devient un piège si on l’enferme dans l’évidence et les formules toutes faites.
Les mésaventures de Kodak sont une parabole de ce qu’il ne faut pas faire face à un changement majeur de paradigme. C’est chez Kodak, à Rochester, que dans les années 1960 un ingénieur a inventé la photographie numérique. Mais la firme est passée à côté de cette révolution parce que son cœur de métier, c’était le papier photo. Le modèle mental, ici, c’était son modèle d’affaire. Un business model si profitable qu’elle n’avait aucun intérêt à se remettre en question… jusqu’au jour où le marché a disparu, et l’entreprise avec lui.
Le contre-exemple moins connu de Kodak, c’est son concurrent Fujifilm. Secouée par la même révolution, l’entreprise japonaise a su s’interroger sur son identité et ne pas s’arrêter à l’évidence. De cette interrogation a surgi une découverte : le métier du papier-photo, ce n’est pas le papier, ni la photo. C’est la chimie. C’est en redéployant cette identité de chimiste que Fujifilm a su s’inventer un avenir.
#2 Le consensus
Apprendre à le mettre en suspens
Pour s’arracher à l’évidence, les dirigeants et salariés de Fujifilm ont dû faire un effort de réflexion. Ils ont dû prendre de la distance par rapport à leur activité, aux représentations qu’ils s’en faisaient. Et s’avouer qu’ils allaient dans le mur. Pas facile de dire que le roi est nu ! Qui sera le premier à l’énoncer ?
La question implicite, ici, c’est le consensus. Lui aussi a bien des avantages en temps normal : quand on s’entend bien au sein d’une entreprise, on travaille mieux, plus vite, sans perdre de temps à se chamailler ou à devoir tout justifier. Par gros temps il permet aussi à l’organisation de faire corps. Mais face à l’incertitude, en cas de crise grave, de disruption majeure, bref, quand on passe du continu au discontinu, le consensus devient dangereux, et potentiellement désastreux. Voici un exemple historique qui raconte comment un consensus trouvé un peu trop vite aurait pu avoir des conséquences terribles.

En 1962, la crise de Cuba place l’exécutif américain devant une menace existentielle : l’URSS envoie des missiles nucléaires sur l’île, les bateaux sont en route. Le comité réuni par Kennedy tombe vite d’accord : la seule option efficace, certes terrible, est de raser Cuba. Le président prend alors la parole : « J’entends bien. Mais comment nos enfants nous jugeront-ils ? » Et il sort de la pièce. Ce moment est fondamental : en sortant, le président permet qu’une autre dynamique de groupe se crée, qui permettra en quelques jours de faire émerger des solutions différentes, dont celle du blocus qui sera finalement adoptée.
Le geste de Kennedy consiste à rouvrir le jeu, en changeant les conditions de la discussion. Alfred Sloane, le mythique dirigeant de General Motors, s’était fait une règle de ne pas laisser s’établir trop vite un consensus. « Tout le monde est d’accord ? lançait-il. Vraiment ? Alors je remets la décision à la semaine prochaine. » Et dans l’intervalle quelques-uns de ses collaborateurs venaient le voir avec des idées nouvelles.
Kennedy et Sloane n’étaient pas des personnalités timorées qui avaient peur de trancher. Ils nous offrent une leçon : il faut se méfier du consensus, et ne pas hésiter à le suspendre s’il se forme trop vite.
#3 Le leadership
Se méfier de sa propre autorité
Jeff Bezos, le patron d’Amazon, est réputé pour sa dureté et son caractère opiniâtre, voire entêté. Mais il s’impose presque toujours, dans une réunion, de parler en dernier, sans quoi la discussion se fixerait trop vite autour de ses idées.
On voit ici un leader charismatique qui se méfie de sa propre autorité et qui, dans le même esprit que Kennedy ou Sloane suspendant le consensus, met sa parole en suspend, afin de favoriser l’expression de ses collaborateurs.
Car le leadership est lui aussi un modèle mental, d’autant plus piégeant que se conjuguent une dynamique personnelle (un individu s’enferme dans un modèle, par exemple parce qu’il lui a réussi dans le passé) et une dynamique sociale (le style de management du chef finit par se communiquer à l’organisation).
C’est tout un art d’apprendre à s’extraire de son propre modèle de leadership.
Le vrai leadership consiste à la fois à cultiver ce modèle, source d’efficacité, et à ne pas le laisser se pétrifier. C’est tout un art d’apprendre à s’extraire de son propre modèle de leadership.
Cela ne signifie pas de s’en passer, et encore une fois, il n’y a pas de bons ou de mauvais modèles. Prenons la « verticale du pouvoir », remise à la mode par certains dirigeants politiques depuis une vingtaine d’années. On le sait, le caractère descendant de la décision finit par entraver la remontée d’information. Pour autant ce modèle a aussi des qualités : une entreprise très verticale peut aussi être très innovante, car le chef protège ses subordonnés. C’était le cas d’Apple sous la direction de Steve Jobs.
Mais des problèmes apparaissent quand le modèle se transforme en évidence et qu’on ne sait plus l’interroger. Un patron britannique, ainsi, me confiait son problème : pas assez de « team engagement ». Il admettait ne pas demander leur avis à ses collaborateurs, mais s’en justifiait en expliquant qu’il ne voulait pas miner son leadership. Soucieux d’être respecté, il s’était laissé enfermer dans un modèle mental dont il était incapable de sortir. Encore était-il capable de saisir que cela ne fonctionnait pas ! De simples ajustements ou des solutions techniques ne suffisent pas à corriger ce type de dysfonctionnement. C’est le modèle lui-même qu’il faut mettre à distance.
Tout modèle de leadership gagnerait à être « mis sur la table » de temps à autre. Ou tout au moins à sortir de sa zone de confort. Une bonne façon de le faire consiste à se dépayser, y compris physiquement. D’autres choses se diront, on verra d’autres choses. Essayez de tenir une réunion dans une usine et non pas dans la salle du conseil, par exemple. Une autre méthode consiste à favoriser, au sein des instances de délibération et de décision, une forme de diversité – non pas tant « morale » que cognitive. Des parcours différents, des gens ayant été à l’épreuve du terrain, seront un plus dans un conseil d’administration.
Qu’en conclure ?
Les dirigeants et les organisations qui ont su se sortir de crises graves ont été capables d’identifier leurs modèles, d’interroger leur identité, de casser des consensus pour rouvrir le jeu. Les modèles mentaux sont des habitudes auxquelles nous ne prenons plus garde. Ils sont utiles… jusqu’au moment où nous les oublions. Un peu de méthode permet de ne pas s’y laisser piéger.