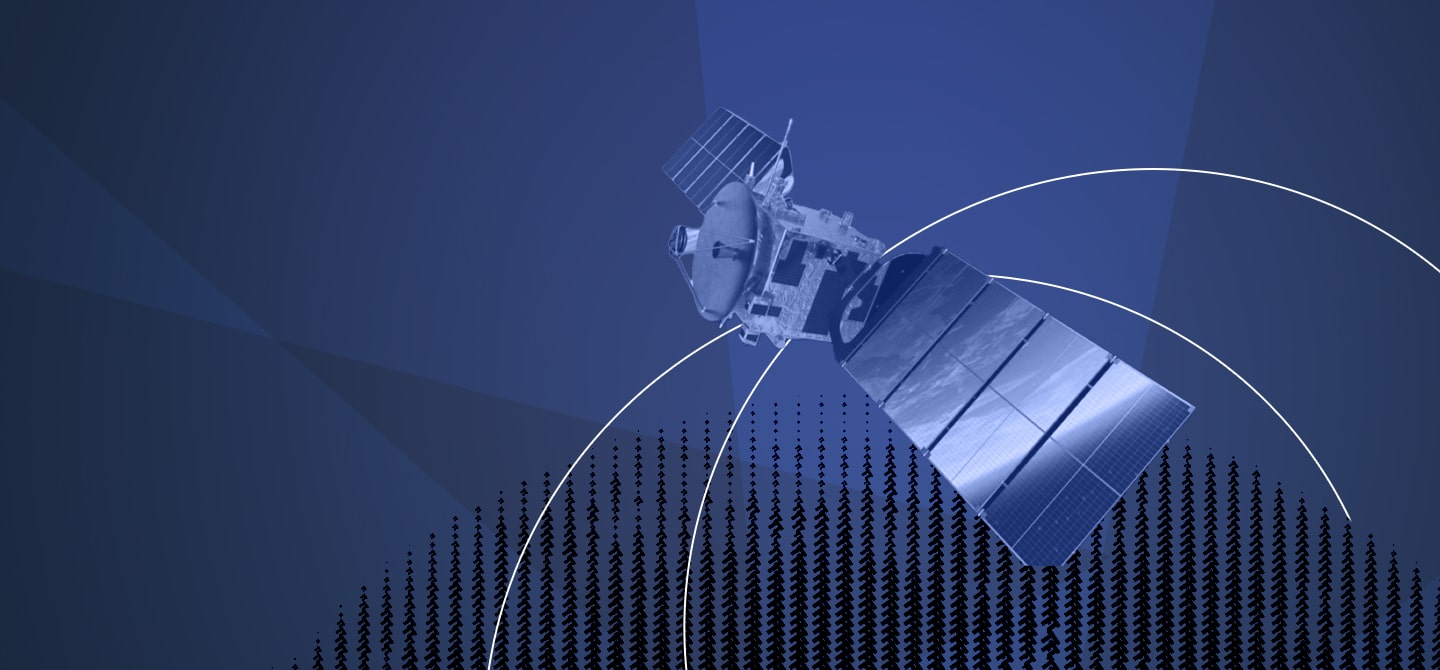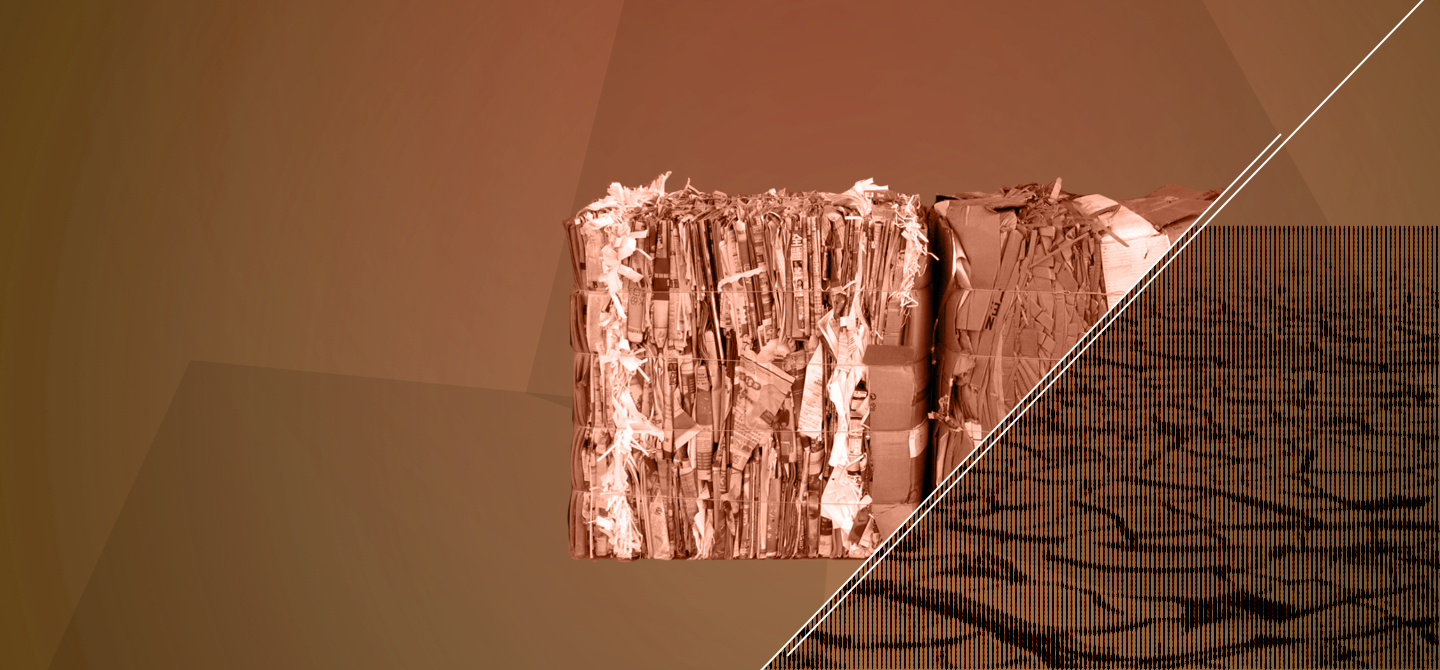Tarifs douaniers : « Le monde est perçu comme une arène de combat et non plus un espace de coopération »
- Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a placé les tarifs douaniers au cœur des préoccupations internationales.
- Le mercredi 9 avril, les partenaires commerciaux sont désormais soumis à des droits de douane uniformisés à 10 %, à l'exception de la Chine, taxée à 125 %.
- Cette politique géoéconomique et « compétitiviste » est en rupture avec la vision internationaliste qui prévalait depuis Franklin D. Roosevelt jusqu'à Barack Obama.
- L'UE a préparé des mesures pour riposter aux menaces américaines ; elles concernent les droits de douane sur une sélection de produits américains.
- Les inquiétudes concernant les impacts à long terme se concentrent principalement sur les investissements directs étrangers : 40 % des IDE américains sont en Europe.
Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a placé les tarifs douaniers au centre des préoccupations internationales. Jamais ils n’ont été autant discutés et modifiés. Avant cet épisode, comment étaient-ils habituellement établis ?
Christian Deblock. Au cours de l’histoire, les tarifs ont progressivement été abaissés jusqu’à perdre leur place centrale lors dans les négociations commerciales entre les États. Cependant, chaque pays reste maître de ses tarifs, car il s’agit d’un droit de souveraineté. Depuis la Seconde Guerre mondiale, par la mise en place du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, signé en 1947) puis de l’OMC (Organisation mondiale du commerce, créée en 1995 par l’accord de Marrakech), les tarifs ont largement été réduits et réglementés, avec pour objectif final d’harmoniser les pratiques et de libéraliser totalement les échanges internationaux.
Aujourd’hui, environ 80 % du commerce international se fait sur le principe de la nation la plus favorisée. Après des séries de négociations, les États se sont engagés à respecter des taux de droit de douane maximaux, autrement dit des « tarifs consolidés », tandis que les « tarifs effectifs » correspondent aux taux appliqués en pratique. Ainsi, grâce aux tarifs consolidés, les échanges internationaux jouissent d’une meilleure prévisibilité et d’une plus grande stabilité.
À côté du tarif multilatéral, il existe une seconde catégorie liée à des accords régionaux, comme ceux de l’ALENA/ACEUM, du Mercosur ou de l’Union européenne. Enfin, et de façon plus marginale, il existe des accords préférentiels appliqués pour les pays en développement, sans réciprocité. À ce panorama, il faut ajouter les mesures dites de « correction appliquées » lorsque des pays utilisent des pratiques déloyales comme le dumping ou le subventionnement.
Au fil des négociations, les règles du commerce international ont été renforcées, tout comme les procédures de règlement des différends. Le tout pour éviter les abus et l’unilatéralisme des membres.
Les États-Unis se sont dotés d’outils législatifs pour conserver une marge de manœuvre face aux réglementations internationales. Quels sont-ils ?
Bien que l’architecture des règles autour du commerce international soit solidement établie, les États-Unis bénéficient d’une marge de manœuvre notable. Par la section 301 du Trade Act de 1974, le représentant au Commerce peut suspendre les concessions commerciales ou imposer des mesures de restriction, s’il est démontré que le partenaire commercial viole ses engagements commerciaux ou a des pratiques discriminatoires. Dénoncé par plusieurs pays, l’OMC a cependant validé ce mécanisme. C’est précisément cet outil qui est aujourd’hui utilisé à l’encontre de la Chine.
Autre levier, la section 232 du Trade Expansion Act de 1962 donne la possibilité au président d’imposer des tarifs ou de prendre toute autre mesure si une augmentation substantielle des importations est de nature à causer ou menacer des torts irréparables à une industrie ou à l’économie américaine. Mentionnons encore l’International Emergency Economic Powers Act de 1977, auquel a eu recours le président Trump le 2 avril 2025.
Une véritable stratégie derrière les hausses des droits de douane ?
Dès son premier mandat, Donald Trump avait amorcé une hausse globale des droits de douane. En revanche, les annonces se succédaient les unes après les autres selon une certaine logique : les mesures visaient d’abord l’ALENA – qualifié par le président américain comme « le pire accord jamais signé par les États-Unis » – avant de s’attaquer à la Chine, puis de cibler l’Union européenne.
Le deuxième mandat de Trump se distingue par la brutalité des méthodes employées et par l’accumulation de mesures tous azimuts. Aucun partenaire n’est épargné. Le 1er février 2025, trois executive orders envisagent une application de + 25 % des droits de douane sur les importations mexicaines et canadiennes et de + 10 % sur les produits importés en provenance de la Chine. En parallèle, le président Trump a demandé aux différentes agences impliquées de dresser un état des lieux sur la manière dont les pays discriminent les États-Unis en matière commerciale (tarifs, subventions, taxes, réglementations, etc.), et ce pour le 1er avril.

Le résultat est tombé le 2 avril : un tarif général de 10 % et des tarifs supplémentaires dits « tarifs réciproques » pour à peu près tous les pays, à l’exception notable du Canada et du Mexique. Mentionnons par exemple l’UE (20 %), la Chine (34 %), le Japon (24 %) ou encore le Vietnam (46 %), le Cambodge (49 %), Taïwan (32 %). Le mercredi 9 avril 2025, les États-Unis imposent de nouvelles surtaxes sur les produits en provenance de près de 60 partenaires commerciaux, avec des droits de douane additionnels allant de 11 % à 60 %, exception faite pour la Chine, dont les produits sont taxés à 104 %. Cependant, peu après, nouveau retournement de situation : Donald Trump annonce la suspension, pour une durée de 90 jours, des droits de douane réciproques. Les partenaires commerciaux sont désormais soumis à des droits de douane uniformisés à 10 %, à l’exception notable, une fois de plus, de la Chine, cette fois-ci taxée à 125 %.
Cette politique est en rupture totale avec la vision internationaliste qui prévalait depuis la présidence de Franklin D. Roosevelt jusqu’à celle de Barack Obama. Elle est désormais remplacée par une vision géoéconomique et « compétitiviste » du monde. Si, in fine, l’objectif est de recentrer l’économie mondiale sur les États-Unis, cette vision existe déjà ; c’est celle que la Chine défend, avec l’objectif de déloger les États-Unis de sa position encore hégémonique. Mais Donald Trump a‑t-il réellement les moyens de ses ambitions ? Peut-il appliquer les mêmes méthodes que la Chine sans mettre en péril la stabilité économique de son propre pays ?
L’UE a promis de réagir « fermement et immédiatement ». Comment entend-elle riposter ?
Forcée de réagir, l’Union européenne a préparé un paquet de mesures pour riposter aux menaces américaines. Les réactions avaient été immédiates, bien que, dans les faits, relativement prudentes. Des mesures de riposte concernant une sélection de produits américains ont donc été prises. Cette réaction prudente s’explique d’abord par la volonté d’éviter une escalade avec un partenaire commercial extrêmement puissant, mais également pour éviter de s’attaquer à des produits dont la chaîne de valeur est mondialisée. Il est plus aisé de taxer des oranges que des pièces automobiles d’un véhicule fabriqué et assemblé dans différents pays.
Mais depuis 2 avril 2025, Donald Trump a bousculé toute l’organisation des chaînes de valeur. La véritable question est de savoir si l’Union européenne va basculer ou non dans la géoéconomie du compétitivisme. Le rapport de Mario Draghi, présenté à Bruxelles en septembre 2024, alarmait déjà sur la perte de compétitivité des entreprises européennes face aux géants américains et chinois. Il pointait les dangers qui planent au-dessus de l’UE et appelait les États membres à repenser les politiques commerciales. Les valeurs européennes s’inscrivent toujours dans l’internationalisme libéral mais face à la brutalité des méthodes actuelles, est-ce la bonne stratégie ?
Tous perdants ?
Naturellement, avec les nouvelles mesures voulues par l’administration Trump, l’économie mondiale subira inévitablement des conséquences. Les échanges seront perturbés, fragilisant la stabilité dont le monde des affaires a besoin pour fonctionner. Partout, une augmentation des prix et des chocs économiques est à prévoir. D’après la majorité des modèles, ce sont les économies les plus fragiles qui seront les premières et les plus durement touchées.
Les Européens ne doivent pas sous-estimer l’impact sur leur propre marché. Certes, deux tiers de son commerce est réalisé en interne mais tous les pays membres ont des excédents commerciaux avec les États-Unis. Les inquiétudes pour les impacts à long terme se portent principalement sur les investissements directs (IDE) américains : 40 % des IDE américains sont en Europe (en Irlande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, etc.). Un mouvement de rapatriement des capitaux vers les États-Unis mettra à mal bon nombre d’économies européennes, en premier lieu l’Irlande, particulièrement exposée, puisque la moitié de son PIB dépend des multinationales américaines.
Un tournant géoéconomique
La logique de rivalité a pris le dessus dans les affaires internationales, les acteurs sont désormais guidés par une vision compétitiviste et stratégique. Les États-Unis agissent au nom de l’urgence économique nationale et optent pour un unilatéralisme exacerbé. Le monde est perçu comme une arène de combat et non plus comme un espace de coopération. La guerre commerciale est une guerre de plus parmi tous les terrains d’affrontements qui existent.