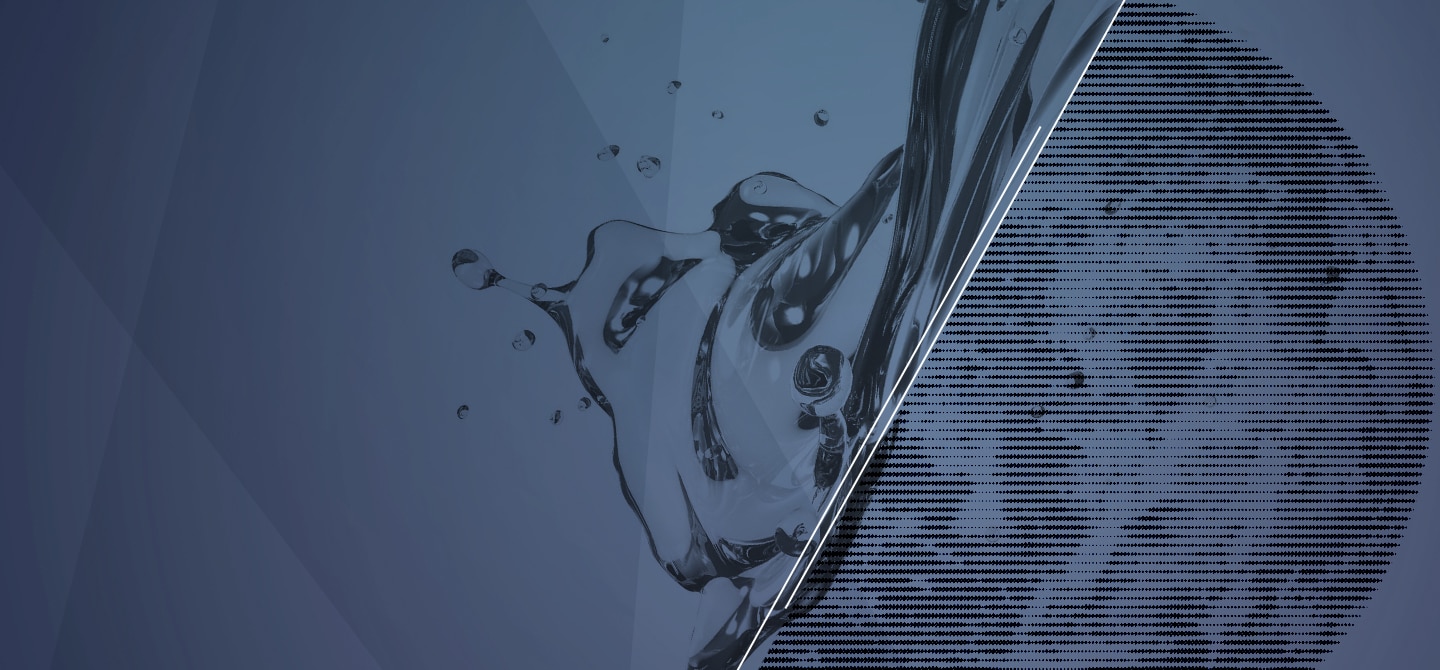Le désordre créé par Trump conjugué au plan de relance allemand est-il une chance pour l’Europe ?
- Les États-Unis sous Donald Trump confrontent l’Europe à des enjeux essentiels : le protectionnisme, le réchauffement climatique et la militarisation.
- Contre le protectionnisme, l’Europe peut développer une stratégie de libre-échange avec des pays d’Amérique latine, le Canada, et d’autres acteurs mondiaux.
- L’Europe doit poursuivre ses efforts de décarbonation, ce qui lui donnera un avantage technologique et lui permettra de soutenir globalement le PIB.
- Les pays européens pourraient être amenés à assurer leur propre défense, ce qui a poussé Friedrich Merz à demander une modification des règles budgétaires en Allemagne.
- 300 milliards d’euros d’épargne des européens sont aujourd’hui investis aux E-U, ce qui changera si l’Europe utilise cette épargne à son avantage à l'avenir.
L’arrivée à la présidence des États-Unis de Donald Trump a créé des désordres de plusieurs types. Tout d’abord, une politique protectionniste avec de fortes hausses des droits de douane, dont l’ampleur et les champs d’application sont encore incertains et fluctuants. Pour l’instant, il s’agit de droits de douane de 25 % sur les importations d’acier et d’aluminium, et de droits de douane additionnels de 10 % sur les importations des États-Unis en provenance de la Chine, mais Trump a annoncé la mise en place de droits de douane beaucoup plus globaux. Ensuite, le retrait des États-Unis de l’accord de Paris et la fin des aides à la transition énergétique, toujours aux États-Unis, avec la volonté de développer les énergies fossiles.
Aussi, la possibilité que des politiques visant à déprécier fortement le dollar par rapport aux autres devises soient mises en œuvre : le président du Conseil des conseillers économiques de la Maison-Blanche, Stephen Miran, s’est fait l’avocat de l’arrêt du rôle du dollar comme monnaie de réserve. Concernant la protection militaire assurée par les Etats-Unis dont bénéficiait l’Europe, une réelle incertitude existe sur son maintien, et beaucoup de pays européens ont, en conséquence, décidé d’accroître leurs dépenses militaires. Enfin, il faut reconnaître que les valeurs de l’Amérique trumpiste (celles défendues en particulier par le vice-président J.D Vance) divergent des valeurs de l’Europe, notamment en ce qui concerne le rôle de la religion, la définition de la démocratie et de la liberté d’expression, la séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, ou encore le traitement des minorités.
Les trois problèmes essentiels auxquels l’Europe va être confrontée sont donc : 1) le protectionnisme des États-Unis, 2) l’arrêt américain du soutien à la transition énergétique, et 3) la fin de l’implication militaire du pays dans la défense de l’Europe… L’Europe a‑t-elle les capacités de répondre à ces trois défis ?
Le protectionnisme américain et la question des politiques contre le réchauffement climatique
Les exportations de biens depuis l’Union européenne vers les États-Unis représentent 2,8 % du produit intérieur brut de l’Union européenne. Si on ajoute les exportations de biens et les exportations de services, on parvient à 4 % du PIB de l’UE. Cependant, il n’a pas été question pour l’instant de mettre des droits de douane sur les échanges de services. Si ces exportations de biens de l’Europe vers les États-Unis sont affectées par des mesures protectionnistes, la solution pour l’Europe sera de développer des échanges et de promouvoir une stratégie de libre-échange avec le Canada, les pays d’Amérique latine, le Royaume-Uni, les pays d’Asie du Sud-Est ou encore l’Inde (les États-Unis représentent 18 % des exportations de biens de l’Union européenne). Le monde du libre-échange, respectant les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce, s’opposerait ainsi aux États-Unis.

En ce qui concerne les politiques climatiques et environnementales, l’Europe doit continuer ses efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En 2023, les émissions de CO2 de l’Union européenne atteignaient 2 600 milliards de tonnes et celles des Etats-Unis 4 700 milliards de tonnes. Deux arguments vont en faveur de la poursuite de l’effort de décarbonation en Europe. D’une part, les analyses les plus récentes montrent un lien très fort entre la température de la planète et la croissance du PIB mondial (Adrien Bilal et ses co-auteurs montrent qu’une élévation de 1 % de la température moyenne de la planète réduirait de 12 % le PIB mondial) ; ce lien est si fort que réduire les émissions de CO2de la seule Europe serait efficace pour soutenir globalement le PIB. D’autre part, les autres pays réalisent l’ampleur des désordres créés par le changement climatique (sécheresses, incendies, ouragans…) et devront décarboner leurs économies, mais avec un retard sur la décarbonation réalisée en Europe, qui aura donc un avantage technologique grâce à sa réaction précoce au changement climatique.
Assurer la défense de l’Europe
Le troisième problème réside en la nécessité qu’auraient les pays européens à assurer eux-mêmes leur défense. La prise en compte de cette nécessité a poussé le futur chancelier allemand, Friedrich Merz, à obtenir une modification des règles budgétaires en Allemagne. La limite fixée au déficit public fédéral (0,35 % du PIB) ne comprendra pas la partie des dépenses militaires au-dessus de 1 % du PIB de l’Allemagne. De plus, il est prévu un plan d’investissement de 500 milliards d’euros en 10 ans, centré sur la rénovation des infrastructures (énergétiques, de transport) et la transition écologique.
L’Europe peut augmenter ses dépenses publiques aujourd’hui en conservant un excédent extérieur (un excédent de sa balance courante) puisqu’elle a actuellement un excédent de près de 3 % de son produit intérieur brut. On peut penser que le déficit public de l’Allemagne va augmenter d’environ 2 points de PIB, que les dépenses militaires de l’ensemble des pays européens pourraient passer de 1,9 % du PIB à 3,4 % du PIB, ce qui est le niveau des dépenses militaires des États-Unis, et que cette hausse se financera sans difficulté en utilisant l’excédent d’épargne des européens.
En conclusion, il faut noter que cette évolution sera très défavorable aux États-Unis. Aujourd’hui, 300 milliards d’euros d’épargne des européens sont investis aux États-Unis ; si l’Europe, pour rénover ses infrastructures et accroître ses dépenses militaires, utilise cet excédent d’épargne, il ne sera plus disponible pour être prêté aux États-Unis, qui connaîtront une crise de leur financement extérieur et devront réduire brutalement leur déficit extérieur, ce qui impliquerait un freinage de la croissance et une forte hausse des taux d’intérêt.