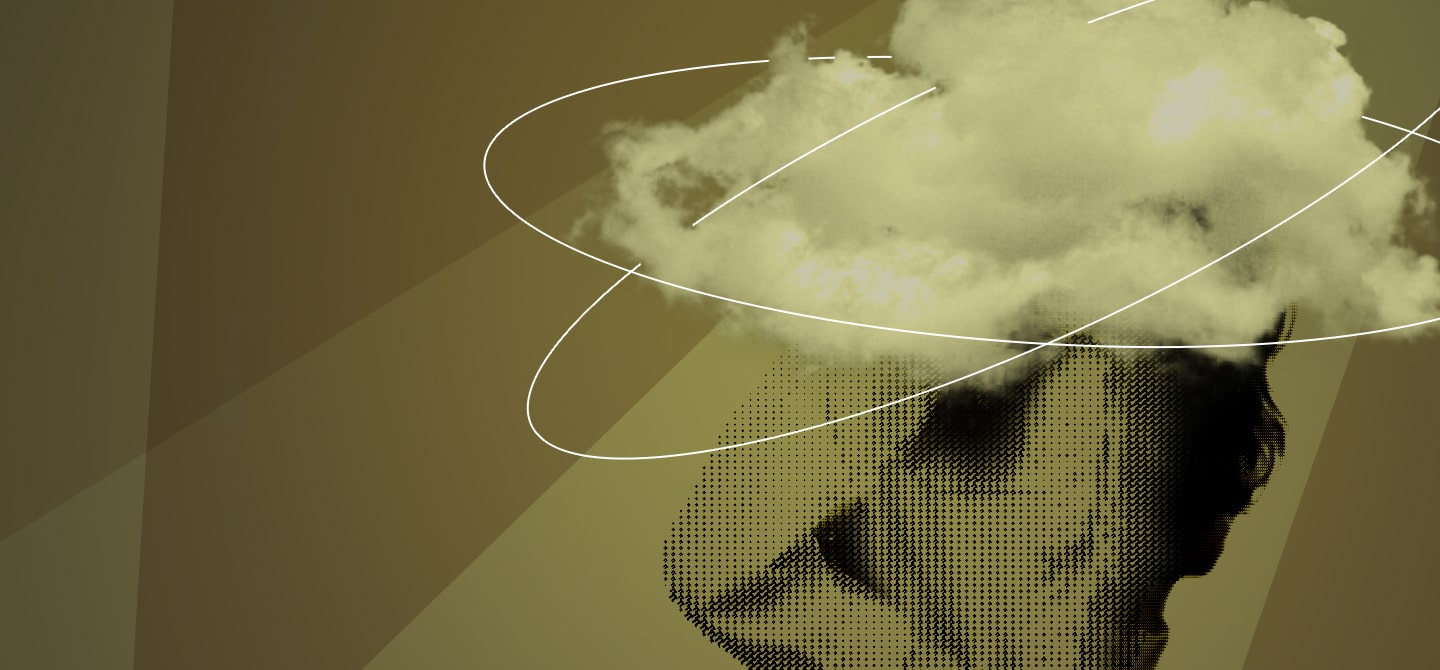Depuis les Trente glorieuses, le taux de pauvreté monétaire, tout comme les inégalités de revenus, ont diminué en France. Mais les données dites objectives suffisent-elles à appréhender la hiérarchie sociale ? Les perceptions des citoyens ne donneraient-elles pas des clés de lecture pertinentes pour mieux comprendre la situation actuelle ? C’est la thèse de Nicolas Duvoux, qui plaide pour une prise en compte de la subjectivité en sciences sociales.
Qu’est ce qui a motivé la rédaction de L’avenir confisqué ?
À l’origine du livre, il y a un constat de décalage, sur le plan scientifique mais aussi social et politique, entre l’appréciation dite objective des phénomènes sociaux et l’appréciation subjective que les personnes concernées en ont. Les inégalités, par exemple, sont traditionnellement considérées à partir des revenus ou des catégories socio-professionnelles. De ce point de vue, dit objectif, nous sommes en France dans une situation moins défavorable que lors de périodes passées ou que dans d’autres pays en Europe. Mais cette approche ne suffit pas à décrire la situation actuelle.
Une analyse subjective, tenant compte par exemple des mouvements sociaux, de la crise de confiance envers les institutions ou encore du niveau de satisfaction général des Français, donne une image beaucoup plus négative de l’état de la société. Comment résoudre ce décalage ? La première manière serait de congédier la vision subjective, en considérant que les Français se trompent dans leur évaluation. L’autre approche, que je défends et met en pratique dans le livre, est de considérer au contraire que la subjectivité est un aiguillon pour une meilleure appréciation de la situation. La thèse de cet ouvrage peut ainsi se résumer de la manière suivante : prenons très au sérieux les représentations subjectives, évaluons-les comme des problèmes scientifiques, et essayons d’analyser la société à nouveau frais à partir de leur prise en compte.
Qu’est-ce qui accrédite cette thèse ?
L’approche subjective a démontré sa pertinence dans divers domaines. Je prendrai deux exemples. Le premier, c’est la température ressentie, convention statistique qui intègre, en plus de la température ambiante, le vent et l’humidité pour essayer d’identifier des réactions physiologiques. Cette température nous donne une idée plus proche de ce qui pourrait être considéré comme la vérité d’un point de vue épistémologique – et donc en ce sens elle est plus « objective » que la seule température ambiante. On saisit bien ici qu’il n’y a pas d’un côté le réel et de l’autre le subjectif : le subjectif est lui aussi un ensemble de conventions statistiques, et il nous donne une vision rapprochée du phénomène.

Le deuxième exemple, je l’ai trouvé en épidémiologie. De nombreux travaux, menés notamment dans le sillage de l’épidémiologiste britannique Michael Marmot, ont montré que la manière dont les patients perçoivent leur statut social est plus prédictive de la dégradation future de leur état de santé que leur statut social dit objectif. Là encore, intégrer la subjectivité donne accès à une richesse d’enseignements non accessible à l’évaluation dite objective.
Vous avez mené de nombreuses enquêtes sur le haut, le milieu et le bas de la hiérarchie sociale avec cette approche subjective. Quelles conclusions générales en tirez-vous ?
Il apparaît clairement que la capacité subjective à se projeter positivement dans l’avenir constitue une clé de lecture de la société très pertinente : non seulement elle permet de décrire la hiérarchie sociale, mais elle rend aussi compte des relations inégalitaires qui s’y nouent et de leur reproduction. Sur le premier point, on entend parfois dire que les crises politiques et sociales que nous traversons seraient dues à une augmentation des inégalités depuis les Trente Glorieuses. C’est un constat à nuancer. C’est vrai, il y a un très fort enrichissement des plus aisés et un patrimoine de plus en plus hérité qu’il faut prendre en compte. Mais ce n’est pas tant à une explosion des inégalités que nous assistons qu’au renversement du sentiment de sécurité en un sentiment d’insécurité. Pendant les Trente Glorieuses, la vie était peut-être dure, mais il y avait une perspective largement répandue de progrès, d’amélioration de la situation individuelle et collective. Elle a aujourd’hui disparu pour toute une partie de la population.
Sont donc pauvres, selon votre approche, les personnes qui ne parviennent plus à se projeter dans l’avenir… Qui sont-elles ?
Nous avons, avec le sociologue Adrien Papuchon, effectué une analyse croisée de l’appréhension de la pauvreté, d’une part à partir de mesures objectives et d’autre part à partir de la mesure du sentiment de pauvreté. Les deux types d’approche aboutissent à classer environ 15 % de la population comme « pauvre ». Mais il n’y a qu’un recoupement partiel entre ces deux groupes, ce qui signifie que certaines personnes non considérées comme pauvres d’un point de vue objectif se jugent pauvres, et inversement.
Dans le groupe constitué par l’approche subjective, on observe une plus grande hétérogénéité que dans le groupe « objectif » : on y trouve aussi bien des personnes hors emploi (en général identifiées par l’approche objective) que des ouvriers, des employés, des salariés en emploi à temps plein, des retraités, de petits indépendants… que l’approche objective ne classe pas comme « pauvres ». Cette étude a ainsi permis de quantifier et d’approcher de manière extrêmement robuste statistiquement les contours de la constellation sociale très hétérogène qui s’est mobilisée dans le mouvement des Gilets jaunes.
Qu’est-ce qui détermine cette capacité à se projeter dans l’avenir et le sentiment de sécurité ou d’insécurité associé ?
Nous avons pu montrer que pour les hommes les plus défavorisés, la mise en couple avait un effet protecteur fort. Mais le déterminant essentiel est à chercher du côté du patrimoine. Pour celles et ceux qui en disposent, il procure une forme de stabilité, de sécurité temporelle. Ce n’est d’ailleurs pas tant la concentration de richesses qui importe que la capacité à les investir dans la société. Cette ouverture assure une forme de maîtrise de sa propre vie, de celle de ses enfants, de la transmission mais aussi de la société dans son ensemble.

A contrario, le fait de ne pas disposer de patrimoine expose très fortement à une forme d’insécurité sociale rampante et à un sentiment de dépossession. C’est très net par exemple pour les personnes retraitées. Elles sont peu nombreuses à être pauvres monétairement, mais sont de plus en plus nombreuses à se sentir pauvres. Ces personnes sont souvent locataires, et n’imaginent pas leur avenir autrement que sous la modalité d’une dégradation inéluctable, du fait de l’augmentation du coût de la vie.
Comment les acteurs publics peuvent-ils se saisir de ces résultats ?
Il y a une demande très forte de sécurité, de stabilité, d’ancrage au sein de la société. Les populismes l’ont bien compris, et construisent précisément leur offre sur une reprise de contrôle. Mais pour analyser finement la situation et donner des réponses pérennes, je crois qu’une écoute attentive, profonde, de ce qu’exprime cette insécurité est nécessaire, en luttant contre la tentation de congédier le subjectif. Il me semble donc crucial que la statistique publique, en premier lieu, prenne en compte les données subjectives dans l’appréhension des positions sociales, en complément des données dites objectives. Dans ce cadre, la capacité à se projeter dans l’avenir apparaît comme un indicateur – comme la température ressentie citée tout à l’heure – qui donne un accès très juste à la position sociale des personnes : quand vous faites une auto-évaluation de votre situation, vous prenez en effet en compte vos ressources, votre patrimoine, votre capacité à évoluer professionnellement, etc.
Ensuite, il ne s’agit évidemment pas pour les pouvoirs publics de transcrire de manière directe les ressentis en politiques publiques, mais de retravailler les demandes de sécurisation de manière collective. Les travaux du jeune Bourdieu ont montré qu’il y avait une relation très étroite et complexe entre ces attentes de sécurité, ces projections subjectives plus ou moins inquiètes, et le rapport au logement, à l’emploi, etc. Le fait de devenir propriétaire de sa résidence principale est par exemple devenu une valeur fondamentale aujourd’hui, pourvoyeuse de stabilité. Or, les tensions sur le marché du logement sont très fortes. Une traduction littérale de l’importance accordée à l’accession à la propriété pourrait consister à rallonger la durée maximale des crédits immobiliers. Ce n’est pas du tout ce que je préconise. Je recommande de travailler à des moyens collectifs pour atténuer ces crispations, mais en se fixant pour objectif principal de donner de la stabilité aux citoyens, de la capacité d’anticipation. Ce doit être un programme pour les politiques, mais cela doit également orienter le programme scientifique de sciences humaines comme la sociologie.
Propos recueillis par Anne Orliac
Ouvrage et étude cités :
N.Duvoux, L’avenir confisqué. Inégalités de temps vécu, classes sociales et patrimoine, PUF, 2023.
N. Duvoux, A. Papuchon, Qui se sent pauvre en France ? Pauvreté subjective et insécurité sociale, Revue française de sociologie, 59–4, 2018, pp. 607–647