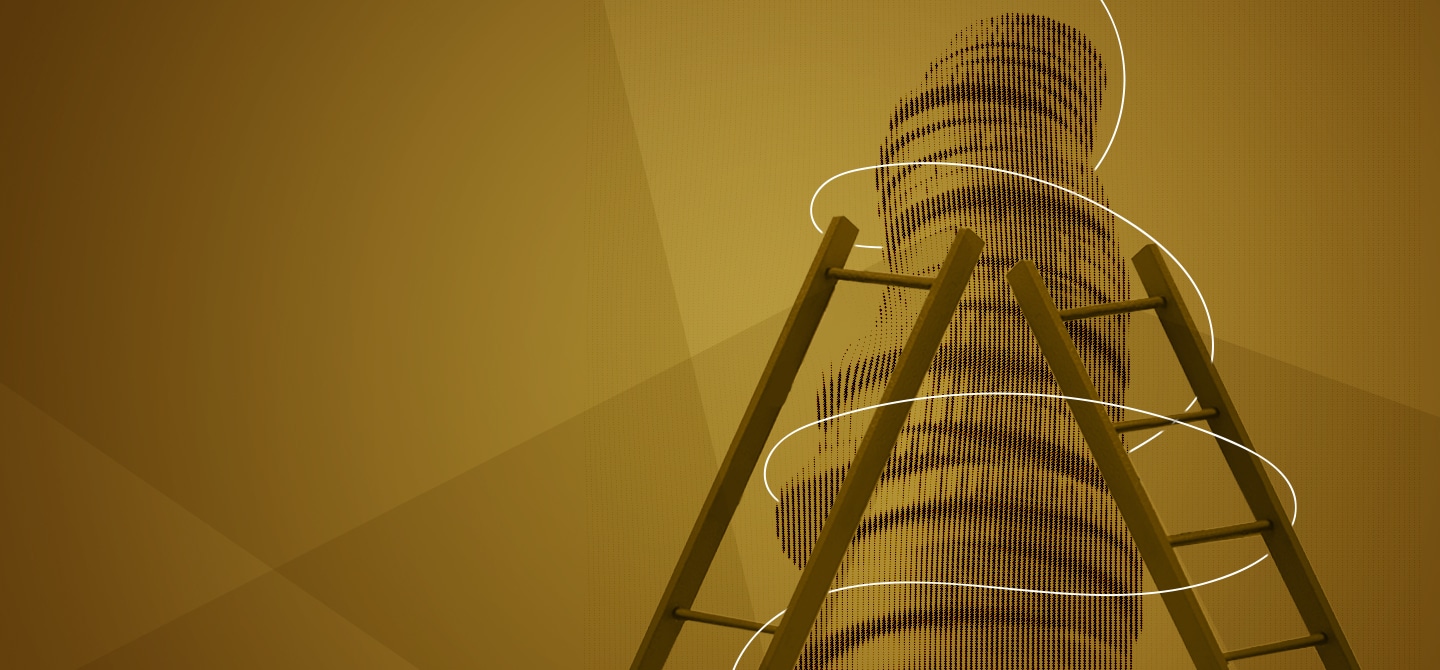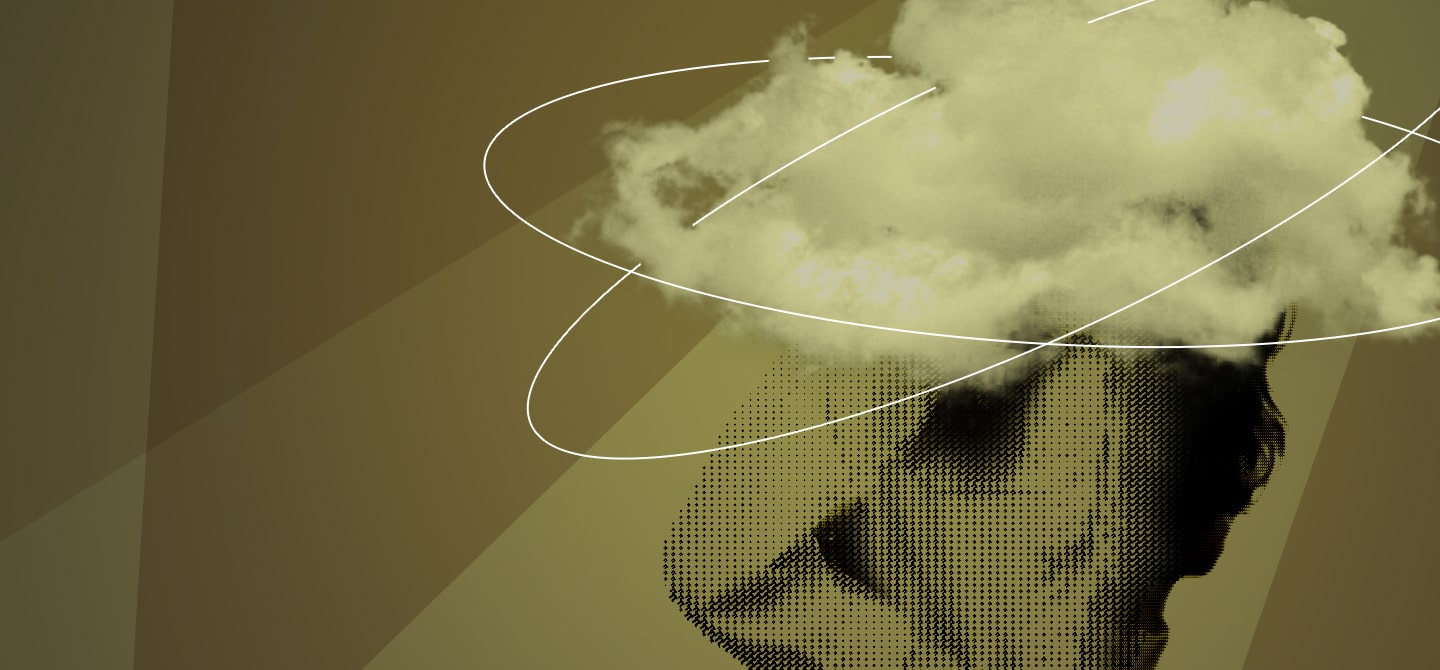La « question sociale », celle des inégalités économiques et sociales ainsi que celle de la pauvreté, est apparue avec la Révolution industrielle. Elle est restée au centre des débats pendant plus d’un siècle, inspirant des pensées radicales, mais amenant aussi des solutions qui ont fait évoluer le capitalisme. Deux séquences économiques très différentes l’ont vue passer au second plan.
Les raisons d’une éclipse
La première est la transformation keynésienne de l’économie, dans le sillage de la crise de 1929. Redistribution et croissance inclusive amènent alors, dans les économies développées, un vaste mouvement de résorption des inégalités économiques et sociales, autour de la constitution des classes moyennes.
La deuxième séquence est consécutive aux crises économiques des années 1970, qu’on lit alors comme un épuisement du modèle keynésien. La question majeure devient alors la croissance, et pour lui donner de la vigueur, on assume de laisser se creuser des inégalités. De plus, avec la mondialisation l’Occident accède à une gamme inédite de produits bon marché.
La question des inégalités économiques est alors filtrée par celle des discriminations : dans le monde keynésien comme dans le monde « reaganien » qui lui a succédé dans les années 1980, ce n’est pas entre les riches et les pauvres que se situe la césure la plus nette, mais entre l’immense majorité des classes moyennes et les minorités qui peinent à s’y intégrer. La discrimination positive est l’une des réponses données à ces inégalités « sociétales » qui se concentrent dans la couleur de peau ou les origines ethniques.
C’est après la crise de 2008 que la question des inégalités économiques revient au premier plan, et avec elle celle de la crise des classes moyennes.
Le capital de Piketty et l’éléphant de Milanovic
En avril 2014, un livre d’économie de 900 pages arrivait en tête des ventes sur Amazon. Capital in the Twenty-First Century, de Thomas Piketty, captait l’esprit du temps, donnant une base théorique à la critique des « 1 % », faite par le mouvement Occupy Wall Street.
Sous le déluge de données, son argument était simple : « dès lors que le taux de rendement du capital dépasse durablement le taux de croissance de la production et du revenu — ce qui était le cas jusqu’au XIXe siècle, et risque fort de redevenir la norme au XXIe siècle —, alors le capitalisme produit mécaniquement des inégalités insoutenables, arbitraires, remettant radicalement en cause les valeurs méritocratiques sur lesquelles se fondent nos sociétés démocratiques ».
Deux ans plus tôt, un autre économiste avait fait sensation, en résumant en un seul graphique le destin économique de la société mondiale. Branko Milanovic présentait sur l’échelle horizontale (abscisses) la distribution des Terriens en fonction de leurs revenus (les plus pauvres à gauche, les plus riches à droite), et sur l’échelle verticale (ordonnées), la progression du revenu entre 1988 et 2008. Il en résultait une courbe en forme d’éléphant, suggérant que la mondialisation a profité aux pays asiatiques les plus pauvres et aux Occidentaux les plus riches au détriment des classes populaires et moyennes des pays riches.
Ces travaux ont eu des échos dans le débat public, mais ils ont également suscité de nombreux travaux académiques. En politique, on s’en est servi pour expliquer l’essor des populismes et le succès, par exemple, de Donald Trump. En économie, les travaux de Piketty ont remis au premier plan des questions comme la fiscalité du patrimoine et la redistribution.
Dans les années récentes, les phénomènes décrits par Piketty ont même pris de l’ampleur. Un des effets de la création massive de monnaie par les banques centrales, après la crise de 2008, a été une inflation spectaculaire dans certains marchés, notamment les actifs financiers et l’immobilier : d’où une forte croissance des plus gros patrimoines privés. La pandémie elle-même a accéléré ce mouvement : le World Wealth Report 2021 de Capgemini, s’est ainsi penché sur les « High Net Worth Individuals » (HNWI), la vingtaine de millions de personnes dans le monde qui possèdent un patrimoine de plus d’un million de dollars, hors résidence principale. Alors qu’en 2008, le nombre des HNWI avait diminué de 13 % et leur fortune de presque 20 %. Or, après un an de crise sanitaire, non seulement il y a davantage de millionnaires (+6,3 %) dans le monde, mais leur enrichissement s’est encore accéléré, progressant de 7,6 % — presque deux points de plus que sur la période 2013–2019.
Le thème des inégalités a été également associé à la crise climatique. D’après le rapport 2022 du Laboratoire sur les inégalités mondiales (Paris School of Economics) publié en décembre 20211, les 10 % les plus riches de la planète ont pesé à eux seuls pour près de la moitié de toutes les émissions de dioxyde de carbone enregistrées en 2019 (47,6 %).
Mais des critiques sont également apparues. Ainsi Daniel Waldenström met en évidence les différences entre la trajectoire américaine et celle des pays d’Europe, pointant par ailleurs qu’avec les systèmes de retraite moderne nous sommes tous des rentiers en puissance, même si nous n’avons pas de capital à notre nom.

Immobilité et mobilité sociale
Les économistes de l’OCDE, de leur côté, appellent l’attention sur la nécessaire distinction entre les inégalités de revenus avant et après redistribution, soulignant que la plupart des pays développés ont mis en place une fiscalité progressive qui produit de puissants effets égalisateurs. Mais, ajoutent-ils dans le rapport Equity in Education : Breaking down barriers to social mobility de 20182, dans certains pays très redistributeurs comme la France, le vrai problème des inégalités réside dans la reproduction sociale et les inégalités à la naissance, qui peuvent apparaître comme particulièrement injustes.
Le problème, c’est que si les politiques publiques peuvent remédier en partie à ces inégalités, en investissant sur l’éducation par exemple, une partie de ces efforts est annihilée par les investissements à la fois financiers et personnels bien supérieurs des classes supérieures et notamment de cette élite surdiplômée qu’on appelle désormais « the aspirational class ». La sociologue Elizabeth Currid-Halkett montre ainsi dans The Sum of Small Things : A Theory of the Aspirational Class (Princeton University Press, 2017) que si, entre 1996 et 2014 la part des dépenses dans l’éducation a augmenté de 60 % pour l’ensemble des Américains, elle a crû de 300 % chez les plus riches. Mais surtout, ajoute-t-elle, les parents très diplômés consacrent désormais un temps considérable à l’éducation. « Les parents de milieux privilégiés consacrent de plus en plus de temps à leur progéniture, notamment en favorisant l’expression de l’enfant pour qu’il développe son autonomie, aiguise sa capacité d’argumentation, enrichisse son vocabulaire et teste ses aptitudes sociales. » Ainsi se développent des élites en vase clos.
Symétriquement, de nombreux travaux sociologiques pointent la tendance des inégalités à se cumuler et à s’aggraver. La crise du Covid aurait encore renforcé ces effets, comme le notent Yann Coatanlem et Antonio de Lecea dans leur contribution à ce dossier.
Ainsi se précise la vision contemporaine des inégalités économiques et sociales. Nos sociétés acceptent des inégalités économiques qu’elles s’emploient aussi à corriger, avec un certain succès. Mais alors qu’elles sont fondées sur la promesse explicite d’une égalité des possibles, elles sont menacées par une immobilisation des destins sociaux. C’est le paradoxe de notre époque : les inégalités qui nous inquiètent sont conçues et vécues sous le signe des dynamiques personnelles et de la mobilité des individus. Mais ces dynamiques finissent par s’agréger pour constituer une société à deux vitesses, polarisée et immobile.