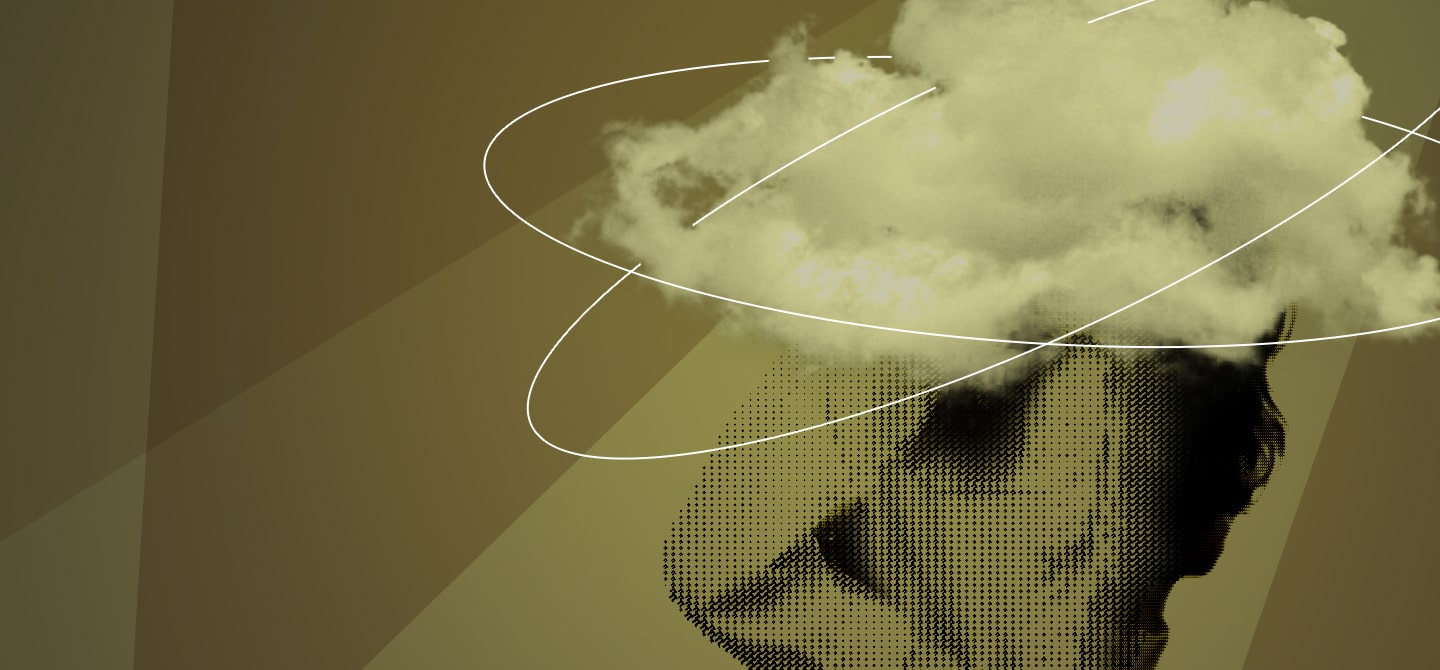L’attitude critique que l’on peut attribuer aux Anciens autour du rapport à l’animal se résume à mes yeux par la mouvance philosophique fondamentale issue d’Aristote (384–322 av. J.-C.) : ce penseur écrit notamment au début de la Métaphysique que nous sommes des êtres qui, par nature, désirons connaître. Le sujet qui nous intéresse ici nous amène alors à nous attacher à au moins deux questions : la première, prioritaire aux yeux des Anciens, porte sur ce qu’est un animal ; la seconde, qui semble être plus urgente aujourd’hui, concerne l’interaction que nous entretenons avec les animaux. Cette dernière question découle de la première et nous suggère qu’il faut d’abord clarifier ce qu’est l’animal pour savoir comment nous devons interagir avec lui.
Sacrifice physique ou élévation morale ?
Dans le monde contemporain, le fait de ne pas manger des animaux est souvent interprété, même de la part de certains végétariens et végétaliens, comme un sacrifice accepté pour le bien-être des animaux. On sacrifierait normalement soit le plaisir du goût, soit, selon une hypothèse sur la santé humaine que je ne partage pas, des bénéfices qui dériveraient d’un régime comprenant des produits animaliers. Une telle approche ne correspond pas aux motivations du végétarisme ancien : l’éthique ancienne possède dans la plupart des cas une dimension utilitariste qui est incompatible avec une telle notion de sacrifice.
Quand un philosophe de l’Antiquité gréco-romaine se déclare végétarien, il manifeste avant tout un choix éthique, notamment une pratique de pureté personnelle, le fait de tuer des animaux étant considéré comme un acte qui, entre autres, empoisonne l’âme de celui qui l’accomplit. Les Anciens les plus sensibles aux questions animales, comme Plutarque (environ 46–125) et Porphyre (environ 233–305), tenaient donc compte d’une telle dimension personnelle. En respectant l’animal, ils considéraient réaliser des actes qui relèvent de l’opportunité morale, dont ils reconnaissaient les retombées d’ordre personnel (les bienfaits pour la santé humaine, notamment), certes, mais aussi collectif, c’est-à-dire concernant l’humanité dans son ensemble et le rapport entre les espèces.
La question de notre rapport aux animaux apparaît extrêmement tôt, chez les philosophes de la toute première période de l’histoire de la pensée grecque. Dans la tradition pythagoricienne, qui est très ancienne, il y avait des interdictions alimentaires en ce sens. Quant à Héraclite (535–475 av. J.-C.), il a laissé un fragment dans lequel il affirme que les sacrifices de purification par le sang des animaux ne font qu’empoisonner l’âme de ceux qui les accomplissent (fr. 5 Diels-Kranz). Ce n’est sans doute pas un précepte végétarien au sens strict, mais il montre déjà une forme de conscience de la question que l’on retrouvera, de manière plus développée, chez Platon.
L’Homme, un animal à part ?
Dans La République (369b-376e, en particulier 372b‑d), le premier modèle de cité conçue par Socrate prévoit que les habitants se nourrissent uniquement de végétaux. Ce modèle sera balayé par la suite à la faveur du projet d’une cité plus complexe, où la guerre entre en jeu, pour que l’on puisse maintenir le luxe qui la caractérise. Socrate définit cette seconde cité comme étant « travaillée par l’inflammation des humeurs » (tr. L. Robin), tandis que la première, celle dont les habitants mangent uniquement des végétaux, était « véritable » et « saine ». Cela montre l’importance accordée aux implications personnelles, sociales et plus largement philosophiques d’une alimentation végétale.
Un autre texte platonicien me semble décisif dans le contexte de notre réflexion : le Protagoras. Dans le mythe de Prométhée présenté dans ce dialogue, il est question de l’origine des êtres vivants. Épiméthée, frère de Prométhée, se charge de distribuer aux êtres vivants facultés et instruments pour se protéger. Il donne à un animal une grande taille, à d’autres il offre des griffes ou du pelage. Au moment où il est question des êtres humains, il se rend compte qu’il ne lui reste plus rien à donner. C’est alors que son frère Prométhée vole aux dieux le feu et le savoir technique et en fait don aux humains pour en assurer la survie. Il y a là, à mon avis, le noyau de l’approche de l’animal dans la philosophie grecque, noyau fondé sur une véritable dialectique entre homogénéité et altérité : homogénéité dans le sens où nous sommes tous des êtres mortels qui avons besoin de facultés et d’instruments pour survivre, et altérité dans le sens où les humains sont dotés de facultés et d’instruments qui, à leurs yeux, les distinguent du monde animal.
Un besoin contingent désormais dépassé
À la fin de l’Antiquité, deux moments cruciaux dans l’histoire de ce débat correspondent à la réflexion des deux auteurs que j’ai déjà évoqués, Plutarque et Porphyre. Leur mérite est d’avoir abordé la question de manière explicite, en prenant position contre les sacrifices, contre la consommation de la viande, selon une perspective qui est, à mon avis (notamment chez Plutarque), profondément moderne. Pour ce dernier, la consommation de viande est le résultat d’une nécessité propre à un moment spécifique de l’histoire de l’humanité. L’erreur a été de croire que l’habitude qui s’est imposée à la suite de ce besoin correspond à notre véritable nature. En réalité, argumente Plutarque, cette nécessité a déterminé ce que l’on peut appeler une « seconde nature contre-nature ». Plutarque dévoile d’ailleurs une erreur cruciale que nous faisons lorsque nous mangeons un animal : le considérer comme une nourriture comporte une distorsion ontologique, dans le sens où nous faisons de l’animal, qui est un être vivant, un objet inanimé. En d’autres termes, nous le réifions.
Cette perspective rejoint la réflexion contemporaine autour de la dissonance cognitive et sur le caractère méconnaissable de l’animal dans la viande que nous mangeons : elle est la chair d’un être vivant. Enfin, Plutarque ajoute que lorsque nous mangeons de la viande, ce n’est pas seulement une violence que nous faisons aux animaux, mais c’est aussi une violence que nous nous faisons à nous-mêmes. Cette dernière comporte une nouvelle distorsion ontologique, encore plus dangereuse : en perdant notre capacité à ressentir de l’empathie envers les autres êtres vivants, nous arrêtons d’être véritablement humains. Même si cette pensée nous vient d’un intellectuel qui appartenait à un monde où les animaux devaient être bien plus visibles qu’aujourd’hui, elle peut aussi parler à notre société, dans laquelle la vie (et je dirais même plus, la mort) des animaux dont nous nous nourrissons sont soustraites à nos yeux.
Nous avons donc beaucoup à apprendre des Anciens sur ces sujets. Dans notre rapport aux animaux, notamment dans le système qui sous-tend l’alimentation carnée, il existe beaucoup de choses cachées, sur le plan concret — les abattoirs que l’on ne voit pas — et psychologique — la viande dont on oublie qu’elle est chair. Les Anciens nous livrent une leçon de transparence, de conscience de soi et de réflexion sincère qui pourrait nous être utile dans notre rapport aux animaux, et à nous-mêmes.