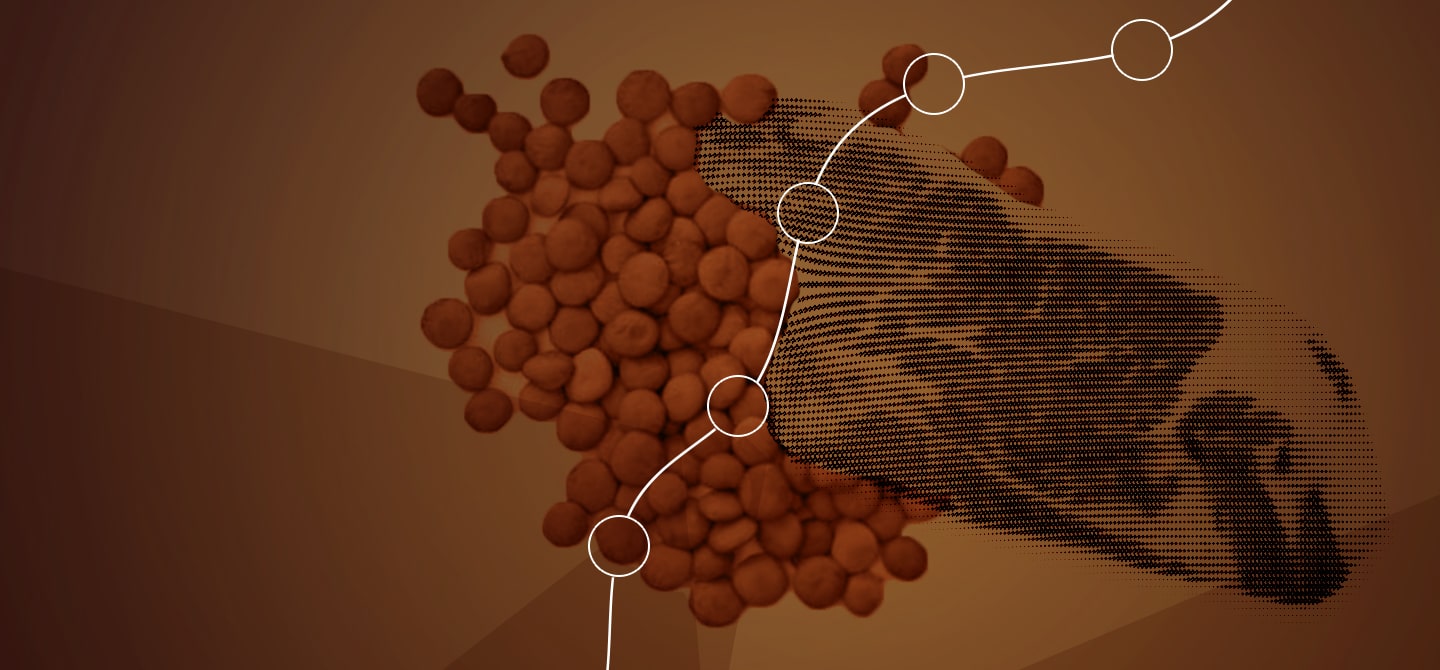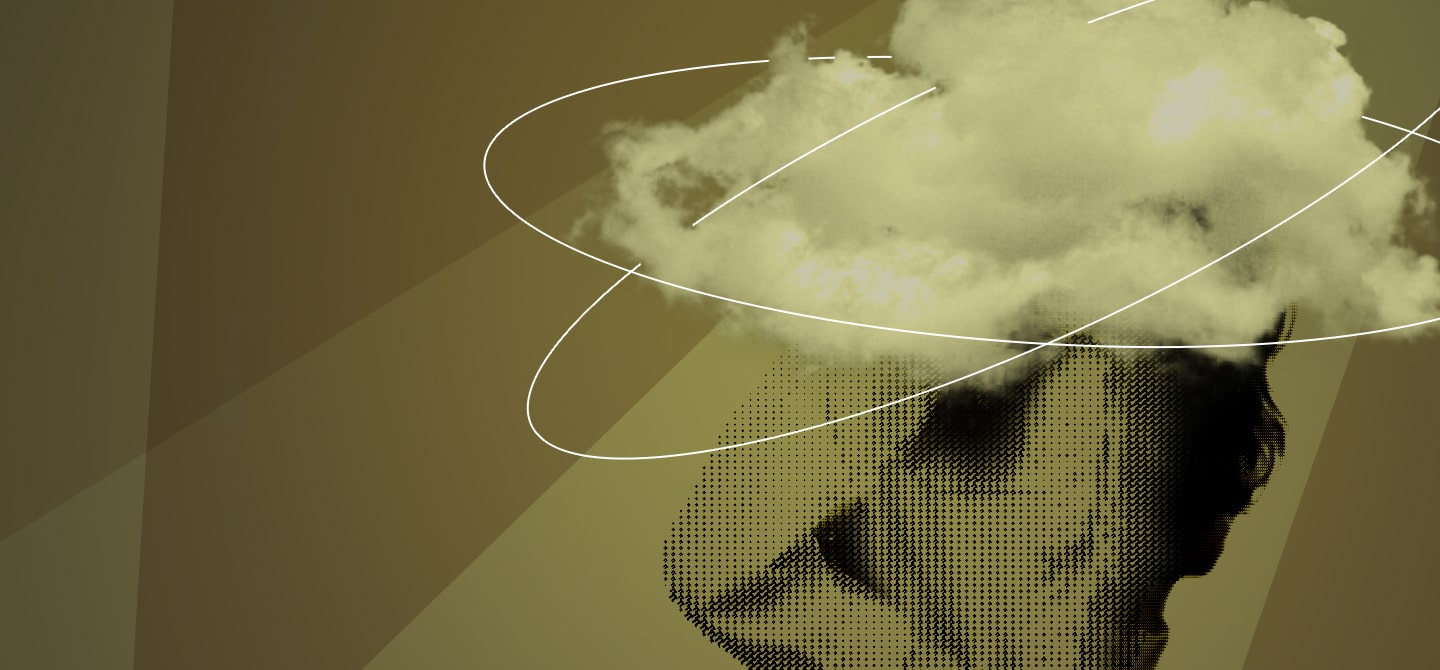La pandémie a de nouveau mis en exergue notre dépendance aux importations dans le secteur stratégique des protéines. À titre d’exemple, en France, nous importons plus de 1,5 million de tonnes de soja par an, principalement pour subvenir à l’alimentation animale – dont 58 % proviennent du Brésil1. Pour régler les problèmes que posent cette dépendance, le gouvernement a lancé un énième plan protéine, néanmoins inédit par l’ampleur de son financement et par l’engagement de l’État. L’indépendance protéinique porte plusieurs enjeux majeurs tels que limiter la déforestation des pays sud-américains et les émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire, développer de nouvelles variétés et permettre à la France, comme à l’Europe, de se positionner sur les marchés mondiaux. Avant de nous plonger dans la façon dont les acteurs de ce secteur se coordonnent pour répondre à la demande de l’État, il est important de revenir sur son histoire géopolitique pour mieux comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés là.
En 1960, l’Europe accepte une certaine forme de dépendance protéinique, via l’accord Dillon Round, dans le cadre de l’accord général sur le commerce et les tarifs douaniers. Comment expliquer une telle décision pour un secteur aussi stratégique ?
Mathieu Brun. Il est bon de rappeler cet état de fait : la dépendance protéinique que nous connaissons aujourd’hui est la résultante de choix politiques. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le libre marché commence à se mettre en place et l’Europe décide de protéger certaines de ces productions – les céréales, le sucre et le lait – en taxant de façon conséquente l’exportation de ces produits sur le territoire européen. En contrepartie, la communauté européenne s’est engagée à ne pas mettre de barrières tarifaires sur le soja en provenance des États-Unis. C’est à ce moment précis qu’on assiste à la genèse de la dépendance protéique décidée politiquement. Cette dépendance a, par la suite, entraîné une perte de capacité de recherches et de production. Pendant une dizaine d’années, l’Europe s’en remet alors uniquement aux importations. Puis un événement est venu nous rappeler l’importance stratégique de ce secteur.
Cet évènement est bien sûr l’embargo américain sur le soja en 1973 où l’Europe prend conscience de l’aspect stratégique de ce secteur et investit massivement pour son développement. Pourtant, cette dynamique est encore altérée, car les importations ne faiblissent pas. Quels facteurs expliquent ce nouveau laisser-faire en connaissance de cause ?
À ce moment-là, il faut bien se rappeler que les États-Unis étaient quasiment les seuls exportateurs de produits riches en protéines. La production altérée de 30 % pour cause de sécheresse et l’embargo qui en est la conséquence inquiète tout naturellement. Lors de cette crise, d’autres futurs grands acteurs vont entrer dans le marché comme l’Argentine et le Brésil. La France et l’Europe vont réinvestir massivement dans la recherche et dans la production de protéagineux et oléagineux dont les cultures de colza et de tournesol sur notre territoire sont les témoins aujourd’hui, mais il faut aussi, à cette période d’expansion démographique, répondre aux besoins de la population en matière d’alimentation (produits de cuisson, viande à prix avantageux, etc.) ce qui explique en partie pourquoi nous sommes restés encore assez dépendants du soja américain.
Faisons maintenant un bon dans le présent : nous assistons à un plan de relance inédit sur l’aspect financier et en matière d’engagement de l’État. Les objectifs sont les suivants : réduire notre dépendance protéinique et accroître notre compétitivité sur le marché international. Outre les moyens financiers, comment faire sauter les verrous stratégiques (mauvaise communication, recherche, risque à cultiver ces protéagineux, faible rendement et faible attrait pour le consommateur, etc.) qui empêchent la réalisation de ces objectifs ?
Cela fait longtemps que les plans protéines se succèdent. Celui-ci est en effet doté de moyens inédits. Il paraît plus ambitieux que les anciens, notamment car il semble pourvu de la volonté de se focaliser et de développer l’aspect filière. Il s’inscrit donc dans une démarche qui est plus englobante, ce qui favorisera le dialogue au sein de l’interprofession et, espérons-le, permettra de répondre aux différents enjeux concernant le climat, la durabilité de nos productions et l’attente des consommateurs.
David Gouache. La force de ce plan protéine c’est que l’engagement de l’État a reçu un grand soutien de la part des interprofessions agricoles. Les responsables de l’interprofession ont suggéré aux élus que le plan ne devait pas se focaliser uniquement sur les professions productrices de protéines végétales, mais qu’il devait englober toute l’agriculture française en faisant dialoguer toutes les interprofessions. Ensuite, pour rentrer dans le concret et dans la réalisation du plan, les acteurs de l’interprofession dont je fais partie se sont demandé ce qui avait fait la réussite du premier plan protéine après l’embargo de 1973 du côté de la filière oléagineux (colza et tournesol) et l’échec de la filière protéagineux.
La réponse se trouve très certainement dans le fait que pour développer la filière oléagineuse, nous nous sommes appuyés sur des subventions d’investissements sur le long terme. Le défi actuel consiste alors à verrouiller la filière protéagineuse au sein de l’agriculture et de l’économie française, voire plus largement européenne.
Pouvez-vous nous expliquer brièvement comment s’organise la filière protéine végétale en France ?
Le maillon de base de toute filière agricole est bien évidemment l’agriculteur-éleveur qui produit la matière riche en protéines. Ce qui est assez particulier dans l’organisation des filières protéines et huiles, c’est qu’elles viennent s’insérer dans un système de culture qui est dominé par des céréales ou du maïs. Cet état de fait est cohérent avec l’aspect historique et avec le fait qu’il est bien plus difficile de cultiver des oléagineux et (surtout) des protéagineux que des céréales.
Par conséquent, les innovations en matière de semence, d’agrochimie, de machinisme, d’offres numériques, et cetera, sont en priorité allouées aux productions de céréales. C’est ce cercle vicieux qu’il faut réussir à entraver. Plus en amont on se rapproche du fonctionnement classique d’autres filières agricoles avec la présence de coopératives ou de négoces agricoles qui sont globalement chargées de distribuer les matières premières essentielles à la production.
Comment faire face à la demande croissante qui émane des pays émergents en matière de viande et donc de production de matière riche en protéine à destination des animaux ?
MB. Il y a effectivement une géopolitique des pays émergents à lire, car si on raisonne de façon prospective, le risque de pénurie existe. La Chine importe énormément de soja, les économies alimentaires se modifient en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est avec la démocratisation des huiles de cuisson et une augmentation de la consommation des produits carnés. Les marchés vont se retrouver potentiellement très tendus au niveau international si on échoue à répondre à la demande. Il faut aussi s’interroger en parallèle sur le changement des régimes alimentaires au sein de l’Union européenne qui vont entraîner une modification des cultures agricoles. Pour que ces modifications soient pérennes, il faut un soutien économique fort de la part de l’État sans quoi on se retrouvera probablement dans une nouvelle forme de dépendance.