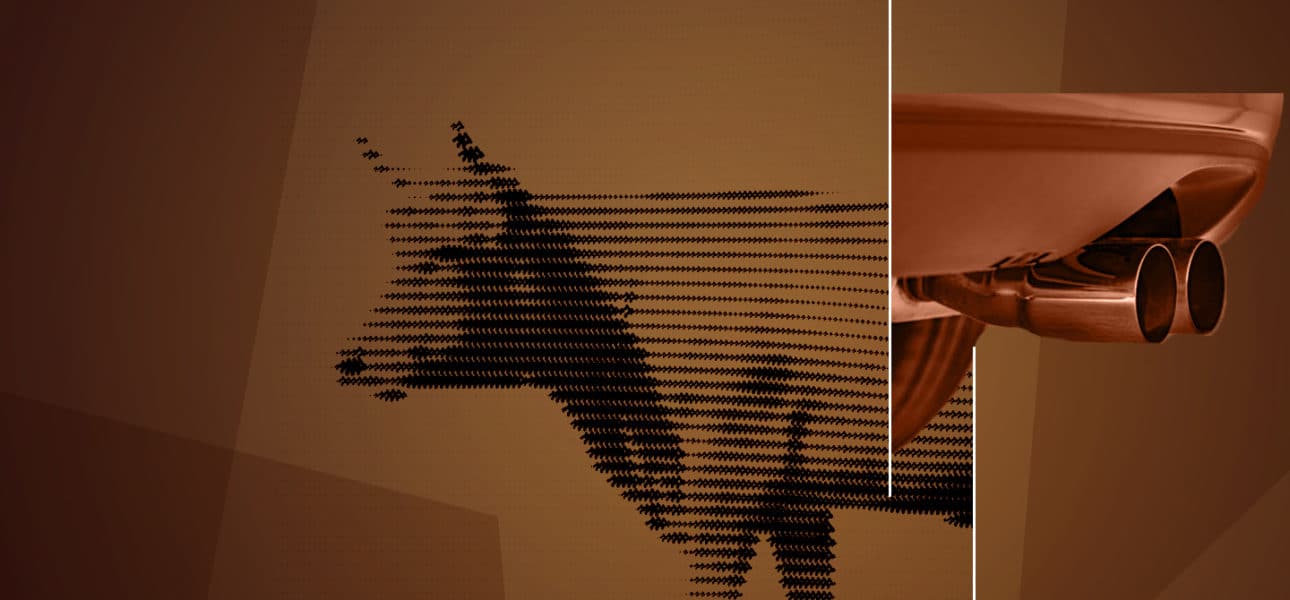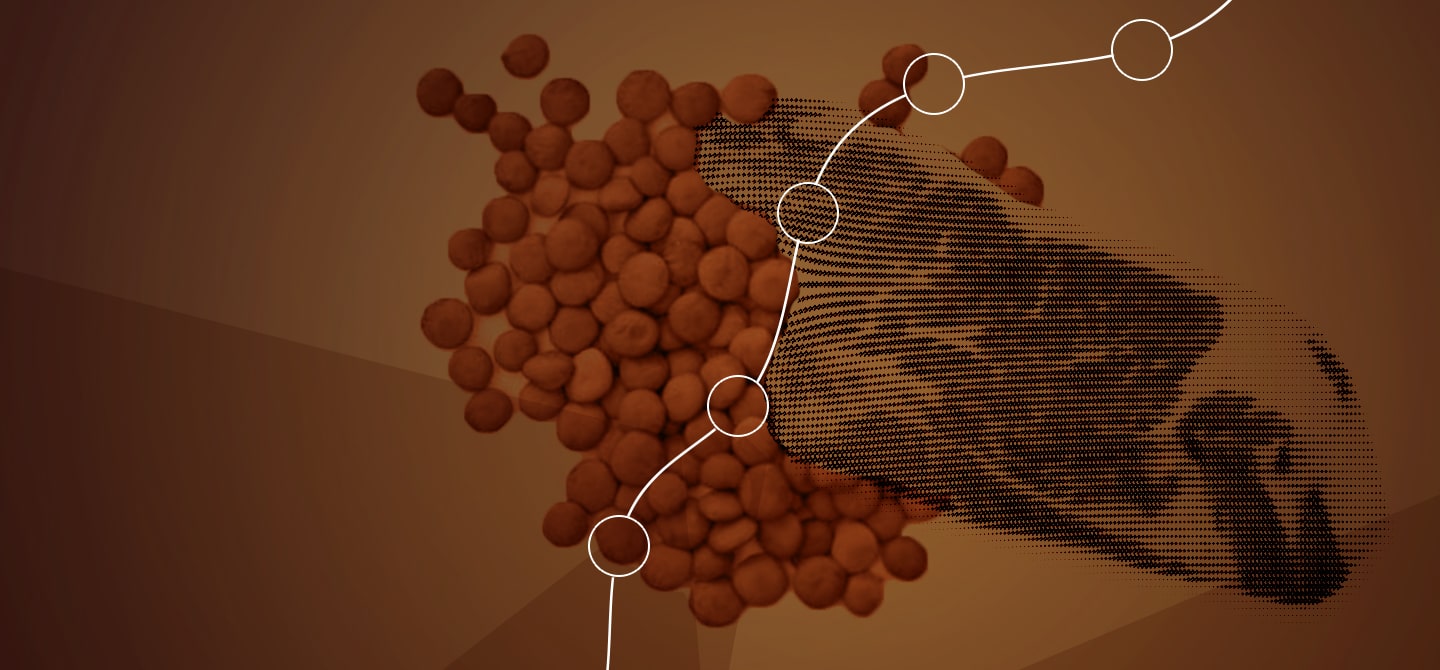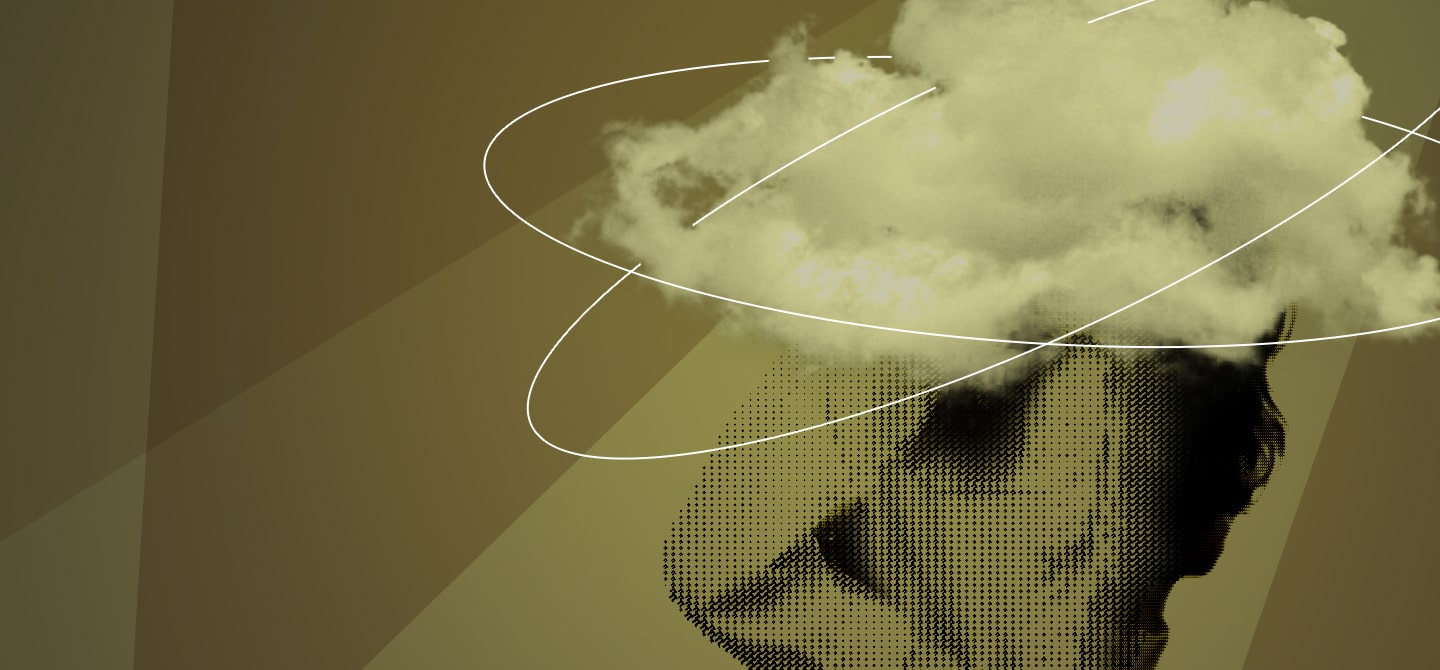Cet article fait partie du numéro de notre magazine Le 3,14, dédié à l’agriculture. Découvrez-le ici.

On entend souvent que l’élevage serait un grand émetteur de gaz à effet de serre (GES). Et c’est vrai. En effet, l’agriculture est le deuxième secteur en matière d’émissions de GES en France (23 % du total national1). L’élevage, quant à lui, est responsable de 68 % des émissions de méthane tandis que la culture des sols est responsable de 80 % des émissions de protoxyde d’azote. La résilience concernant ces émissions passe avant tout par une autonomie plus importante des exploitations et une moindre consommation de produits carnés dans la population.
Comment sont calculées les émissions totales des principaux gaz à effet de serre (GES) émis par les élevages (méthane, protoxyde d’azote et dioxyde de carbone) et les échanges au sein des écosystèmes prairiaux ?
Katja Klumpp. En France, l’organisme responsable de ces inventaires est le Centre technique de référence en matière de pollution atmosphérique et de changement climatique (Citepa)2. Lui-même se base sur des méthodes de calculs recommandés par le GIEC. Ainsi, il y a différents niveaux de méthode définissant trois niveaux de précision. Nous avons à notre disposition des coefficients multiplicateurs (facteurs d’émissions) pour chaque catégorie de sources émettrices, type de GES et des données liées aux activités concernées.
Le premier niveau est excessivement simple. Par exemple, pour connaître l’émission de l’élevage de méthane (CH4), on multiplie le nombre de vaches en France par le coefficient multiplicateur associé. Ou pour connaître l’émission de l’élevage en protoxyde d’azote (N2O), on multiplie la quantité d’intrants azotés de synthèse épandus par le coefficient multiplicateur (facteurs d’émissions ; bovine 52 kg CH4 tête/an) associé à ce gaz. Le calcul est simple, mais avec les différentes variations présentes au sein des élevages, le résultat sera sujet à de grandes marges d’erreur.
Dans le deuxième niveau de complexité, on va ajouter plus d’informations : données métriques de la vache (ingestion, besoin en énergie, poids), catégorie de la vache (laitière, veaux, taureau…), lieu d’élevage (continent), etc. Enfin, le troisième niveau de complexité prend en compte des paramètres comme la qualité des aliments, fonctionnement du rumen dans un modèle mécaniste, etc. On voit donc que pour être précis, nous avons besoin d’avoir beaucoup de données sources issues des exploitations à notre disposition. Dans notre travail de chercheurs, nous avons ensuite la possibilité de raffiner et d’améliorer les mesures et les méthodes de calculs aux exploitations locales. Nous les transmettons ensuite aux organismes nationaux ou internationaux pour qu’ils les intègrent dans leurs méthodes de calculs.
L’effet albédo
L’effet Albédo est très à la mode en ce moment. Pour l’expliquer brièvement, l’albédo est la part des rayonnements solaires réfléchie par une surface vers l’atmosphère. Selon la « couleur » (et texture) de la surface en question, le rayonnement est plus ou moins réfléchi. En gros, lorsque la lumière est réfléchie, elle n’est pas convertie en chaleur et donc cela participe à diminuer le réchauffement climatique. Maximiser l’effet albédo consiste donc à favoriser des surfaces qui réfléchissent la lumière plutôt que des surfaces qui vont l’absorber et la convertir en chaleur.
Le problème est qu’il faut, ici aussi, trouver les bons compromis localement. Par exemple, une prairie permanente avec un couvert végétal plus riche en espèces est plus sombre qu’une prairie temporaire semée en ray-grass-trèfle (type de gazon). De même pour la couleur du sol, des sols clairs augmentent fortement l’albédo et contribuent à diminuer la température terrestre. À l’inverse, sur les sols sombres, une introduction de cultures intermédiaires augmente l’albédo. Néanmoins, on a vu que la capacité à stocker le carbone dans les sols prairiaux était supérieure qu’en culture. Ce qu’il faut retenir de tout ça, c’est qu’il n’y a pas de solutions uniques dans l’élevage face au réchauffement climatique et que disposer de plusieurs solutions sera toujours bénéfique afin de pouvoir être plus résilient.
Il existe énormément de variables pour les émissions nettes de GES d’une exploitation. Pouvez-vous revenir sur ces différents paramètres ?
En matière de complexité, c’est le cas typique d’une estimation de niveau 3. Nous allons prendre en compte toutes les variables. Les prairies dites permanentes (surface toujours en herbe) peuvent être âgées de plus de six ans comme être âgées de plus de cent ans. Cette durée de six ans délimite la frontière avec les prairies dites temporaires (<5 ans) qui sont généralement en rotation avec des cultures. Ces prairies peuvent être plus ou moins riches en compositions végétales, avoir des modes d’utilisation différents (fauchées, pâturées ou mixtes), plus ou moins fertilisées avec du fertilisant minéral ou organique. L’ensemble de ces paramètres vont jouer sur la capacité de la prairie à stocker (processus à long terme) et à séquestrer du carbone (plutôt à court terme, il dépend donc des flux de carbone entrant) et donc sur son émission globale de GES.
Concernant l’animal, il est important de savoir sur quelle base repose son alimentation. Cela nous permet de savoir si des terres arables (concentré, tourteaux, blé, maïs…) ou la prairie ont été utilisées pour une partie de sa ration et s’il participe à la fertilisation du sol, soit par l’engrais, l’apport de fumier ou par la déjection directe sur le lieu de pâturage. Ces trois paramètres cruciaux jouent sur les émissions de GES. Et on peut aller encore plus loin et ajouter des paramètres comme la couverture du sol (type de végétation), le labour, le nombre et temps de vaches en pâturage par hectare de prairies, etc. Nous parlons toujours d’estimations, car il est très difficile d’avoir des résultats très précis. Néanmoins, d’un point de vue strictement théorique, il serait possible de compenser les émissions de GES de l’élevage à l’aide du stockage en carbone des prairies et en remplaçant une partie de l’engrais minéral par la fixation en azote des légumineuses.
Comment concilier les objectifs climatiques avec d’autres enjeux tels que la réduction des émissions de particules fines ou d’ammoniac et la préservation de la qualité de l’eau et des sols ?
La recherche s’est longtemps focalisée sur les seuls GES. En France, l’agriculture représente 53 % des émissions de particules, contre 29 % pour l’industrie, 11 % pour le résidentiel tertiaire et 5 % pour le transport routier (Citepa, 2014). Selon le Citepa, le poste « cultures » serait responsable de près de 80 % des émissions de particules d’origine agricole, le restant étant lié à l’élevage. La contribution de l’élevage aux particules fines (de taille < à 10μm — PM10) serait de moins de 10 % de l’émission nationale principalement issue des bâtiments d’élevage. Puis, ce sont des émissions d’ammoniac, qui contribuent à la formation de particules fines (PM2,5).
Pour y remédier, un ensemble de réglementations internationales a été mis en place pour diminuer les émissions de NH3. On se rend compte, depuis quelques années maintenant, qu’il devient urgent d’adopter des approches dites multicritères. Par exemple, le guide des bonnes pratiques pour améliorer la qualité de l’air se base de ce fait sur une stratégie « gagnant-gagnant »3. Ici, il s’agit de donner les clés pour réduire les émissions d’ammoniac tout en fournissant aux exploitations agricoles d’autres bénéfices, et en évitant tout transfert de pollution.
En effet, certains objectifs ne sont pas conciliables. Comme c’est le cas pour les volailles qui émettent moins de GES, mais plus d’ammoniac et de particules fines. Il faut alors trouver le meilleur compromis, ce qui est loin d’être aisé. Dans cette optique, des recherches sont en cours pour favoriser l’autonomie des exploitations (circularité) et permettre un équilibre dans la gestion de ces différents paramètres, notamment des intrants d’extérieurs.