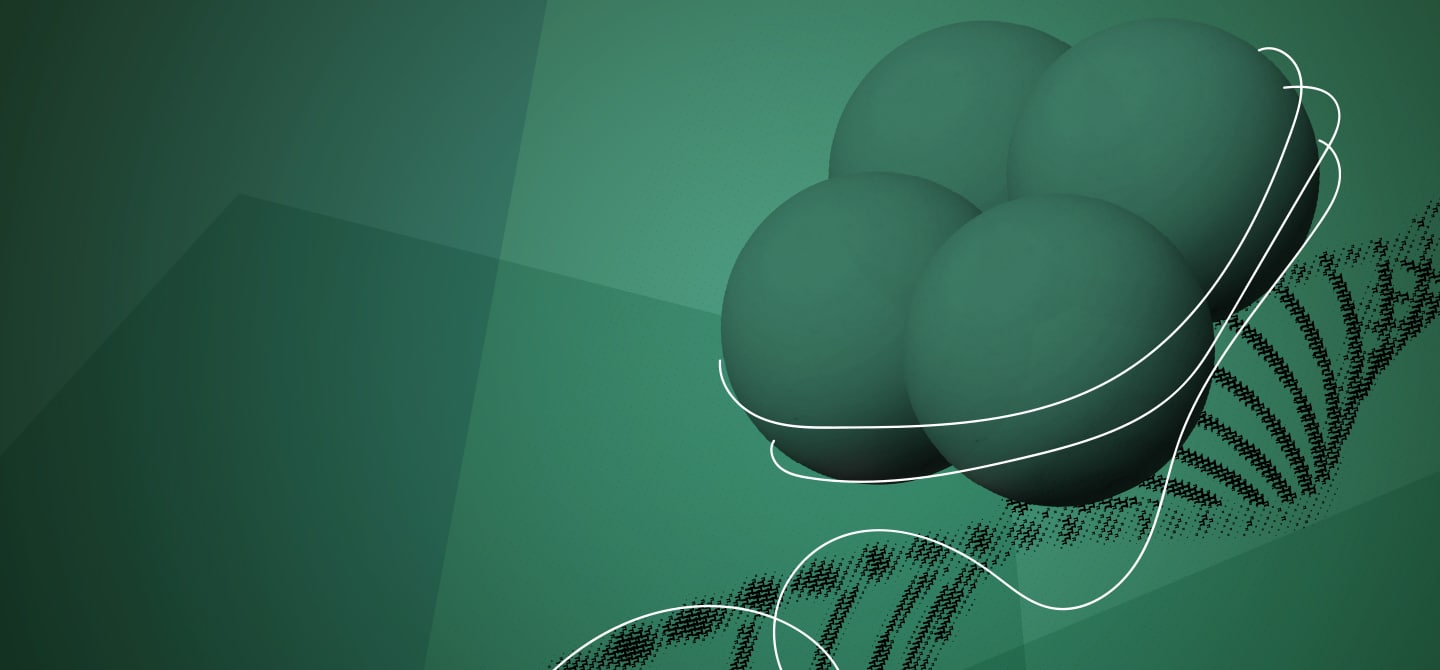L’épigénétique le montre : l’environnement peut influencer l’expression des gènes. Est-ce aussi le cas pour l’exposition à des molécules toxiques ? Cette question simple donne lieu à des réponses de recherche complexes et oblige les autorités réglementaires à repenser leurs méthodes tandis que l’inquiétude du public grandit.
Voilà une dizaine d’années que l’on soupçonne que la pollution laisse sa marque dans l’épigénome. Tout a commencé avec l’observation chez des rongeurs gestantes de modifications des marques épigénétiques après leur exposition à un fongicide, la vinclozoline. Plus étonnant, ces altérations étaient maintenues chez leur descendance et pouvaient être observées même quatre générations plus tard, c’est-à-dire chez des animaux n’ayant jamais vu le polluant12. Ces travaux ont fait l’objet de nombreux débats. Quelle portée peut-on leur attribuer alors qu’ils s’appuient sur une exposition à des doses très élevées ? Plus de 15 ans après publication, leurs résultats restent valables chez la souris, mais leur extrapolation à l’espèce humaine est délicate.
Un défi expérimental
D’une part, parce que l’éthique interdit de reproduire une expérience d’exposition contrôlée sur des humains. D’autre part, parce que l’exposition réelle de la population consiste principalement en des doses faibles à moyennes de différents produits actifs d’un point de vue biologique tout au long de la vie. La question de l’impact transgénérationnel de l’exposition aux polluants tels qu’observé chez les rongeurs reste donc ouverte dans l’espèce humaine. Les épidémiologistes s’interrogent sur la manière de construire une cohorte afin de rechercher un tel effet. C’est en théorie possible, mais pour se donner toutes les chances de mesurer un signal statistiquement significatif, il faudrait recruter un grand nombre de personnes ayant subi une exposition précise durant la période périnatale et dont la descendance en serait épargnée…
Peut-on identifier la mécanique moléculaire en jeu ? Là aussi, les travaux sont complexes. Il existe plusieurs hypothèses. La première suggère que les produits toxiques modifient le métabolisme ce qui impacterait les mécanismes d’installation des marques, par exemple en modifiant la disponibilité des donneurs de groupes méthyle, entrainant une perturbation de la fréquence des méthylations de l’ADN. Une autre hypothèse se concentre sur le rôle de la mitochondrie et donc de la respiration. Cet organite3 intracellulaire, dont le rôle principal est de produire de l’énergie par le biais de la respiration en utilisant l’oxygène capté dans l’air, est au carrefour de plusieurs voies métaboliques et peut ainsi influencer les mécanismes de méthylation de l’ADN. Ces deux mécanismes pourraient contribuer à inscrire l’exposition aux polluants dans le fonctionnement des cellules. Leur part respective selon le type d’exposition fait actuellement l’objet de nombreuses recherches.
Un autre sujet très discuté est celui du maintien d’une génération à l’autre de cette mémoire de l’exposition aux polluants, la question de l’hérédité transgénérationnelle des changements épigénétiques provoqués par la pollution. Historiquement, nous pensions avec certitude que les marques épigénétiques étaient effacées lors de la formation des gamètes. La cellule œuf qui donne naissance à l’embryon était donc décrite comme dépourvue du passé épigénétique des deux parents. Mais ce gommage est-il total ? Certains chercheurs supposent que certaines marques pourraient se maintenir et donc passer à la génération suivante. Cette hypothèse est actuellement à l’étude. Elle permettrait de dépasser l’exposition fœtale pour comprendre la transmission transgénérationnelle de certaines altérations épigénétiques.
Un défi pour la société
Ces recherches, essentielles pour documenter le phénomène à partir de données de la vie réelle, sont extrêmement onéreuses chez l’humain et n’ont pas encore complétement démontré l’existence d’un lien de causalité. Certains mécanismes sont connus, comme ceux où des composants de la fumée de cigarette altèrent la signalisation cellulaire même en cas de tabagisme passif. Mais, une démonstration ponctuelle ne suffit pas à répondre à la question globale. Il est donc crucial d’engager ces études de cohortes d’ampleur, bien qu’elles soient risquées en termes de résultats significatifs.
Il s’agit également de faire le lien entre l’exposition et l’altération de l’épigénétique. Cette question est l’objet de travaux que je mène avec mes collègues du laboratoire Toxicité Environnementale, Cibles Thérapeutiques, Signalisation Cellulaire et Biomarqueurs (T3S, Inserm/ Université de Paris). Nous cherchons ainsi à établir le lien entre l’exposome, c’est-à-dire la somme des pollutions, mais aussi des autres stress (physique, thermique, psychosociaux…) auxquels sont soumis un individu et les altérations potentielles de son épigénome [la somme de toutes les modifications épigénétiques sur le génome].
Tous ces travaux interrogent évidemment l’innocuité épigénétique des produits manufacturés. Pour être disponibles sur le marché européen, ces derniers doivent être considérés comme sans danger par les autorités réglementaires. Or, du point de vue de l’épigénétique, certains signaux, bien que suspects, ne sont pas pris en compte dans les cahiers des charges d’évaluation. C’est le cas des effets des cocktails de polluants, mais aussi des effets mitochondriaux de ces produits. La science réglementaire doit évoluer, en intégrant rapidement les données fiables produites par la recherche académique.