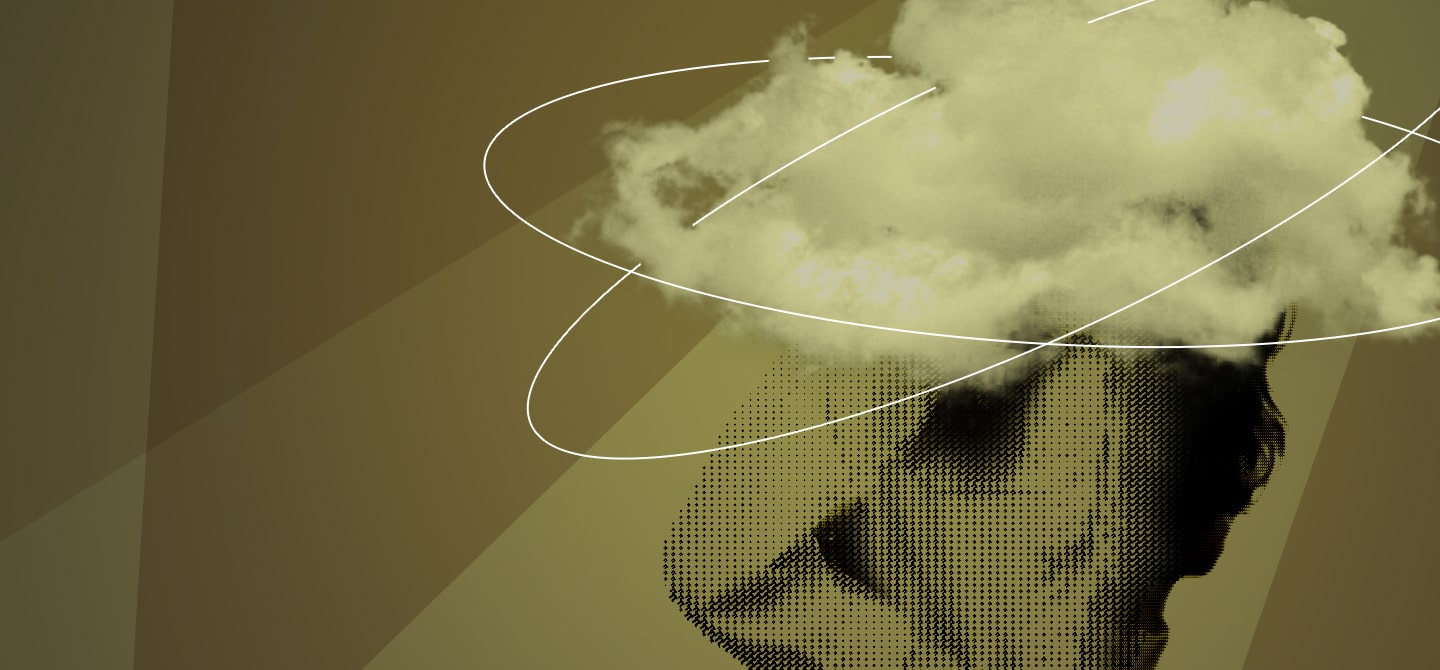D’un point de vue clinique, toutes les bactéries responsables de pathologie ne se ressemblent pas. On distingue les bactéries pathogènes, comme les salmonelles ou les shigelles, qui rendent toujours malade leur porteur, des bactéries opportunistes, qui habitent notre tube digestif, notre peau ou nos fosses nasales et peuvent, à la faveur d’une plaie ou d’un affaiblissement du système immunitaire, devenir infectieuses.
Opportunisme
Pour illustrer ces dernières, on peut citer Escherichia coli, une bactérie qui vit en parfaite symbiose avec notre organisme (commensale). Cette espèce bactérienne participe à l’homéostasie du tube digestif et produit des vitamines. L’homéostasie étant un processus de régulation par lequel l’organisme équilibre ses différentes constantes intérieures. Mais cette espèce est également responsable de 25 % des infections urinaires. Généralement sensible à tous les antibiotiques, cette bactérie est désormais résistante au traitement de référence des infections urinaires, les céphalosporines de 3e génération, dans environ 3 % des cas1. Une bactérie commensale et bénigne de notre système digestif peut ainsi menacer d’infecter le rein faute de traitement efficace.
Contrairement à d’autres pathologies, ces complications n’apparaissent pas brutalement. On peut vivre avec une bactérie résistante aux antibiotiques pendant des années. Celle-ci reste silencieuse aussi longtemps que le système immunitaire et la pression des autres bactéries commensales contrôlent sa place.
À l’occasion d’un stress, d’une période d’examen, d’une maladie virale, le système immunitaire peut s’affaiblir et une infection bactérienne survenir. Parmi les patients que nous soignons, la majorité souffrent de cancer, sont hospitalisés dans un service de réanimation ou ont bénéficié d’une greffe. Ces situations d’infections opportunistes sont désormais plus fréquentes que celles liées à des espèces pathogènes résistantes.
La prévalence croissante des infections dues à des bactéries multirésistantes aux antibiotiques s’explique à la fois par la surconsommation d’antibiotiques et leur mauvais usage clinique, comme vétérinaire. Dans les élevages, ces traitements ont été utilisés à la fois pour soigner les infections et pour les prévenir. Ce dernier cas facilite considérablement la croissance des animaux, ce qui a incité de nombreux éleveurs à instaurer une antibiothérapie de croissance. Jusqu’en 1996, en France, des cochons étaient ainsi traités préventivement avec des glycopeptides, une classe d’antibiotiques de dernier recours pour le traitement des staphylocoques. Cette pratique est interdite en Europe, mais elle persiste aux États-Unis et participe à l’augmentation des résistances bactériennes à l’échelle globale.
Un problème mondial et global
Mais la question de la présence d’antibiotiques dans l’environnement ne se réduit pas aux pratiques d’élevage. Une étude récente a ainsi montré que l’on trouve des médicaments dans toutes les rivières d’Europe2. En relarguant ainsi des molécules actives dans l’environnement, on favorise la sélection de résistances parmi les bactéries du sol et donc leur prévalence globale. Par le biais de mains ou de légumes non lavés, ces bactéries rencontrent la flore commensale du tube digestif. Elles peuvent s’échanger du matériel génétique. Les traitements antibiotiques favoriseront ensuite la diffusion des résistances ou leur apparition.
Ces médicaments doivent donc être prescrits et pris consciencieusement. Ils s’inscrivent dans un contexte social et biologique. En Inde, on achète des traitements selon ses moyens financiers. Un patient riche prendra un antibiotique à large spectre, c’est-à-dire susceptible de tuer plusieurs bactéries, quand un patient pauvre devra se contenter de molécules efficaces sur moins de bactéries.
En Europe, les options thérapeutiques sont plus raisonnées. Encore faut-il prendre en compte les variations d’efficacité d’un antibiotique selon le tissu. Il est aussi essentiel de respecter les posologies. Quand un patient prend un antibiotique, l’amélioration rapide de ses symptômes peut l’encourager à arrêter le traitement précocement. Mais ce n’est pas parce que les signes d’infection s’effacent que la bactérie a disparu. D’une manière générale, un traitement imparfait contribue à favoriser les résistances.
Des cas importés et autochtones
Nous sommes un laboratoire associé au Centre national de référence (CNR) pour les Entérobactéries résistantes aux carbapénèmes (ERC) depuis 10 ans. Les carbapénèmes sont des antibiotiques de derniers recours utilisés notamment dans les services de réanimation pour traiter des infections graves. La résistance à ces molécules est une préoccupation de santé publique, car les traitements des infections deviennent restreints à l’utilisation de la colistine, dernière molécule active, mais présentant des effets secondaires graves comme des atteintes irréversibles des fonctions rénales.
Lors de sa création, en 2012, le CNR observait des souches de résistances aux carbapénèmes essentiellement chez des voyageurs, en particulier ayant séjourné au Maghreb ou en Inde. Les personnes qui voyagent dans ces pays ont deux chances sur trois d’acquérir une entérobactérie résistante à un ou plusieurs antibiotiques. Celle-ci n’est pas forcément pathogène, mais à la faveur d’une immunodépression passagère, elle peut provoquer une infection difficile à traiter.
Aujourd’hui, plus de 60 % des cas que nous prenons en charge sont autochtones, ils concernent des patients n’ayant jamais voyagé hors d’Europe et qui ont donc acquis la résistance dans la communauté. L’ampleur du problème est croissante et ne peut se résumer à une problématique de pays à faible revenu.
En ville comme à l’hôpital
La prévention de la diffusion de ces résistances est désormais un combat actif de la communauté médicale. Certains hôpitaux ont ainsi développé des politiques actives de prescription raisonnée des antibiotiques, en éditant des recommandations d’usage de ces molécules par pathologie, avec l’appui d’infectiologues pour les cas particuliers. Mais en ville, des marges de progression persistent. La France reste un leader de la consommation d’antibiotiques, le troisième plus gros consommateur en Europe. Le développement de tests rapides pour distinguer les infections virales des origines bactériennes, pour les angines en particulier, est un levier pour réduire le mauvais usage des antibiotiques.
Il s’agit de garantir, le plus longtemps possible, l’efficacité des antibiotiques disponibles. La recherche et le développement de nouvelles solutions thérapeutiques ne suffiront pas à enrayer la crise. De manière très schématique, l’industrie pharmaceutique a besoin de 20 ans pour développer un nouvel antibiotique alors qu’il suffit de 24 heures à une bactérie cultivée en laboratoire pour en devenir résistante. Le bon usage, aux bonnes doses et dans les bonnes indications permettront de sauvegarder ces précieuses molécules, en attendant de nouvelles thérapies, telles que la phagothérapie, l’immunothérapie, ou les peptides antimicrobiens et bien sûr de nouveaux antibiotiques, plus efficaces.