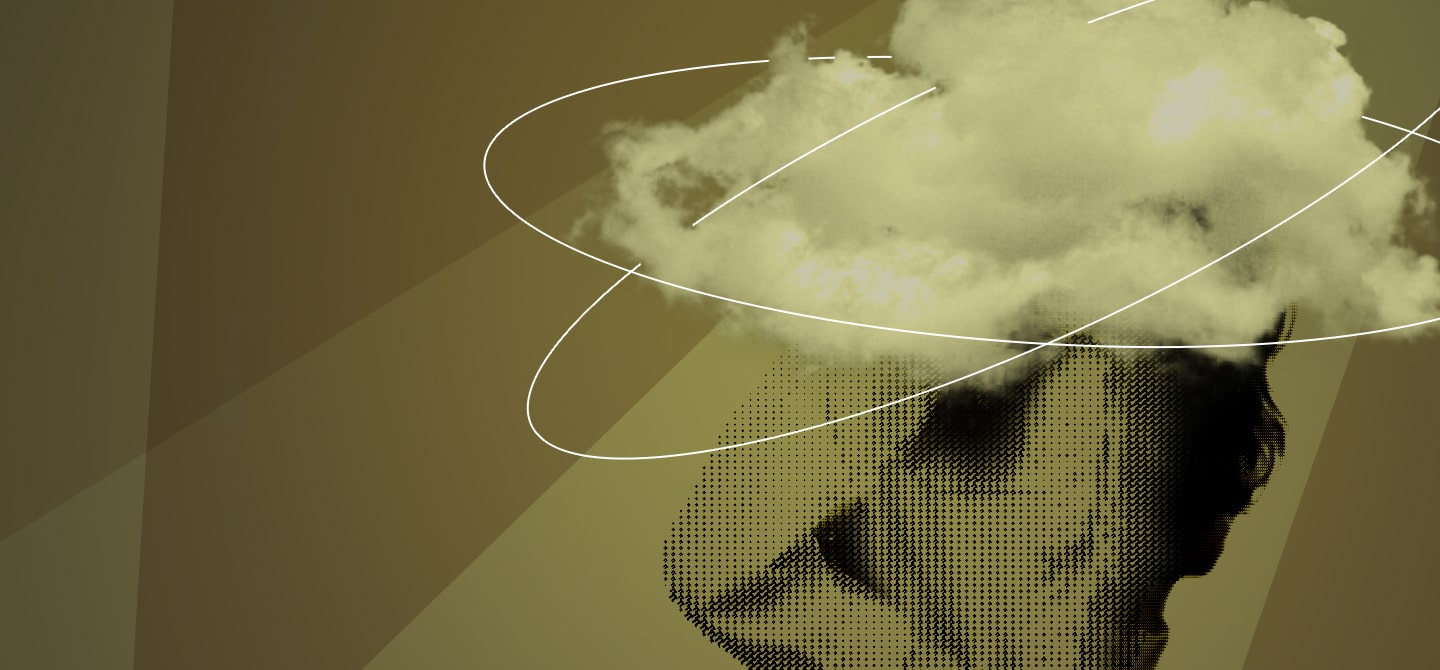Il peut sembler étonnant que la philosophie s’intéresse à l’antibiorésistance. Pourtant, ce problème de santé publique interroge notre rapport au soin, nos représentations de la maladie, ainsi que la position de l’humain au sein de la communauté des vivants. Miraculeux en termes d’efficacité, il faut néanmoins commencer par se souvenir que les antibiotiques ne sont qu’une possibilité thérapeutique parmi d’autres. Quoique moins spectaculaires, leur existence ne saurait être négligée.
Une histoire politique
En Europe et en Amérique du Nord, des approches comme les pommades assainissantes ou les phages, ont été abandonnées. Cette dernière, utilisant des virus mortels contre les bactéries ciblées, était une technique particulièrement développée dans le monde soviétique. Sa prescription complexe et sa logistique particulière n’expliquent pas, à elles seules, leur oubli au profit des antibiotiques. Le contexte politique et la guerre froide doivent aussi être considérés.
Les spécificités de notre culture occidentale associées à la conjoncture d’intérêts économiques ont favorisé l’essor des antibiotiques. Lorsque la production de pénicilline s’est industrialisée dans les années 19401, la médecine moderne se réjouissait de proposer un produit standardisé, capable d’induire une guérison en quelques jours. L’incidence des décès liés aux infections a chuté. La consommation d’antibiotiques s’est généralisée.
Les pays industrialisés ont massivement envoyé cette thérapeutique normalisée aux pays à faibles revenus pour soigner les maladies infectieuses. La prise en considération de la manière dont ces populations pouvaient s’approprier cette approche du soin a fait défaut. Très rapidement, des médicaments contrefaits ou sous dosés sont apparus sur le marché, contribuant à favoriser l’émergence de résistances.
Au-delà de cette expansion économique, c’est notre façon d’appréhender les bactéries et nos états de vulnérabilité que vient questionner l’antibiorésistance. Les scientifiques savent, depuis la découverte des antibiotiques, qu’une utilisation déraisonnable et leur mésusage menacent in fine leur efficacité. Pourtant, ils ont été et parfois sont encore administrés de manière préventive en santé humaine pour éviter une infection secondaire, même chez des patients sans facteurs de risque, ou massivement dans les élevages jusqu’au début des années 2000 en Europe2.
La médecine humaine et vétérinaire a ainsi longtemps exercé sans prendre en compte son environnement, même immédiat, négligeant les équilibres des micro-organismes (pathogènes ou non), avec lesquels nous cohabitons. Le philosophe de la biologie Thomas Pradeu questionne ces frontières entre le « soi » et le « non-soi »3. Ces termes sont-ils adaptés lorsque la présence de ces microbes est indispensable à notre survie ?
C’est néanmoins toujours un vocabulaire empreint de violence, usant d’un champ lexical guerrier qui est déployé pour évoquer les agents infectieux. La médecine et l’hygiénisme « luttent-contre » plus qu’ils ne « composent-avec » les bactéries, véhiculant un imaginaire collectif qui prône leur éradication. Ces représentations entravent notre curiosité du vivant et nos propensions à rechercher des relations d’équilibre dans notre biodiversité.
Affronter la crise
L’OMS alerte sur le risque d’une ère post-antibiotique, dans laquelle les médecins seraient dépourvus de molécules efficaces. La crise est grave, alors même qu’elle était prévisible, voire prévue. « Pourquoi y avons-nous été rendus aveugles » reste la première question à analyser lorsqu’on s’intéresse au phénomène.
Cette dissociation cognitive n’est pas sans lien avec notre conception mécaniste héritée de la philosophie cartésienne. Lorsque René Descartes dépeint notre humanité comme radicalement séparée du reste du monde vivant au début du XVIIe siècle, il établit que le but de l’acquisition de connaissances est de maîtriser la nature, et ce précisément pour la santé humaine, « laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie »4.
Si cette pensée n’a cessé d’être remise en cause par les recherches en écologie et en biologie, elle reste centrale dans la formation des médecins et vétérinaires. Sans la déprécier, on peut remarquer qu’elle privilégie une organisation du soin tournée vers la technique plutôt que la relation.
Les sciences sociales ont pourtant démontré que selon si une personne oriente ses croyances vers des théories scientistes, complotistes ou sceptiques, son comportement face à la prescription changera.
L’antibiorésistance engage ainsi des questions éthiques, invitant les praticiens à réinvestir leur rôle de soignant au-delà de leur capacité technique à guérir. Elle interroge les rapports de domination sachant-médecin et patient-profane, favorisant des approches de co-construction du soin jusque dans les choix de prescriptions. Les philosophies du Care5 sont ainsi éclairantes.
Un soignant n’est pas soignant s’il ne se sent pas soigné par son soigné, formulait élégamment le psychiatre Jean Oury. Ainsi, quand on attend du médecin ou vétérinaire qu’il « éduque » son patient ou client pour que celui-ci ne réclame pas indûment des antibiotiques ou les utilise mieux, on se méprend sur les enjeux.
Construire notre rapport au soin dans de nouvelles directions, ouvrirait donc sans doute la voie à des changements de comportements plus profonds et durables que n’en sont capables les approches gestionnaires. Des approches actuellement mobilisées à la fois par les institutions et par de nombreux experts comme étant la meilleure manière de répondre à notre situation sanitaire.
L’adoption d’approches plus inclusives, comme celle appelée « Une seule santé » ou « One Health »6, promouvant la continuité sanitaire entre les vivants, comptent parmi les pistes d’aiguillage sociétal intéressantes à investir, à condition de dépasser le simple effet d’affichage pour construire un réel investissement philosophique collectif.