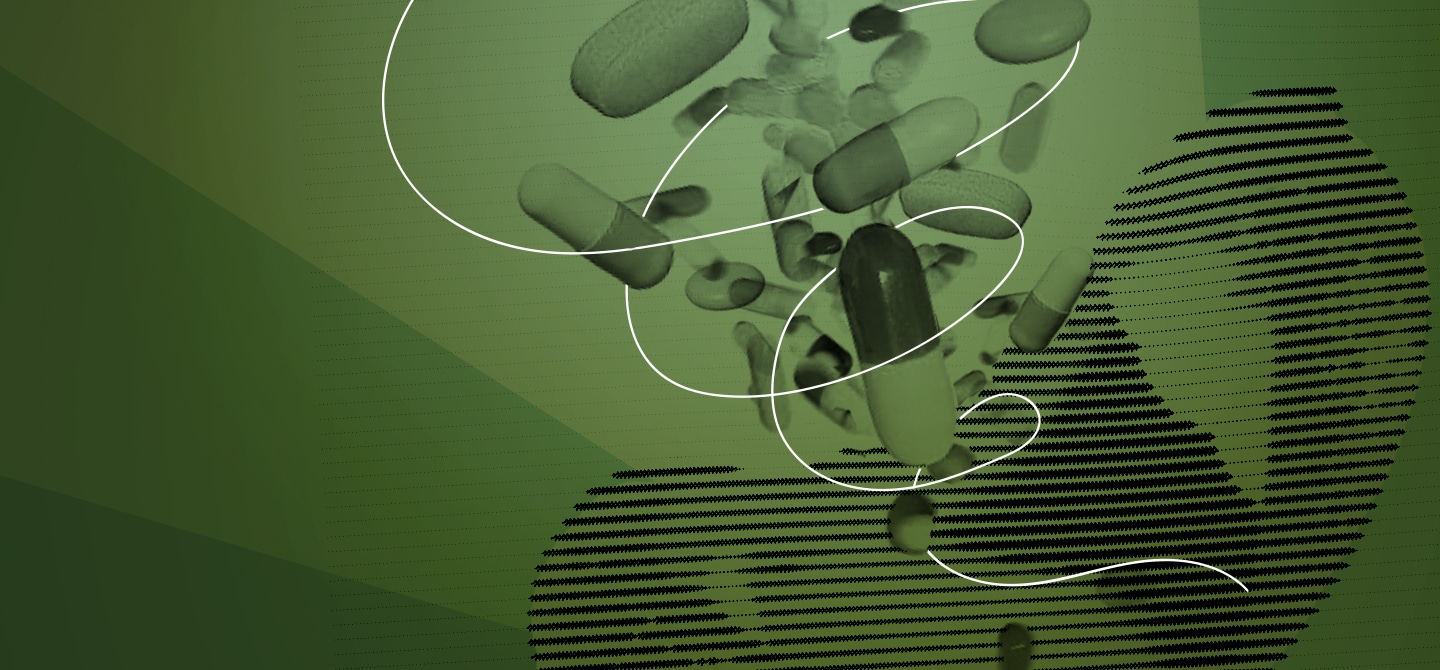Par sa nature systémique, l’antibiorésistance oblige à repenser les catégories utilisées pour classer le vivant. Cette prise de conscience se manifeste au-delà des milieux scientifiques, bouscule la communication, oblige à de nouvelles gouvernances.
Pour Jocelyne Arquembourg, l’antibiorésistance s’est imposée par un paradoxe. « Je travaille sur la manière dont les problèmes de santé deviennent publics et sont médiatisés », explique la chercheuse attachée à Telecom Paris. Et quand elle est sollicitée par des microbiologistes pour se pencher sur l’antibiorésistance, elle découvre un schéma inédit « l’antibiorésistance a du mal à s’imposer dans l’espace public malgré l’importance de la question d’un point de vue médical. » La spécialiste de la communication cherche donc à comprendre comment en est-on arrivé là.
« En Europe du Nord, des patients confrontés à l’antibiorésistance se sont organisés pour dénoncer la consommation d’hormone de croissance dans le bétail, décrit Jocelyne Arquembourg. Mais en France, on n’observe aucune mobilisation publique et le sujet reste largement méconnu par la population. ».
« Les antibiotiques, ce n’est pas automatique. » : le slogan de la campagne de 2002 a pourtant bien été retenu. « Il reste dans les mémoires, il est facile à retenir. Mais ensuite ? Personne ne sait pourquoi ils ne sont pas automatiques, modère Jocelyne Arquembourg. C’était plus une campagne d’accompagnement de la décision du prescripteur qu’une campagne de sensibilisation au sujet. Son objectif ? Permettre de justifier auprès du patient un refus de prescrire des antibiotiques. »
Le succès de cette campagne a été immédiat, la prescription d’antibiotiques a diminué de 10 % les six premiers mois et son effet reste visible sur plusieurs années1. Mais en 2009, la consommation repart à la hausse. Comparée aux autres pays européens, la France reste très mal positionnée. Elle est 26e sur 29 selon les données de Santé publique France, notamment en termes de consommation dans la santé humaine. Jean-Luc Angot, inspecteur de santé publique vétérinaire, ancien président de l’Académie vétérinaire de France et ancien directeur général adjoint de l’Organisation mondiale de la santé animale, se désole « Même le covid a entraîné une hausse de la consommation d’antibiotiques à cause du risque de surinfection. »
En revanche, en médecine vétérinaire, les progrès sont réels. « Les plans Ecoantibio ont réduit de 45 % la consommation d’antibiotique en 9 ans, précise Jocelyne Arquembourg. Ces bons résultats sont le fruit du plan Ecoantibio 1 qui était associé à des évolutions réglementaires [l’interdiction en Europe par les promoteurs de croissances sous forme d’antibiotiques en 2006, NDLR2]. Les plans 2 et 3 ont investi davantage sur la sensibilisation des acteurs », complète Jean-Luc Angot. Sa consœur, Karine Boquet, inspectrice de la santé publique vétérinaire et sous-directrice santé environnement, produits chimiques et agriculture au sein de ministère de l’Écologie témoigne : « Les vétérinaires, par la nature des crises qu’ils ont eu à gérer, comme l’encéphalopathie spongiforme bovine, ont développé une culture professionnelle de la gestion des risques, qui inclut les liens entre santé humaine et santé animale et facteurs environnementaux. »
Le mouvement One Health (Une seule santé)
Des liens qu’on résume aujourd’hui par le concept « Une seule santé », One Health en anglais ou santé globale. « Il s’agit de souligner l’interaction entre les espaces animaux, dont les humains, et la nature », résume Jean-Luc Angot. L’idée émerge à la fin des années 1970 à la suite de zoonoses préoccupantes comme l’encéphalopathie spongiforme bovine. À la fin des années 1990, de plus en plus de bactéries résistantes aux antibiotiques sont découvertes dans les élevages porcins, mais aussi chez des patients humains. L’usage de l’avoparcine comme facteur de croissance en est responsable. « En Suède, au Danemark et au Royaume-Uni, la presse se fait écho d’un débat très virulent, ce qui conduit à l’interdiction de l’avoparcine à usage de croissance en Europe », se souvient Jean-Luc Angot.
Karine Boquet complète : « Le concept “Une seule santé” s’établit sous l’égide de quatre entités internationales : la FAO, l’OIE, l’OMS et le Programme onusien pour l’environnement. Cette approche intégrée vise à optimiser les trois dimensions de la santé : humaine, animale et des écosystèmes. Il faut reconnaître l’interdépendance des trois systèmes pour prendre en compte ces liens dans la gestion des risques. »
« 75 % des maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses et le centre américain de surveillance des maladies (CDC) estime que globalement 60 % des maladies infectieuses sont liées aux animaux, insiste Jean-Luc Angot. Et ces passages d’espèces à espèces peuvent favoriser l’apparition de résistance ! ».
« Une seule santé » articule également ces liens dans l’espace. « Cela implique de raisonner à plusieurs échelles : mondiale, régionale, nationale et locale. Les réponses peuvent être variables selon le territoire, indique Jean-Luc Angot. Par exemple, les actions locales ciblent souvent les élevages, mais leur organisation varie d’un territoire à l’autre. Les approches ne peuvent pas être identiques en Corse et en Normandie. »
Mais si le concept est désormais bien diffusé dans les milieux académique, politique ou réglementaire, il peine encore à se traduire en pratique. « Une seule santé impose de cesser de travailler en silo, mais il est très difficile de décloisonner les disciplines », reconnaît Jean-Luc Angot.
Intégrer la gouvernance
Karine Boquet explique sa démarche au sein du ministère de l’Écologie, « il s’agit d’intégrer cette dimension dans une approche interministérielle, entre les services en charge de la santé, de l’agriculture, de l’écologie, mais pas seulement. Une seule santé, c’est une manière de concevoir la politique avec l’ambition de rendre l’environnement plus favorable à la santé globale. Le plan national santé environnement (PNSE) associe ainsi une dizaine de ministères. »
Et des progrès existent. Karine Boquet évoque le dernier avis de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail)3 qui montre comment les produits biocides favorisent, parfois indirectement, l’antibiorésistance. Le ministère de l’Écologie accompagne ainsi les fabricants de biocides pour favoriser le développement de produits moins nocifs.
« La puissance publique joue ainsi sur plusieurs leviers : la réglementation, les politiques incitatives ou le développement d’un écosystème interministériel favorable », indique Karine Boquet. Mais là encore, cette théorie est bousculée à l’épreuve de la pratique. Ainsi, le ministère de l’Agriculture n’est pas associé au quatrième volet du PNSE, initié depuis mai 2021.
La gouvernance « Une seule santé » reste un challenge pour l’action publique. Karine Boquet acquiesce, « c’est un élément important du PNSE IV. Elle se manifeste dans un étage interministériel, par un Groupe santé environnement réunissant les parties prenantes, et différents suivis de la mise en œuvre de l’approche Une seule santé par un comité présidé notamment par Jean-Luc Angot. » Ce dernier précise : « Au-delà de l’affichage d’un grand principe, l’enjeu est d’orienter des actions. » De son côté, Jocelyne Arquembourg prévient que le concept pourrait être réduit à « un parapluie abritant une addition de plus en plus vaste d’institutions et de disciplines scientifiques, sans véritable réflexion, ni articulations effectives »4. Bref, le changement de paradigme doit encore être enclenché.