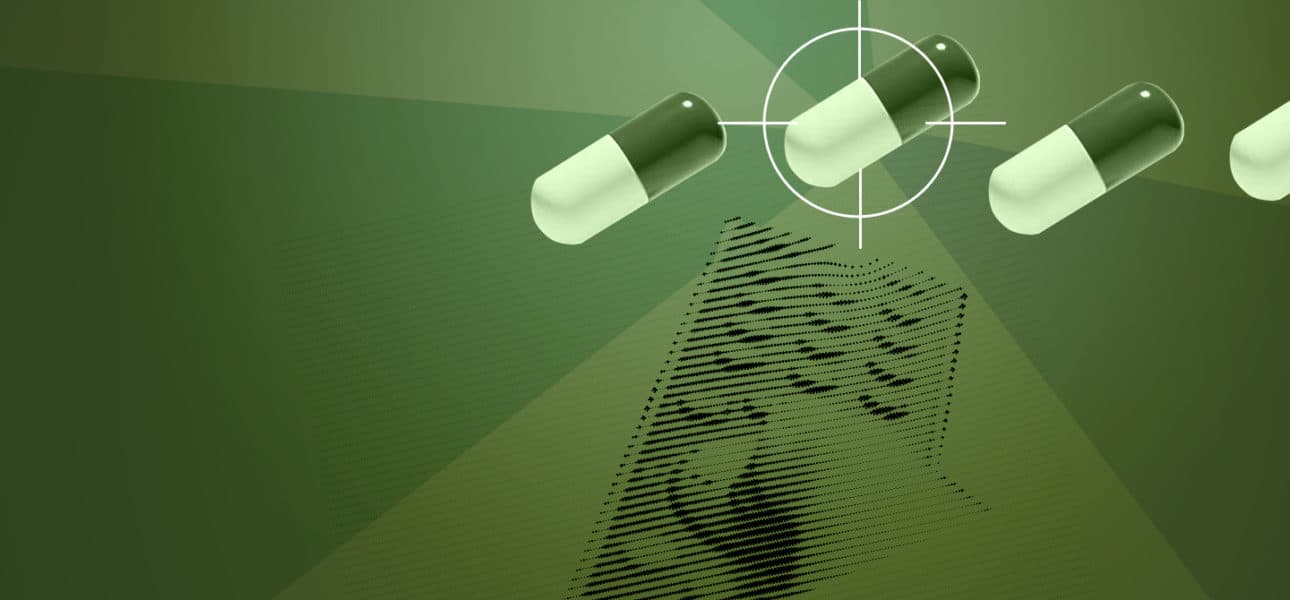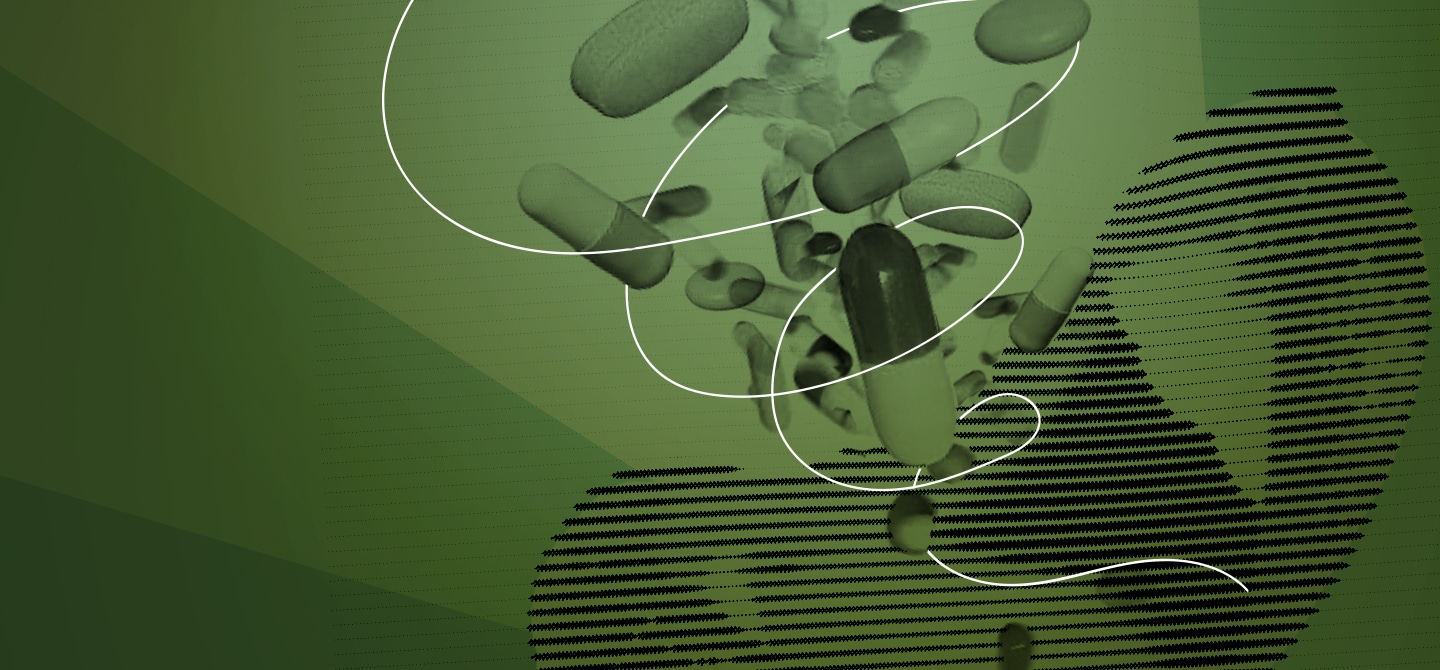Nouvelles approches scientifiques, nouveaux cadres d’évaluations cliniques, nouveaux modèles économiques… Et si, pour résoudre la crise de l’antibiorésistance, il fallait tout réinventer ?
Face au développement des résistances aux traitements antimicrobiens, l’Organisation mondiale de la santé nous met en garde : nous sommes sous la menace d’entrer dans une ère post-antibiotique, une catastrophe sanitaire est annoncée. Hannu Myllykallio, professeur à l’École polytechnique et chercheur du laboratoire Optique et biosciences, le rappelle ainsi, « le rapport O’Neill — rédigé par l’économiste Jim O’Neill sur commande du gouvernement britannique1 — en 2015 montrait que l’antibiorésistance pourrait en 2050 tuer plus que le cancer. »
La recherche a‑t-elle abandonné l’espoir de mettre au point de nouvelles solutions contre les maladies bactériennes ? Non. « De très nombreux laboratoires académiques travaillent sur le sujet », confirme Hannu Myllykallio. Mais pour aboutir, il faudra surmonter de nombreux obstacles. Pour Michael Mourez, directeur de l’innovation au sein de la biotech montpelliéraine Deinove, qui invente de nouveaux antibiotiques en mêlant biologie synthétique et analyses de bactéries peu connues, « le développement d’antibiotique fait face à 3 types de challenges : scientifique, pharmacologique, et économique. »
Défi scientifique
Si le premier n’est pas spécifique à la question antibiotique, il s’y exerce de manière encore aiguë. « L’approche traditionnelle, qui consiste à analyser le contenu d’un extrait de fermentation d’un microbe qui tue la bactérie en laboratoire, ne marche plus depuis 40 ans pour les bactéries Gram négatif et 20 ans pour les Gram positif. Il faut changer de paradigme », résume Michael Mourez.
De nouvelles approches se sont développées. Beaucoup d’espoirs ont été posés sur le criblage ciblé, c’est-à-dire l’analyse des bibliothèques de molécules connues pour trouver de nouveaux antibiotiques dirigés contre des cibles connues. « Mais cela ne marche pas, parce que l’espace chimique de pharmacologie du XXe siècle, très centrée sur l’efficacité dans des cellules humaines, ne couvre pas assez les bactéries, notamment les Gram négatif », explique Michael Mourez. En clair, à avoir trop peu étudié les bactéries, l’industrie pharmaceutique ne connaît pas la biologie microbienne.
C’est ensuite les approches génomiques qui n’ont pas tenu leurs promesses. « On a cru qu’il suffisait d’identifier une nouvelle cible d’après l’analyse de son gène, mais on a négligé les aspects translationnels, insiste le microbiologiste. La manière dont une bactérie se comporte dans un hôte, dans cet environnement biologique qui varie d’un organe à l’autre et ne peut pas être capturé dans un tube à essai »
La communauté scientifique a reconnu son impuissance. En 2007 et 2015, les industriels AstraZeneca2 et GSK3 ont même publié les résultats de leurs recherches infructueuses. Difficile ensuite de les accuser d’avoir manqué d’ambition…
Aujourd’hui les laboratoires tentent de nouvelles approches. « Par exemple, on utilise des systèmes d’intelligence artificielle pour accroître l’efficacité des processus de développement ou analyser les bibliothèques de molécules », explique Hannu Myllykallio. Ces algorithmes cherchent à identifier les structures chimiques les plus prometteuses. Les molécules sont ensuite synthétisées de novo pour être évaluées. En France, l’entreprise Iktos est un leader de cette approche. La démarche est encore inédite pour des antibiotiques, mais en 2022 l’entreprise américaine Insilico Medicine est entrée en phase I avec un médicament antifibrotique entièrement imaginé par intelligence artificielle.
D’autres utilisent des phages, des virus spécifiques des bactéries pour créer de nouvelles approches thérapeutiques. La société française Pherecydes défend cette logique, avec des approches mêlant phages et biologie de synthèse.
Enfin, beaucoup misent sur l’antivirulence, qui consiste à désarmer les bactéries, à bloquer leur action nuisible plutôt que de chercher à empêcher leur croissance4. Michael Mourez ne s’emballe pas : « on ne sait pas encore si cela va marcher. Il reste la question de l’efficacité de cette approche dans l’environnement humain ». Hannu Myllykallio abonde : « Il est facile de trouver des molécules actives sur des bactéries en laboratoire, mais c’est compliqué de montrer qu’elles sont efficaces et sûres chez l’humain. Cela demande de vrais efforts de recherche. On ne peut plus s’appuyer sur les mêmes mécanismes que les précédentes générations de traitements. »

À l’épreuve de la clinique…
La question de l’efficacité n’est pas la seule à prendre en compte lors du développement d’un médicament. Michael Mourez l’explique : « Quand on a un produit qui fonctionne en préclinique, il faut ensuite trouver la bonne dose pour l’administrer à des patients, trouver l’équilibre entre toxicité et efficacité. Ce qui n’est pas simple avec les antibiotiques. » Il faut comprendre que les infections sont provoquées par la multiplication d’un grand nombre de cellules microbiennes. Pour les éradiquer, il n’est pas étonnant de recourir à de grandes doses d’antibiotiques.
Et trouver la bonne dose se confronte à un problème récurrent en biologie : l’imperfection des modèles. « Les souris ne sont pas sensibles aux mêmes pathogènes que les humains, énonce Michael Mourez, donc on utilise des animaux avec un système immunitaire déficient pour étudier les infections. Il existe aussi des tests in vitro pour prédire la puissance d’un antibiotique, mais leurs résultats sont bien trop décorrélés de la biologie humaine. » Là encore les approches classiques échouent à résoudre ce problème pharmacologique.
Enfin, la démonstration clinique d’efficacité est particulièrement ardue pour ces médicaments. « Les antibiotiques actuels ont été développés avant qu’on impose des règles cliniques. Il est presque impossible aujourd’hui de montrer qu’un nouveau produit est plus efficace que les anciens », précise Michael Mourez. Les difficultés s’accumulent. Chaque infection étant unique d’un point de vue biologique, la sélection d’un groupe de patient uniforme est virtuellement impossible. Quant à la comparaison avec un placébo, c’est inenvisageable d’un point de vue éthique, la démonstration de la supériorité d’une nouvelle molécule est difficile. D’autant que ce qu’on attend d’un nouvel antibiotique n’est pas forcément d’être supérieur. Les médecins se contenteraient de produits d’efficacité équivalente avec un mécanisme d’action différent.
Autre difficulté, les pays où les limites de la pharmacopée actuelle sont les plus brutales sont l’Inde et des pays du Maghreb. « Ce sont des Pays hors d’Europe. Y mener des essais cliniques n’est pas trop apprécié des autorités réglementaires américaine (FDA) ou européenne (EMA) », remarque Michael Mourez. Et ces dernières imposaient jusqu’à récemment au moins trois essais cliniques pilotes (phases III), ce qui exige de l’argent et beaucoup de patients. « Et plus on teste le produit sur des gens, plus on augmente le risque d’accident toxicologique », insiste-t-il.
Résultat, très peu de nouvelles molécules empruntent la voie classique de développement. Elles sont rapidement dirigées vers les usages compassionnels, des autorisations d’usage très précoces et réduites aux patients ayant épuisé leurs options thérapeutiques.
En conséquence, récemment, la FDA et l’EMA ont modifié leurs attentes pour les antibiotiques. Des essais d’ampleur plus limitée, dits de « preuve de concept » (phases II), peuvent maintenant suffire à compléter un dossier d’autorisation de mise sur le marché, avec des restrictions : l’entreprise qui commercialise un antibiotique de cette façon s’engage à poursuivre les essais en clinique ainsi qu’à une surveillance accrue de la résistance et de la sécurité du médicament (phase IV).
… Et du financier
Le dernier problème est économique. « Le développement d’un produit coûte environ 1,3 milliard de dollars et nécessite entre 10 et 15 ans, explique Michael Mourez. C’est équivalent à une molécule dans le domaine de l’immuno-inflammation ou l’oncologie par exemple. Mais lorsqu’un nouvel antibiotique est autorisé, contrairement à un nouvel anticancer, il ne doit pas être vendu, mais conservé pour n’être utilisé qu’en tout dernier recours. »
« Un mauvais antibiotique se vend aussi bien qu’un bon », renchérit-il. On ne peut donc pas compter sur le marché pour récompenser les efforts de R&D. C’est donc sur le prix de base du traitement que les sociétés biopharmaceutiques attendent leur retour sur investissement. « Le ceftolozane/tazobactam ou le ceftazidime/avibactam [deux associations mises sur le marché en 2015, NDLR] coûtent environ 10 000 dollars le traitement. Cela semble énorme, mais ce sont des coûts de maladies orphelines », justifie Michael Mourez. Il s’agit de traitements de derniers recours, qui ne peuvent être prescrits que lorsque les solutions de premières lignes ont échoué. « Ces combinaisons de dernières générations n’ont été vendues que pour 100 millions de dollars, complète le spécialiste. C’est trop peu compte tenu des coûts de développement et de suivi de leur mise sur le marché, comme la participation à l’Observatoire des résistances et aux programmes d’éducation thérapeutique. »
Les sociétés qui développent des antibiotiques plaident donc pour de nouveaux modèles économiques. « L’alliance Beam propose des systèmes de transfert de brevet pour aider à financer des petites entreprises qui trouvent de nouveaux antibiotiques. On imagine aussi une sorte de “Netflix” de l’antibiothérapie, un système d’abonnement des états qui assurerait le financement de la R&D. », énonce Michael Mourez. Un délire de start-uppers ? Non. Les États-Unis ont déjà légiféré sur un système de ce type avec le Pasteur ACT5. Et le Royaume-Uni l’envisage avec une évaluation sur deux molécules6. Cela sauvera-t-il notre monde antibiotique ? L’avenir nous le dira.