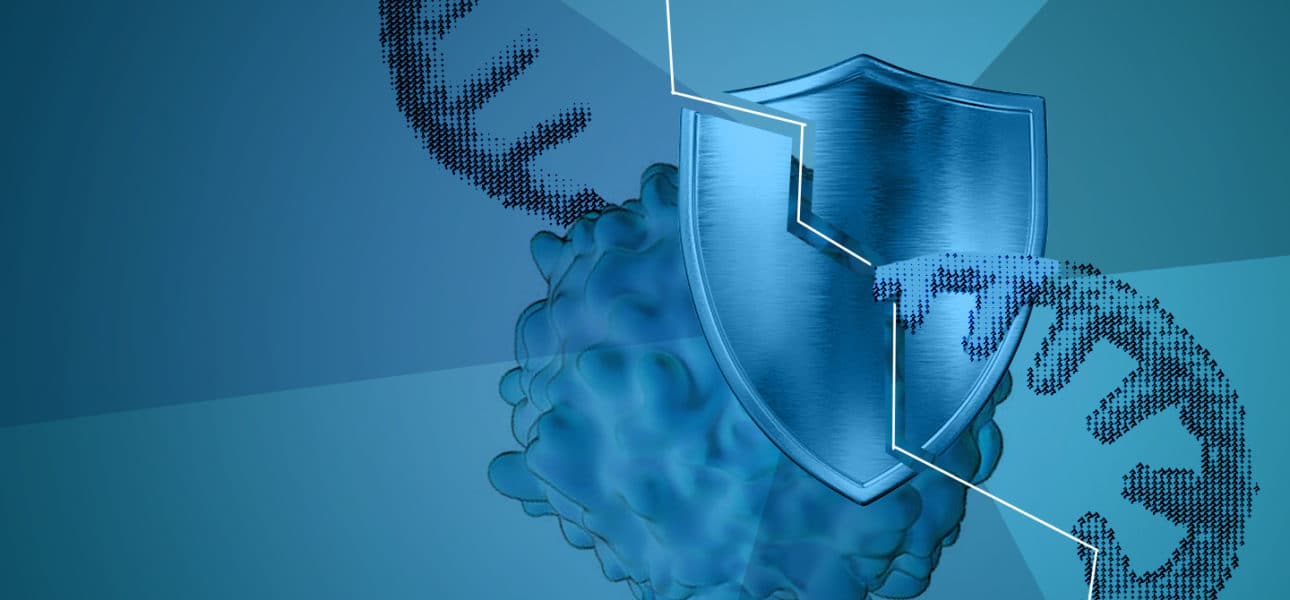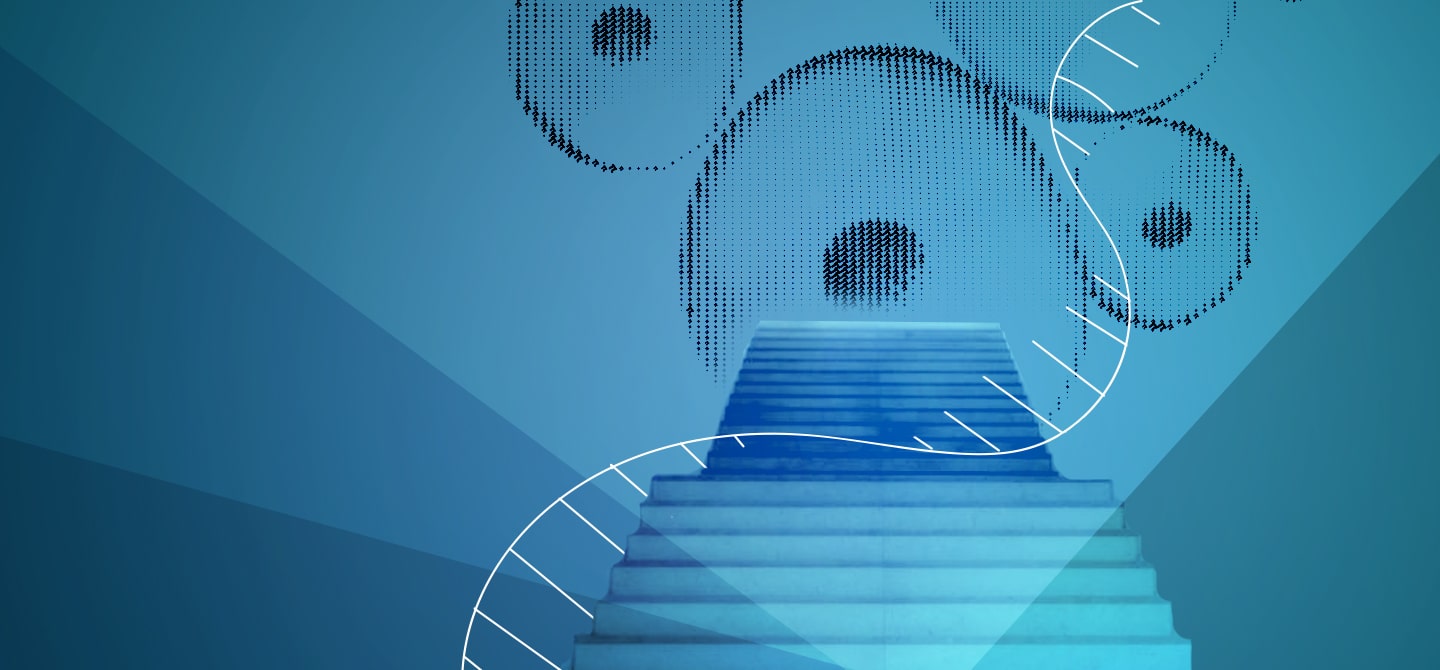Plus de 300 000 nouveaux cancers sont diagnostiqués chaque année en France, avec plus de 150 000 décès qui leur sont imputables. Si la recherche clinique a fait des progrès significatifs ces dernières décennies, en permettant d’affiner le diagnostic, de mieux soigner, voire de guérir certains types de tumeurs, les besoins de nouvelles thérapies restent immenses. La biologie moléculaire a montré que les cancers sont provoqués par une accumulation d’altérations du génome des cellules tout au long de la vie, ce qui à terme peut aboutir à une prolifération cellulaire non contrôlée : un cancer. Mais les tumeurs malignes utilisent d’autres stratégies pour se déployer. Ainsi, elles modifient leur « micro-environnement » et construisent autour d’elles un nouveau réseau de petits vaisseaux sanguins, apportant les éléments nutritifs qui lui sont indispensables. La modification tolérisante du micro-environnement tumoral protège les tumeurs du système immunitaire en créant une sorte de bouclier. La réponse immunitaire est ainsi affaiblie, le corps commence à tolérer la tumeur, réminiscent de la tolérisation d’un fœtus et de son placenta qui représente les antigènes des deux parents et pas seulement ceux de la mère.
Les propriétés immunostimulatrices des ARN messagers (ARNm) de synthèse peuvent aider à corriger ce phénomène. Cette stratégie consiste à produire des ARNm codant pour des protéines considérées comme étrangères au patient normal, on les nomme « épitopes tumoraux ». Ces molécules peuvent être considérées comme des biomarqueurs immunitaires des tumeurs. Lorsque le système immunitaire reconnaît ses protéines, il réagit presque comme pour des agents pathogènes (virus ou microbes), il garde en mémoire ces marqueurs. C’est pourquoi on parle de vaccin anti-cancer pour décrire ces ARNm. En injectant ces vaccins aux patients, il ne s’agit pas de vacciner contre un pathogène, mais de rééduquer le système immunitaire à reconnaître un ou plusieurs marqueurs de cellules cancéreuses. Encore faut-il identifier ce, ou plutôt ces marqueurs.
Une tâche complexe, mais pas impossible
Les cancers utilisent de multiples voies pour se développer et ils ont une grande plasticité. Il est donc crucial d’étudier le génome des tumeurs de chaque patient afin d’identifier la pertinence des épitopes tumoraux. Du point de vue médical, ces thérapies sur-mesure sont intéressantes, mais les prototypes risquent d’être très coûteux et seront réservés aux patients soignés dans des centres experts en immunothérapie, tant leur mise en œuvre est technique.
Afin de simplifier le champ d’investigation, des entreprises biomédicales envisagent la production d’ARNm ciblant des antigènes tumoraux fréquents et bien connus. La société allemande BioNTech, qui s’est fait connaître pour avoir développé le vaccin anti-Covid avec Pfizer, est très en avance sur ces programmes. Elle dispose ainsi d’ores et déjà de plusieurs ARNm-candidats, étudiés dans des tumeurs hématologiques ainsi que dans de nombreuses tumeurs solides.
Parmi les épitopes antigéniques tumoraux, certains sont communs à des cancers survenant dans des organes différents. C’est le cas, par exemple, de certains récepteurs membranaires tels que l’EGFR (HER1) (qui sont activés par des mutations activatrices présentant des épitopes antigéniques différents des récepteurs normaux) dans de nombreux adénocarcinomes, c’est-à-dire dans des sous-groupes de cancers du sein, de la prostate, de la thyroïde, du pancréas, des ovaires, du rein, du foie, du cancer colorectal. Néanmoins, dans les tumeurs avancées, plusieurs oncogènes sont activés, et surtout, un grand nombre de gènes suppresseurs (les freins physiologiques de la prolifération cellulaire) sont perdus, permettant une avancée tumorale sans contrainte.
Une mise sur le marché pas si lointaine ?
La plupart de ces candidats-vaccins sont actuellement en phase d’étude clinique de type 1 ou 2, testant leur tolérance et leur efficacité contre des mélanomes métastatiques, des cancers de la tête et du cou, des tumeurs ovariennes et des cancers colorectaux. Alors qu’il est d’usage de faire une étude de phase 3 comparative avec les traitements « standard » précédents avant de solliciter l’autorisation de mise sur le marché, dans ce cas, cela risque d’être compliqué. Il est en effet délicat sur le plan éthique de construire un essai clinique où certains patients sont traités par une chimiothérapie conventionnelle développée empiriquement en clinique sur la base d’un taux de réponse et de la durée de cette réponse. Les chimiothérapies conventionnelles fréquemment utilisées agissent en entravant des fonctions cellulaires, par exemple en empêchant la réparation de l’ADN, ou en bloquant le fuseau mitotique, mais les résistances à ces mécanismes commencent seulement à être élucidés. Dans un contexte de tumeurs évoluées avec altérations multiples, il pourra être aussi très complexe de construire des groupes à comparer, c’est-à-dire avec des patients partageant exactement les mêmes anomalies moléculaires dans le bras actif et le bras témoin. Ces innovations pourraient donc potentiellement accéder au marché à partir de solides données de phase 2.
In fine, les tumeurs avancées sont très hétérogènes tout en étant pourvues d’une grande plasticité. Lorsqu’elles se dispersent dans le corps, formant des métastases, malgré l’administration d’un ou plusieurs traitements, les cellules tumorales « persistantes » sont remarquables par leur adaptabilité et par la présence de nombreux défauts qui les empêchent de mourir. Dans cette situation, il est communément admis qu’il faudra cibler le cancer par de multiples approches conjointement. Un très grand nombre de laboratoires s’intéressent aux ARN dans le cadre de futurs traitements contre le cancer. Si elles poursuivent avec succès leur développement, elles viendront compléter l’arsenal thérapeutique actuel, et utilisés conjointement avec d’autres thérapies ciblées devraient réduire davantage la mortalité de ces pathologies.