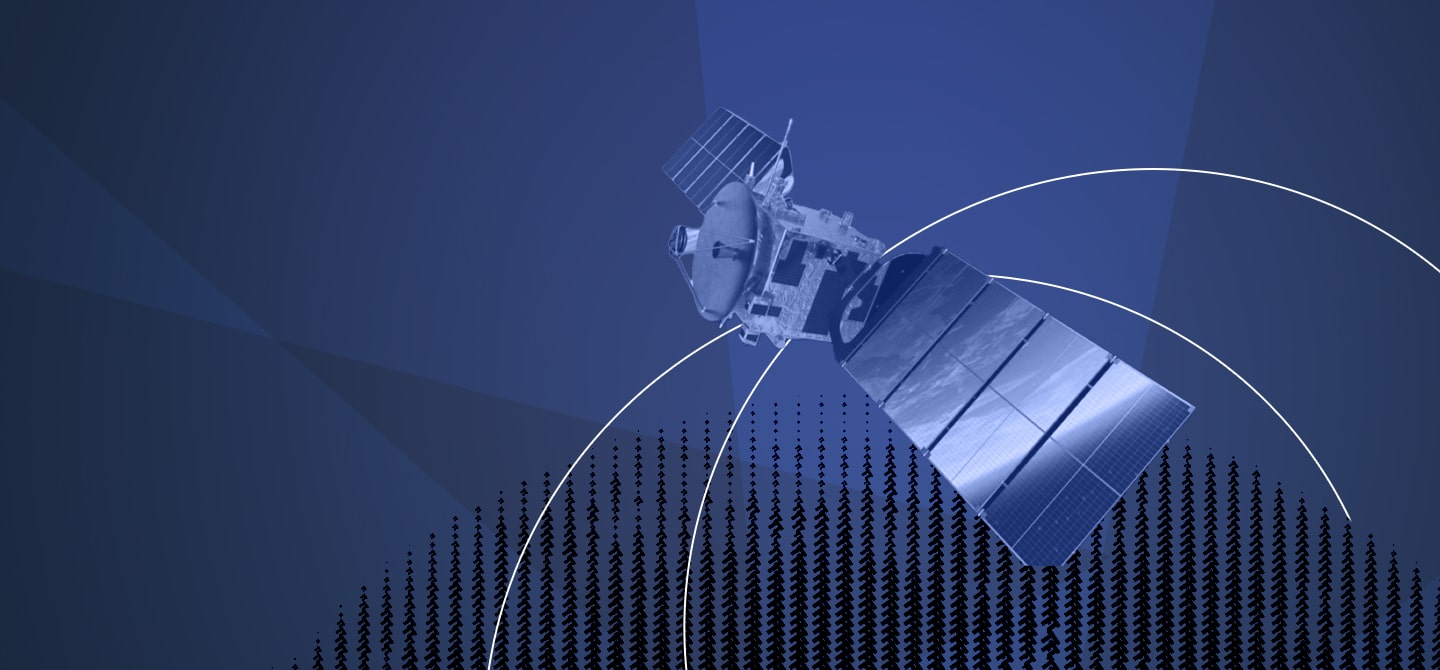Votre thèse porte sur la manière dont le secteur des transports peut répondre à l’objectif de neutralité carbone en France à l’horizon 2050. Quelle est la situation du transport aérien aujourd’hui ?
Sur les dernières décennies, le nombre de passagers a doublé tous les quinze ans. On observe aussi une augmentation des distances moyennes. La consommation moyenne par passager a baissé, elle a été divisée par quatre depuis 1960, en raison des progrès techniques et du meilleur remplissage des avions. Néanmoins, ces progrès ont été plus que compensés par la hausse du trafic. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien augmentent donc continûment, et seules quelques crises, comme celle après les attentats du 11 septembre 2001, la crise économique ou ce que nous vivons en ce moment avec le Coronavirus, sont capables de freiner temporairement cette croissance.
Le secteur aérien est-il capable de se décarboner ?
Pour qu’il se décarbone, il faudrait des innovations de rupture, afin que le secteur soit capable de se passer de pétrole. Ces innovations peuvent être évaluées selon plusieurs critères : leur impact environnemental (sur le CO2, mais pas uniquement), leur coût, et la date envisagée de leur mise en œuvre. Or, selon ces critères, aucune technologie n’est compatible avec la trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050, fixée dans le Plan climat français, ou avec une trajectoire mondiale compatible avec la limitation du réchauffement à +2°C. Le risque est alors de reporter les efforts sur les autres secteurs.
Les biocarburants, par exemple, ne sont-ils pas une solution ?
Les biocarburants actuels, dits de première génération, sont en moyenne aussi émetteurs de gaz à effet de serre (GES) que le pétrole, si on regarde leur analyse de cycle de vie (ACV)1. C’est dû notamment au changement d’affectation des sols : des surfaces peuvent être déforestées pour faire place aux cultures pour les biocarburants, ce qui émet des GES. On peut envisager des biocarburants de deuxième génération, utilisant des résidus de culture, des biodéchets. Ces biocarburants sont bien moins émetteurs de GES, mais la ressource est limitée. Le potentiel est insuffisant pour remplacer les carburants pétroliers dans l’ensemble du secteur aérien. Et n’oublions pas que d’autres secteurs, comme le secteur routier ou le maritime, souhaitent aussi les utiliser.
La solution viendrait-elle de l’hydrogène ?
Le gouvernement a récemment annoncé une stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné2. On parle des premiers avions à hydrogène pour 2035, mais une flotte ne se renouvelle que tous les 20 ans, minimum. Ce plan ne permet pas de respecter l’accord de Paris sur le climat. Pour rester sous les 2°C de réchauffement climatique, il faut diminuer d’au moins 2,7 % nos émissions de gaz à effet de serre chaque année, ce qui sera impossible. Par ailleurs, l’hydrogène a un inconvénient majeur : il est difficile à stocker. Il est donc réservé aux vols de petite et moyenne distance. Or, les longs courriers représentent la majorité des gaz à effet de serre du secteur aérien. Enfin, son coût risque de rester prohibitif.
D’autre part, les gaz à effet de serre ne sont pas le seul problème de l’aviation vis-à-vis du climat. Les émissions de NOx, les traînées de condensation et les cirrus induits3, qui ont aussi un impact réchauffant via les réactions chimiques qu’ils entraînent, ont également un impact négatif. Or, ni les biocarburants ni l’hydrogène ne résolvent cela.
Alors quelles sont les solutions ?
Elles ne seront pas forcément techniques. Il faut raisonner différemment. Le secteur aérien souligne souvent que l’avion ne consomme pas plus, par passager et par kilomètre, que la voiture. Si l’on regarde les émissions de CO2 par heure, selon les différents modes de transport, c’est très différent. L’histoire des mobilités montre que les temps de déplacement sont constants, une heure par jour en moyenne. Notre mobilité est donc façonnée par la vitesse des modes de transport : l’essor des modes rapides nous fait parcourir 40 à 50 kilomètres par jour en moyenne, contre 4 à 5 km il y a deux siècles. Pour les longues distances, le même raisonnement s’applique. La rapidité de l’avion facilite les trajets longs. Si l’on regarde les émissions par temps de transport, celles de l’avion sont gigantesques comparé à d’autres : de l’ordre de 90 kg CO2/h, contre 7 kg CO2/h pour la voiture, et 0,6 kg CO2/h pour le train. Raisonner par temps de transport montre que l’avion est à la fois le mode qui a les émissions les plus polluantes, parce que les émissions par kilomètre sont fortes, et qui pousse à faire de plus longues distances.
Dès lors, que faire pour atteindre une baisse suffisante des émissions du secteur aérien ?
Il n’y a qu’une réduction du trafic qui puisse permettre cela. Mais aujourd’hui, c’est clairement un tabou pour les politiques publiques, qui ont anticipé la croissance à venir avec les extensions d’aéroports prévues au terminal 4 de Roissy, à Nice, Caen ou Lille. Le plus simple est d’agir sur les vols intérieurs en fermant les liaisons peu fréquentées et faisables en train, en allant au-delà des 2 h 30 préconisées actuellement car l’impact est insuffisant. Pour les transports internationaux, la modération doit être pensée au niveau mondial pour avoir un effet significatif. Cela peut passer par exemple par la taxation des carburants. Les entreprises peuvent aussi opter pour le train pour les trajets inférieurs à 4 ou 5 h et favoriser les visioconférences pour réduire les grands trajets. Mais 75 % des trajets sont dus aux particuliers.
Thèse soutenue le 23 novembre 2020 et disponible ici.
Pour en savoir plus sur ce sujet, voir l’article d’Aurélien Bigo dans The Conversation.