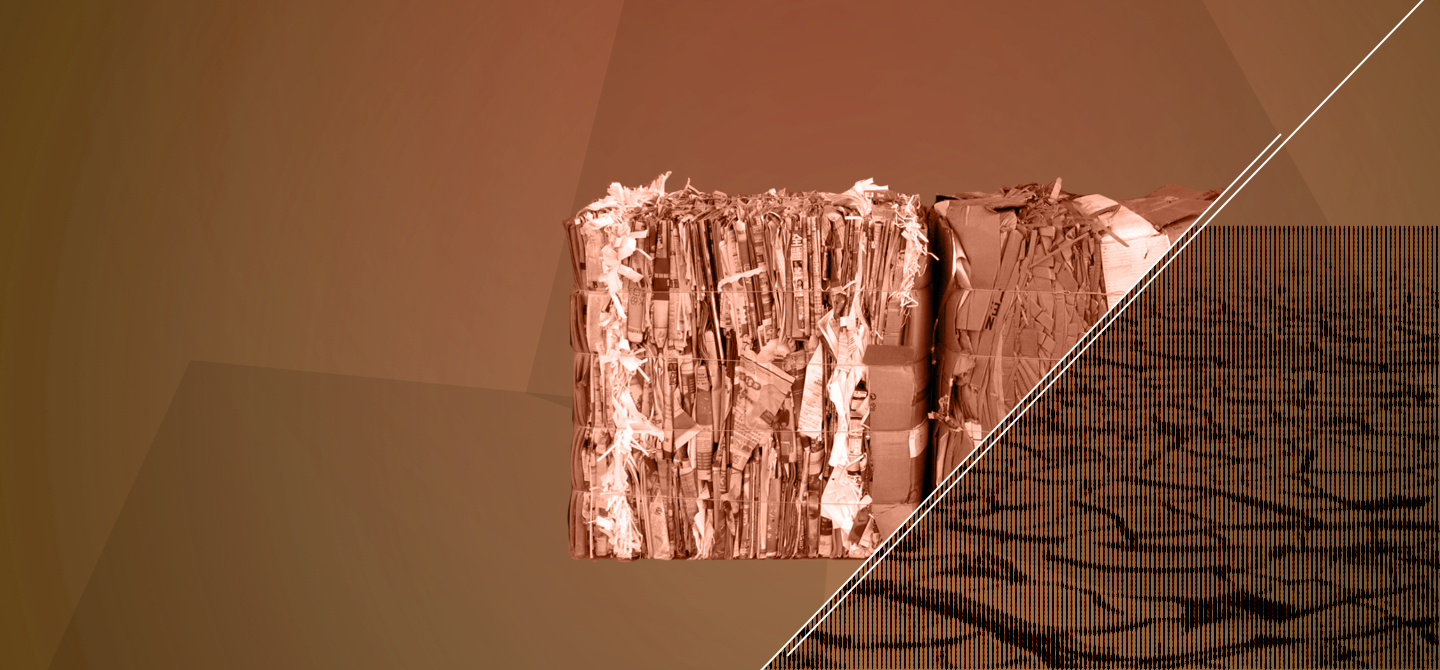Avant d’imprimer des objets en 3D, il faut d’abord les modéliser à l’aide de logiciels CAO (Conception assistée par ordinateur). Cette phase, fondamentale, encourage la créativité et la personnalisation du produit, mais sert également à l’analyser avant même qu’il ne soit prototypé. Cependant, ce processus, qui implique de nombreuses étapes pour établir un paramétrage précis, demande également un haut niveau de connaissance de l’opérateur.
Albane Imbert dirige une plateforme technologique scientifique, le Making Lab, au sein de l’Institut de recherche biomédical Francis Crick à Londres. Les plateformes fournissent une expertise technique aux laboratoires de recherche du Crick mais aussi des instituts partenaires. Avec son équipe, elle fabrique de nouveaux outils pour les chercheurs afin de répondre à des questions de recherche complexes et d’accélérer les découvertes biomédicales.
Pouvez-vous expliquer brièvement en quoi consiste votre travail ?
Albane Imbert. Notre expertise va de la micro-fabrication (quelques microns, à l’échelle des systèmes cellulaires) pour contrôler les systèmes biologiques, à l’électronique et la mécanique. On utilise aussi de l’optique pour mesurer les activités biologiques et imaginer des dispositifs d’aide à l’imagerie biomédicale. L’impression 3D fait partie des technologies que nous utilisons quotidiennement parce qu’elle nous permet de produire rapidement des prototypes fonctionnels.
C’est un travail de collaboration entre les chercheurs et notre équipe qui s’inscrit dans une tendance mondiale d’adaptation des technologies de prototypage rapide à la recherche, et plus spécifiquement en biologie.
Existe-t-il des différences majeures entre les logiciels de modélisation pour la fabrication additive dans l’industrie, dans la recherche, ou pour un usage domestique ?
L’offre est très variée en matière de logiciels de modélisation 3D, car chaque secteur d’activité (industrie, design, architecture, animation, recherche…) a des besoins spécifiques, nécessitant des fonctionnalités précises et plus ou moins complexes. Le curseur en matière de choix se place donc autant sur l’usage que sur le niveau d’expérience de l’utilisateur.
En même temps que la fabrication additive, la modélisation 3D s’est largement démocratisée et l’on trouve aujourd’hui d’excellentes solutions logicielles simple et gratuites destinées aux personnes souhaitant s’initier. Mais attention, si simple d’usage que soit l’imprimante 3D, attendez-vous à consacrer un peu de temps pour maîtriser le processus d’impression : c’est un coup de main à prendre.
Sauf cas particulier, en industrie par exemple, les deux étapes que constituent la modélisation 3D et la programmation de la fabrication sont bien distinctes, et passent par deux logiciels différents : le logiciel de modélisation, puis le logiciel de découpage qui dépend de l’imprimante 3D utilisée et permet le paramétrage de l’impression. Une modélisation 3D doit tenir compte du mode de fabrication de l’objet et du matériau employé. On n’imaginera pas de la même manière un objet usiné en métal ou imprimé en plastique par exemple, parce que le matériau est différent mais aussi parce que la technologie de fabrication choisie impose ses contraintes. Et en recherche, eh bien… ça dépend de ce qui intéresse le laboratoire !
Dans notre domaine, nous nous concentrons principalement sur de l’impression de résines photosensibles à petite échelle, avec une grande précision et des matériaux biocompatibles ou résistants aux traitements chimiques. Nous étudions aussi des flux de liquide entrant et sortant des pièces, et optimisons nos modélisations pour qu’elles soient imprimables en respectant toutes ces conditions.
Comment voyez-vous le développement futur des logiciels de modélisation ? Est-ce qu’ils vont devenir de plus en plus simples à utiliser, surtout pour les particuliers, ou il existe des limites techniques infranchissables ?
Le secteur de l’impression 3D a de beaux jours devant lui, et les logiciels qui l’accompagnent aussi. Face à une demande toujours plus spécifique, ils vont continuer de se spécialiser, c’est-à-dire de se complexifier en termes de puissance et d’options disponibles, tout en se simplifiant au niveau de l’utilisation pour l’utilisateur. Les interfaces sont déjà bien plus pratiques qu’il y a 10 ans.
Les limites techniques se trouvent plutôt du côté des machines, mais là encore les particuliers bénéficient de la démocratisation des technologies de fabrication additive, dont les prix ont considérablement baissé ces dernières années. On trouve aujourd’hui des imprimantes de grande qualité à 500€, fiables et faciles à utiliser, qui concurrencent des machines professionnelles.
Quels risques l’impression 3D présente-t-elle en termes de contrefaçon ou de piratage ?
La contrefaçon est un sujet d’actualité sur lequel une réflexion profonde doit être menée, car l’impression 3D vient bouleverser l’équilibre du pouvoir de production entre industrie et particuliers. Est-ce pour autant quelque chose de négatif dont il faut se prémunir ? Je ne le crois pas.
En mars dernier la start-up italienne Isonnova s’est fait connaître du grand public en copiant puis distribuant aux hôpitaux les valves de respirateurs dont ils manquaient, et que l’entreprise responsable de leur production ne pouvait pas fournir. Leur action a sauvé des vies, mais les a aussi exposés à de possibles poursuites Peut-on alors parler de contrefaçon ? Je pense au contraire que cet outil participe à redresser la balance entre chaîne de production et consommateur. Il donne à ces derniers un plus grand pouvoir sur leur environnement en leur permettant de produire eux-mêmes ce dont ils ont besoin.
Vous pouvez donc aisément trouver le modèle 3D d’un objet sur des répertoires en libre accès sur Internet et alimentés par les utilisateurs. Certaines entreprises l’ont bien compris et se prêtent au jeu en mettant à disposition les modèles 3D de leurs pièces détachées pour réparer des appareils vieillissants, luttant ainsi contre l’obsolescence programmée.