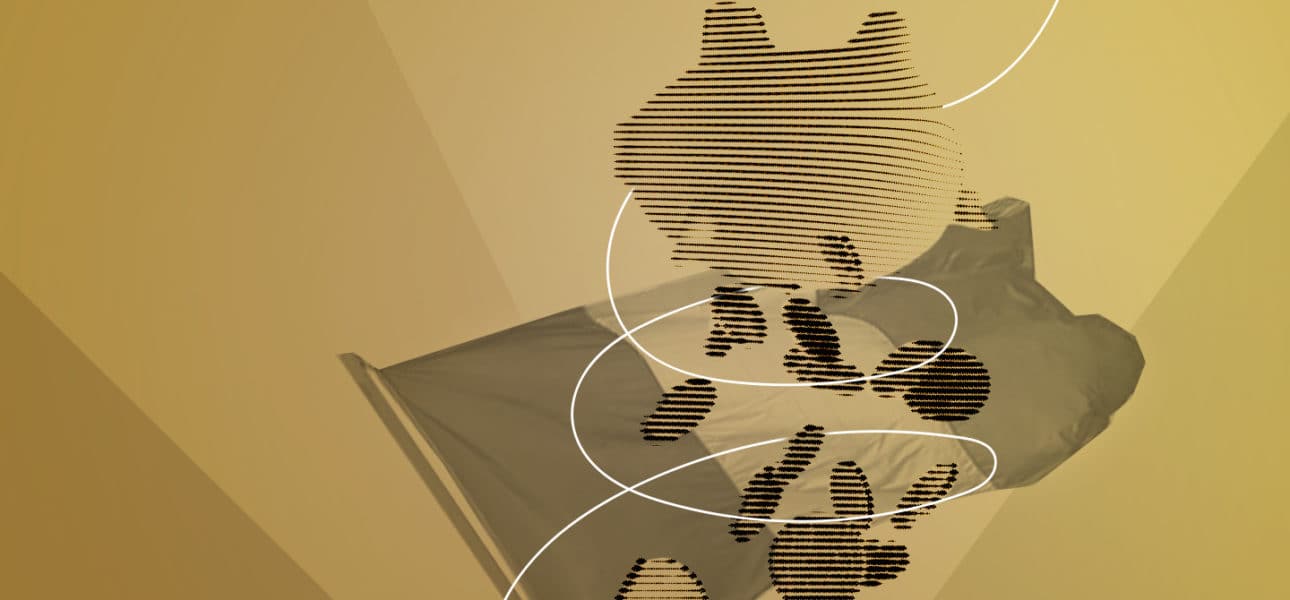Les propositions de revenu universel qui apparaissent aujourd’hui dans les pays développés sont portées par des familles intellectuelles différentes. Elles ont en commun d’interroger la légitimité de la protection sociale telle qu’elle s’est développée depuis la fin du XIXe siècle. Pour la perfectionner, la remplacer, ou entamer une toute nouvelle histoire.
Le revenu universel qui s’impose aujourd’hui dans le débat public est-il de gauche ou de droite ?
Julien Damon. Les promoteurs du revenu universel appartiennent à plusieurs familles intellectuelles et politiques. La plus connue, qui oriente une bonne partie du débat actuel, vise à compléter l’État-providence avec un socle universel, de façon à ce que plus personne ne passe à travers les mailles du filet.
Mais une autre famille mise sur le revenu universel pour pulvériser ce même État, avec, par exemple, Milton Friedman, qui proposait un impôt négatif, sur la base du raisonnement suivante : c’était une erreur de développer l’État-providence, mais on ne peut s’en débarrasser aisément, et la formule de l’impôt négatif était la moins nuisible à ses yeux.
À côté des libéraux classiques, il y a également les libertariens-conservateurs comme Charles Murray, qui propose d’en finir avec toutes les politiques sociales en allouant à chaque adulte 10 000 dollars par an, charge à lui de s’assurer et de préparer sa retraite.
On le voit, il y a non seulement une forte diversité d’instruments, mais aussi d’idéologies.
Tous mettent en avant la simplicité du dispositif. Est-ce simplement parce que les coûts de gestion des systèmes complexes que nous connaissons aujourd’hui seraient significativement réduits ?
Cela va beaucoup plus loin. On parle ici d’une visée radicale de simplification qui amène à s’interroger sur la légitimité même de l’édifice de protection sociale.
Là encore, si les deux côtés du spectre idéologique peuvent se retrouver dans la proposition, ils n’y mettent pas la même chose.
Du côté « socialiste » on sera sensible à une plus grande lisibilité d’un système si complexe que les plus modestes ignorent souvent qu’ils ont droit à une allocation, ce qui se traduit par un taux élevé de « non-recours ».
Du côté « libéral » la simplification visera surtout à limiter l’empilement des dispositifs qui peut conduire à des formes d’assistanat. Notons que la plus grande simplification consiste à tout supprimer.
La complexité des dispositifs renvoie à une histoire déjà riche, avec plusieurs modèles types de protection sociale. Assiste-t-on à la victoire d’un modèle, ou à une nouvelle étape ?
Historiquement, la protection sociale, à vocation collective sinon universelle, a constitué un dépassement de l’assistance qui, même publique, relevait encore du monde de la bienfaisance et de la philanthropie.
Deux grands modèles se sont constitués : le premier, dit « bismarckien », était un système contributif et professionnel. Les salariés devenaient des « assurés sociaux ». Le second, dit « beveridgien », est financé par l’impôt et sa visée est plus universelle.
En pratique, les deux systèmes se sont hybridés. La sécurité sociale française, par exemple, est bismarckienne dans son principe, mais au fil des années, les droits se sont élargis et la solidarité nationale (donc l’impôt) a pris une place de plus en plus grande dans son financement. C’est le cas dans d’autres pays développés.
Le revenu universel, qui est d’essence beveridgienne, pourrait être considéré comme une étape supplémentaire dans cette évolution, avec l’achèvement d’un mouvement d’universalisation. Mais ce serait insister sur des effets de continuité, quand il y a potentiellement quelque chose de profondément nouveau dans cette proposition. Le revenu universel, en tout cas, n’est pas la baguette magique qui permettrait de parfaire l’édifice issu de l’histoire.
Il peut d’ailleurs contredire un élément constitutif du « social » : les dispositifs qui constituent la protection sociale sont aussi des politiques sociales, dont chacune vise un effet particulier. L’introduction d’un revenu universel ne remet-elle pas en cause cette idée d’une action ciblée sur des problèmes sociaux ?
Oui, s’il s’agit d’un remplacement. Non, s’il s’agit simplement de compléter le système existant. Mais il faut comprendre que dans les pays développés, même si l’on sait que les édifices massifs de protection sociale posent bien des problèmes, ils sont précisément si massifs, si enchevêtrés à notre vie, qu’une substitution complète serait une véritable révolution, difficilement imaginable. La question se pose en des termes très différents dans les pays comme l’Inde ou le Kenya, par exemple, où la protection sociale reste largement à construire et où l’on expérimente le revenu universel.
C’est une autre façon de considérer la question des seuils, souvent évoquée. Dans un pays riche, rien de plus facile que d’introduire un revenu universel de 1 euro par an et par habitant. Si l’on monte à 500 euros par mois, ce qui peut représenter un effort considérable et des arbitrages colossaux à réaliser, les spécialistes noteront que cela n’aurait aucun effet sur les gens qui bénéficient déjà des dispositifs actuels (comme le RSA en France). Tout au plus, limiterait-on un peu le taux de non-recours. Pour simplifier, si l’objectif est de lutter contre la pauvreté, cela ne sert à rien puisque les instruments existent déjà.
Mais précisément, est-ce vraiment cela l’objectif ?
C’est toute la question, et ici on entre vraiment dans une autre dimension. Car l’État-providence a été créé historiquement pour protéger contre les grands risques de l’existence : la maladie, la vieillesse impécunieuse, le chômage. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une de ses formes principales est l’assurance.
Mais le revenu universel, tel que l’envisagent ses promoteurs à la fois les plus radicaux et les plus consistants comme Philippe Van Parijs, a un autre objectif : permettre la liberté. De fonder une société où chacun pourra vraiment choisir entre, par exemple, un travail ennuyeux mais bien rémunéré ou un travail plein de sens mais quasiment pas rémunéré. C’est pourquoi les chiffres qu’ils proposent sont beaucoup plus proches du salaire moyen que des allocations sociales. L’objet n’est pas le hors travail, mais le travail lui-même.
Leur idée du reste n’est pas de tout égaliser, mais d’activer la possibilité d’un choix réfléchi. Cette vision de la société est profondément originale, et elle soulève beaucoup de questions. À l’évidence, il ne s’agit pas simplement d’inventer la protection sociale du futur, de créer un État-providence 2.0. Mais de doter chacun d’un moyen d’exercer sa liberté. Cela demande réflexion, non ?