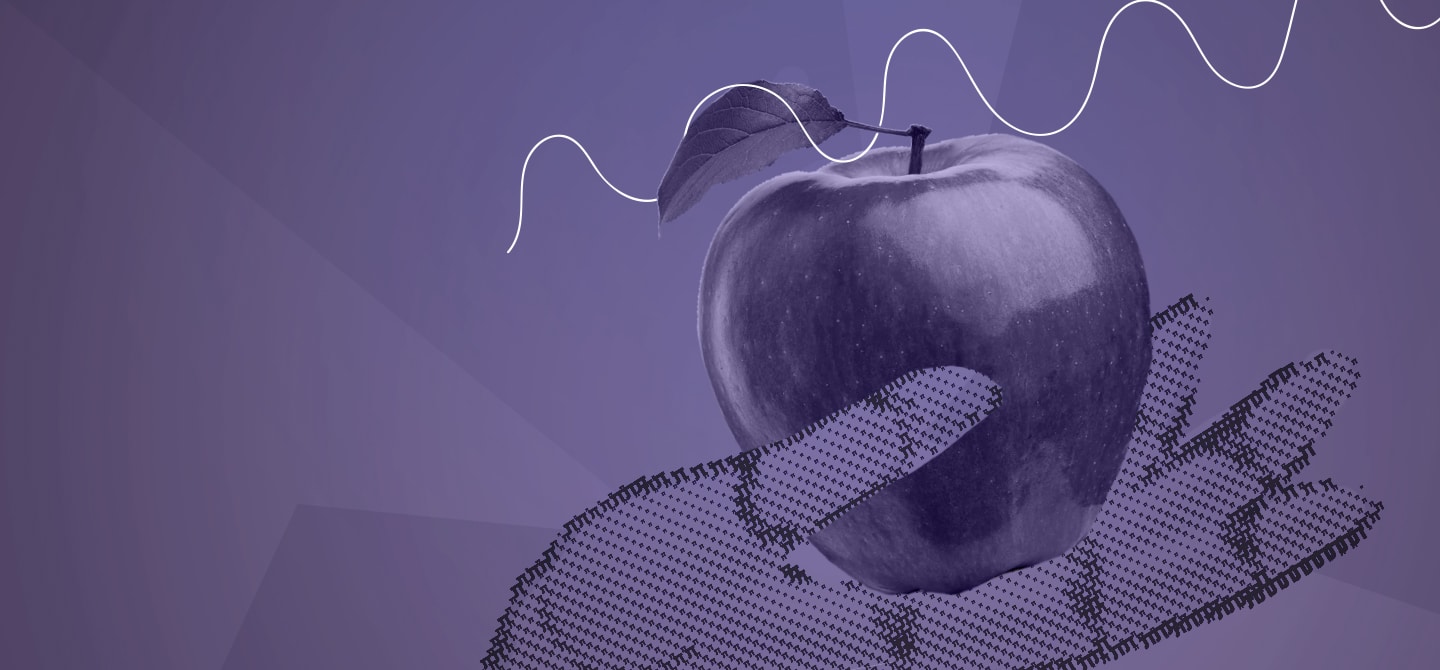Qu’est-ce que le « capitalisme cognitif » ? Pourquoi pensez-vous que nous entrons dans une 3ème forme de capitalisme ?
Nous avons déjà connu deux modèles capitalistes : mercantiliste et industriel. Le système industriel faisait du travail sa marchandise principale, et était bien plus efficace pour produire de la valeur que le capitalisme mercantiliste qui l’avait précédé. Son modèle reposait sur la force de travail des ouvriers, qui la vendaient puis la restauraient pour la vendre à nouveau le lendemain. Ce vieux schéma s’appliquait très bien à la force physique : le muscle est chargé en énergie et brûle une quantité donnée de sucre par heure, jusqu’à se décharger et se tétaniser, empêchant la poursuite du travail. Le fonctionnement de l’exploitation de la force de travail était donc très simple à comprendre parce qu’il était binaire : activité/repos.
Le problème, c’est que cette analyse classique ne s’applique plus au système actuel, basé sur le travail intellectuel. Le propre du capitalisme cognitif est d’incorporer à son modèle économique de plus en plus de connaissances immatérielles et de services. Pour fonctionner, il n’a donc pas besoin de force musculaire, mais d’activité cérébrale. Or le cerveau, lui, ne s’arrête jamais de fonctionner, y compris la nuit. Nombre de personnes ont d’ailleurs expérimenté cela avec le télétravail. Contrairement aux muscles, un cerveau n’est jamais au repos, et l’électroencéphalogramme plat est synonyme de mort.
Plus encore, l’activité cérébrale ne peut pas être contrainte. On peut physiquement obliger les gens à suivre une cadence particulière et à se coordonner sur une chaîne de travail, mais on ne peut pas obliger des cerveaux à coopérer. L’attention – comme la confiance, l’amour et tous les sentiments qui régissent les interactions entre les personnes – ne peut pas être fixée par un organigramme ou un contrat. C’est le problème du professeur qui assiste de façon impuissante à la démobilisation de ses étudiants, et se demande comment s’assurer que leur attention ne s’égare pas.
Pour que les cerveaux produisent de façon continue, sans divaguer, le capitalisme cognitif a donc développé des moyens de capter et de conserver l’attention. Et pour cela, il dispose d’outils beaucoup plus fins que les contrats. Les réseaux sociaux, par exemple, utilisent des éléments de design très insidieux pour jouer sur notre nature grégaire, nos biais cognitifs, et notre goût pour l’aléatoire1 afin de nous faire rester sur l’application – et donc nous faire produire – le plus longtemps possible.
Le capitalisme cognitif repose donc sur la captation des externalités positives ?
Oui. C’est exactement ce qu’il se passe avec les abeilles : longtemps, on s’est focalisé sur la vente du miel ou la cire – des produits finis – avant de se rendre compte que leur activité la plus productive était en réalité la pollinisation, qui génère entre 500 et 5 000 fois plus de valeur que le miel !
Notre temps de loisir est donc devenu productif. Le système est capable de s’approprier les nombreuses externalités positives générées par nos activités les plus insignifiantes : notre attention, notre ingéniosité, nos interactions, ou même nos simples recherches Google sont autant de façons de produire de la valeur. C’est d’ailleurs grâce à cela que nous pouvons accéder à des services ultra-sophistiqués gratuitement.
Ce nouveau capitalisme élargit d’ailleurs considérablement la masse des gens qui sont actifs, et l’activité des individus en réseaux – non marchande et souvent gratuite –, produit des données extrêmement précieuses pour les entreprises, qui sont utilisées pour alimenter des IA capables de résoudre des casse-têtes aussi complexes que celui de la « machine à traduire », par exemple. C’est tout bonnement une révolution de la science ! On extrait du big data des connaissances fiables, et ce de façon infiniment plus rapide et moins coûteuse que les anciennes méthodes, qui repoussaient les démarches inductives au profit exclusif de l’hypothético-déductif. Nombre de personnes se sont cassé les dents sur cette machine à traduire, mais c’est l’intelligence collective qui aura permis de la réaliser sans passer par la linguistique.
Cela pose évidemment le problème des fake news : la nouvelle vérité devient celle qui a le plus grand nombre d’occurrences… et dans le cas de la machine à traduire, cela peut contribuer à reproduire des fautes de langue fréquentes. Mais au global, c’est extrêmement efficace.
Cette production en réseau soulève également des interrogations autour de la propriété intellectuelle. Comment continuer à attribuer des titres de propriété alors que le savoir est souvent coproduit, et facilement reproductible numériquement ?
Dans le monde analogique, on parvenait toujours à distinguer la copie de l’original. La propriété intellectuelle était alors basée sur le fait que l’original percevait un prix de vente de la copie. Or, aujourd’hui, tous les obstacles techniques à la copie disparaissent, et ce modèle n’est plus viable. Il va sûrement il y avoir des transformations juridiques massives dans les 15 années à venir.
Il y a d’ailleurs des débats sur les meilleurs modèles alternatifs. L’open source, basé sur l’ouverture totale des données – qui deviennent ainsi des biens publics –, pose des problèmes de financement. Le modèle du copyleft (inventé par Richard Stallman) est une piste intéressante, qui a notamment permis de créer les Creative Commons comme alternative au copyright. Nous avons tendance à considérer que toute propriété est constituée de l’usus (le droit d’utiliser le bien), du fructus (le droit de le louer), et de l’abusus (le droit de l’aliéner définitivement, et donc de le vendre). Mais ce modèle juridique classique est très difficile à appliquer à des biens immatériels. Le système des Creative Commons permet de moduler ça, en autorisant le repartage de l’information ou de l’œuvre dans les mêmes conditions que celles définies par son auteur (« share alike »). Cela aide à créer un espace valorisant la circulation de l’information, tout en échappant aux limites des droits de propriété classiques, qui souvent sont un obstacle à la diffusion de la connaissance.
Les biens communs numériques sont à la base même du capitalisme cognitif, en ce qu’ils stimulent l’interaction et la création. Mais les plateformes ne jouent pas toujours le jeu… La question du droit d’auteur, par exemple, peut poser problème sur certains réseaux sociaux. Accepter les cookies ou accepter les conditions d’utilisation, c’est en réalité faire une cession de droits. Le secteur privé vit donc des externalités positives du secteur public ! Il est ainsi légitime de demander à ce secteur privé de contribuer au financement des activités publiques qui augmentent sa productivité. Cette réhabilitation des biens publics numériques – particulièrement mise en évidence dans la suspension de l’économie lors de la pandémie de Covid-19 – fait partie à mon sens d’une remise en question du néo-libéralisme qui avait paru si puissant depuis les années Thatcher.